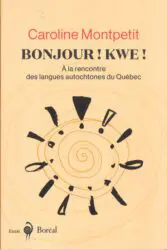Journaliste au Devoir, l’auteure propose à ses patrons, en 2017, d’écrire une série d’articles sur les onze langues autochtones du Québec. Le résultat servira de base aux onze chapitres d’un petit livre édifiant.
L’approche choisie consiste à rencontrer un interlocuteur ou une interlocutrice de chaque langue et de le ou la faire parler de son expérience. Globalement, des constantes s’observent : la langue se perd, elle est souvent parlée par les grands-parents mais beaucoup plus mal connue des jeunes, les pensionnats indiens, qui ont déraciné les jeunes d’une certaine génération, ont nettement accéléré ce processus de perte, et il existe des efforts très louables de conservation et de renforcement de ces langues.
Après, dans le détail, les situations sont très variées. Commençons par préciser que le Québécois lambda serait bien en peine de dire combien de langues autochtones il existe dans sa province : des onze annoncées ci-dessus, il faut en défalquer une, le wendat (huron) ayant disparu quelque part au XIXe siècle. Que l’on se rassure : il a tout de même droit à son chapitre !
Il est évident que, devant les déséquilibres économiques, politiques, technologiques et démographiques, la survie des langues autochtones représente tout un défi. Certaines s’en tirent encore pas mal, toutefois, grâce à un certain isolement ; on peut citer l’innu, l’inuktitut, l’atikamekw et le cri. D’autres vivotent, comme le malécite ou l’abénaquis. Entre les deux extrêmes, mentionnons l’algonquin, le naskapi, le micmac et le mohawk. Le naskapi s’en sort lui aussi assez bien, étant enseigné pendant tout le cours primaire, par exemple à Kawawachikamach, au nord de Schefferville – soit à douze heures de train au nord de Sept-Îles… car c’est aussi l’immensité du territoire québécois/autochtone que l’on découvre dans de ce livre ! « Fait à noter, nous signale l’auteure, c’est au Québec que les langues autochtones sont les mieux préservées. »
Au-delà des forces démographiques et économiques en jeu, la survie des langues autochtones se heurte à des difficultés ontologiques. Une langue exprime une vision du monde, un mode de vie. Les langues des peuples nomades qui vivent en union avec la nature sont intimement liées à ces réalités. Mais où passe leur richesse lorsque les nouvelles générations censées les parler connaissent, elles, un mode de vie sédentaire et technologique ? Forcément, il faut introduire un tas de nouveaux mots, ce qui enrichit la langue… mais fait passer bien des vocables à la trappe, car les idées à exprimer ne sont plus les mêmes.
Et comme pour toutes les langues, il y a les variantes, influencées par l’environnement linguistique. Comment dit-on « magasin » en micmac ? Du côté québécois, c’est magasinang ; dans les Provinces maritimes, on dira plutôt storeq…
Lorsque Roméo Saganash est élu député à la Chambre des Communes, en 2011, il donne une conférence à l’assemblée générale des Cris. Sauf que le mot député n’existe pas dans leur langue. Après mûre réflexion, on trouve un mot qui se traduirait littéralement par « celui qui parle en ton nom » ou « celui qui apporte ta voix ». Bon, mais après, on découvre que le mot mercure n’existe pas non plus en cri, ce qui est bien embêtant quand vient le temps de débattre de l’empoisonnement des rivières.
Au hasard des parcours et des personnalités des onze personnes rencontrées, le livre révèle son sujet sous divers angles, dont l’autochtone déraciné qui vit à Montréal mais garde autant que possible des liens avec sa distante communauté, les mariages mixtes, l’appel inéluctable de la modernité par opposition aux racines et à l’attrait de la tradition, les milieux communautaires, les efforts souvent encourageants mis en œuvre pour entretenir ou faire revivre certaines langues, les entreprises lexicographiques et, bien sûr, l’histoire : celle des peuples autochtones, celle de leur rencontre avec « l’homme blanc » (sans oublier « l’autre homme blanc », soit l’Anglais en cri) et l’histoire individuelle des protagonistes, toujours instructive parce qu’elle nous apprend une réalité bien concrète.
Côté statistiques, on apprend que 16 % de la population autochtone canadienne se disait capable de soutenir une conversation dans une langue autochtone en 2016, contre 21 % dix ans plus tôt. Mais le gouvernement canadien redouble d’efforts, et même Facebook s’y met, en ajoutant l’inuktitut à ses langues d’interface en 2022. « Tout n’est pas perdu », conclut l’auteure.