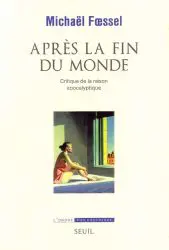Notre époque est caractérisée par des visions d’apocalypse, qui font en sorte que la croyance au progrès a cédé la place à l’angoisse. Avec les crises sanitaires, le péril écologique ou les menaces d’attaques chimiques qui ont cours, le monde a-t-il vraiment changé depuis 1945 ? Selon Michaël Fœssel, ce sont avant tout les manières dont les êtres humains se rapportent à lui qui se sont modifiées. Les interprétations négatives du réel qui dominent notre temps ne donnent plus du monde l’image d’un tout ordonné où l’individu trouverait à la fois sa place et sa justification. Autant d’indétermination suggère le contraire de la durée : la fin approche. Aussi le catastrophisme contemporain se prépare-t-il à la vie après la fin du monde. Or, si la prémisse catastrophiste paraît fondée à Fœssel, sa conclusion lui semble en revanche erronée. Il en fait la démonstration dans ce livre dont le style – une argumentation philosophique nourrie de la pensée de Hobbes, Kant, Hegel, Heidegger et Anders – rebutera malheureusement plus d’un lecteur. Malgré l’absence de jargon, Après la fin du monde dénote un côté austère qui en complique la lecture pour les non-philosophes. Voilà qui est bien dommage, car Fœssel traite d’un sujet passionnant, actuel, et qu’il le fait avec autant de finesse que d’érudition.
L’essai de Fœssel est divisé en deux sections. La première, « Généalogie », remonte aux sources de la modernité afin d’élucider la résurgence de l’apocalypse comme hantise, comme colère et comme fuite ou refus du monde. La seconde, « Diagnostic », examine les idées de perte, de préservation et de cosmopolitisme. Quatre intermèdes sont intercalés entre les chapitres, venant y apporter une touche non pas plus légère, mais plus littéraire (l’auteur y parle de Fontenelle, Flaubert, Brecht et Michaux) ; il y fait également référence au film de Lars von Trier, Melancholia. Au rayon des ouvrages publiés dans la foulée de l’apocalypse appréhendée pour fin 2012, l’essai de Fœssel se distingue par sa lecture rationnelle de grandes peurs qui se sont vues transférées du domaine du fantasme à « la catégorie universelle de l’expérience ».