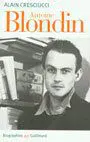Promis à tous les succès, capable d’analyser le sport comme d’éprouver de l’empathie envers Baudelaire, soutenu par d’indéfectibles amitiés et l’admiration des critiques, Antoine Blondin n’aura pourtant donné qu’une partie de son potentiel. Ainsi, en tout cas, le veut la rumeur. Jugement étonnant et un peu mesquin. Certes, la liste des romans est courte et leur gabarit généralement modeste, mais à peu près tous méritent de survivre dans les mémoires. En outre, l’écrivain consacra une bonne partie de son temps et de ses énergies non à multiplier les romans, mais à donner au journalisme sportif ses lettres de noblesse. C’est par centaines qu’on dénombrerait ses chroniques au style inimitable sur le Tour de France, les jeux olympiques, les exploits ou les humiliations des équipes françaises de rugby ou de soccer.
Pourquoi, dès lors, ce jugement ? En partie à cause du parcours sinueux de ses jugements politiques, mais, bien davantage, à cause d’une paradoxale inaptitude au bonheur. Antoine Blondin se maria presque par distraction, ignora ses filles presque toute sa vie, vécut en noctambule incorrigible. Incapable de solitude, il misa tout sur la promiscuité des bistrots, s’immergeant dans un alcoolisme stérilisant et de plus en plus agressif. Si le Tour de France le revigorait, c’est qu’il trouvait là des amitiés masculines et des échéances rapprochées et implacables. Évoquer son nom, ce sera le plus souvent faire allusion à un naufrage claironnant et oublier l’écrivain.
Car Antoine Blondin écrit merveilleusement. Ses calembours peuvent agacer, mais on entend bientôt à travers eux le besoin de chaleur humaine et une certaine peur des mots. Grâce à son sens de la formule, cultivé dans des chroniques offertes à des publics pressés, il débride brutalement les plaies, qu’elles soient celles d’opposants ou les siennes. Son humour cache un mal de vivre qu’il tentera de tromper par des promesses jamais tenues et des fables invérifiables. Son biographe rend justice à son génie, à la musique de son style, à un charme qui, le plus souvent, le dédouana du pire, mais il n’embellit pas l’image d’un humain campé à distance de la maturité.