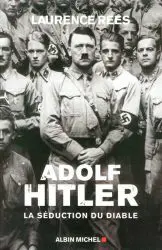La montée du nazisme dans l’Allemagne des années 1920 et l’emprise absolue que finira par exercer son chef sur la société allemande des années 1930 ont suscité des centaines d’ouvrages de toutes sortes. « C’est un phénomène qui donnera au monde à méditer pendant des siècles », rappelle à juste titre Laurence Rees au début de son ouvrage. L’historien anglais, par ailleurs producteur et réalisateur à la BBC, aborde la question hitlérienne non pas sous l’angle moral comme pourrait le suggérer le titre, mais sous l’angle du charisme politique tel que le définissait Max Weber, l’un des fondateurs de la sociologie moderne.
Pour Weber, « le chef charismatique doit posséder un fort élément ‘missionnaire’ […]. Il est plus proche d’une figure quasi religieuse que d’un homme d’État […]. Les partisans d’un tel chef […] poursuivent un but presque spirituel, de rédemption et de salut ». C’est l’originalité de cet ouvrage de traiter du nazisme en recourant le plus souvent à des concepts qui relèvent plus de la foi que de la politique. « La foi seule crée l’État », disait Hitler à ses partisans. Cette foi, nous rappelle Rees, était fondée chez lui sur sa croyance profonde que les lois de la nature prévalent dans les rapports humains. « Nous sommes des animaux où [sic] seuls survivent les plus forts ». D’après le credo nazi, il en est des peuples comme des individus. C’est le socle de la philosophie raciste du Troisième Reich.
L’irruption d’un tel homme sur la scène de l’histoire ne s’explique pas uniquement par la violence et la brutalité de ses méthodes mais bien davantage par la totale absence de repères devant laquelle se trouvait le peuple allemand au lendemain de la Première Guerre mondiale. Humilié par une défaite mise sur le compte d’un complot judéo-bolchevique, enfoncé dans une crise économique qu’aggravaient les énormes réparations de guerre exigées par les vainqueurs, privé d’institutions politiques susceptibles d’assurer la stabilité et la sécurité de la société, le peuple allemand aspirait à trouver un héros providentiel qui remettrait le pays sur les rails et lui redonnerait sa dignité. Ce fut Hitler !
Même si les méthodes de Hitler pouvaient paraître contestables, les Allemands ont longtemps cru avoir fait le bon choix ; du moins jusqu’aux premiers revers de la campagne de Russie en 1941. Non seulement avait-il effacé les humiliations du traité de Versailles, présidé à l’essor économique de l’Allemagne, assuré le maintien de l’ordre, mais il avait conquis pratiquement toute l’Europe, sans avoir essuyé de grandes pertes. Comment ne pas croire en effet à son côté providentiel ? Quand les terribles conséquences de sa politique furent connues, « il était trop tard pour sauter du train en marche », avouèrent plus tard beaucoup d’Allemands qui l’avaient soutenu au départ.
Laurence Rees s’appuie sur une copieuse documentation qu’il exploite avec beaucoup d’à-propos. Rien n’est avancé qui ne soit appuyé sur des documents ou de nombreux témoignages, parfois inédits. À cet égard, on peut regretter que l’éditeur n’ait pas cru utile de regrouper ces références dans une bibliographie à la fin de l’ouvrage. Lacune plus étonnante toutefois, l’auteur a choisi de passer totalement sous silence le rôle pourtant capital de la propagande nazie dans la création du mythe hitlérien. Ces réserves faites, Adolf Hitler, La séduction du diable reste une étude remarquablement éclairante sur un personnage qui a profondément marqué la conscience de notre époque.