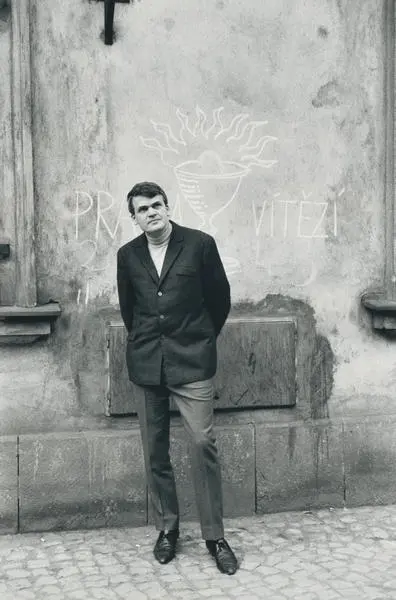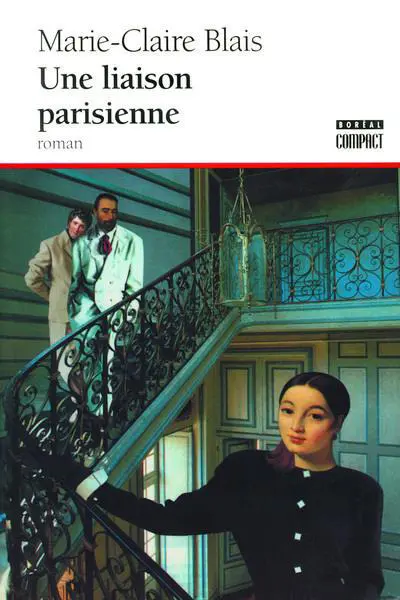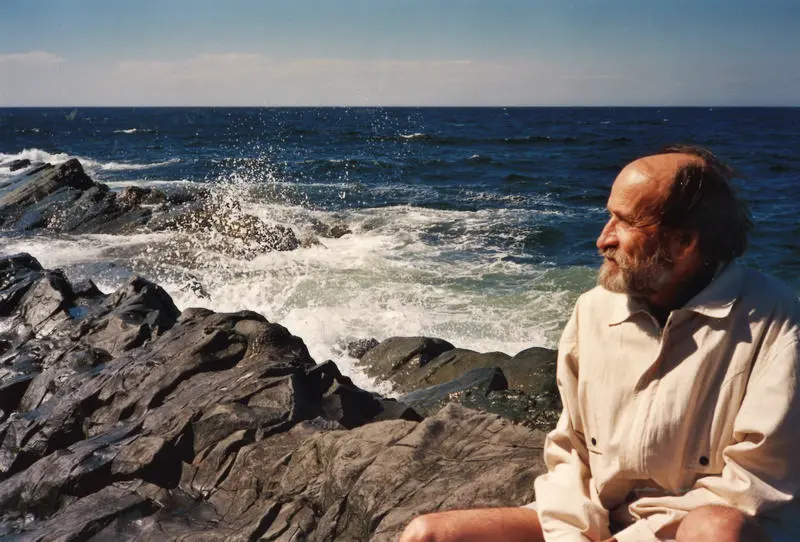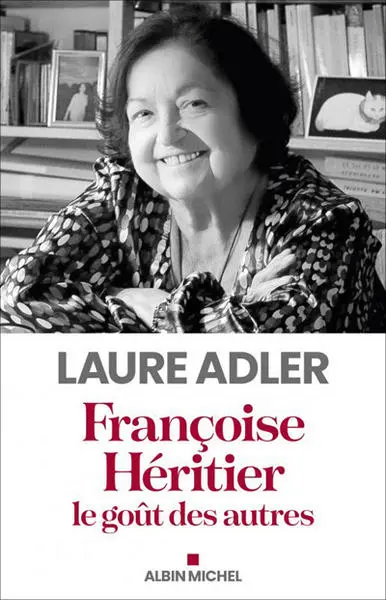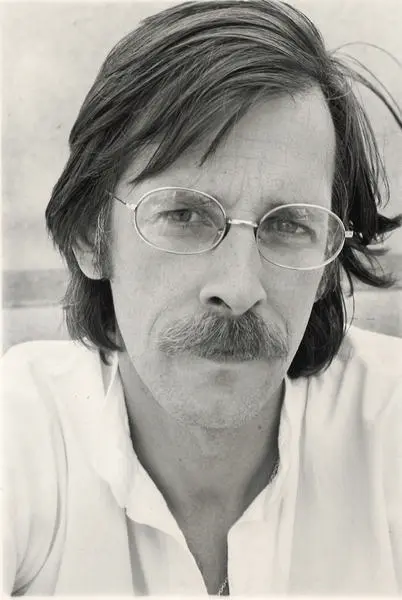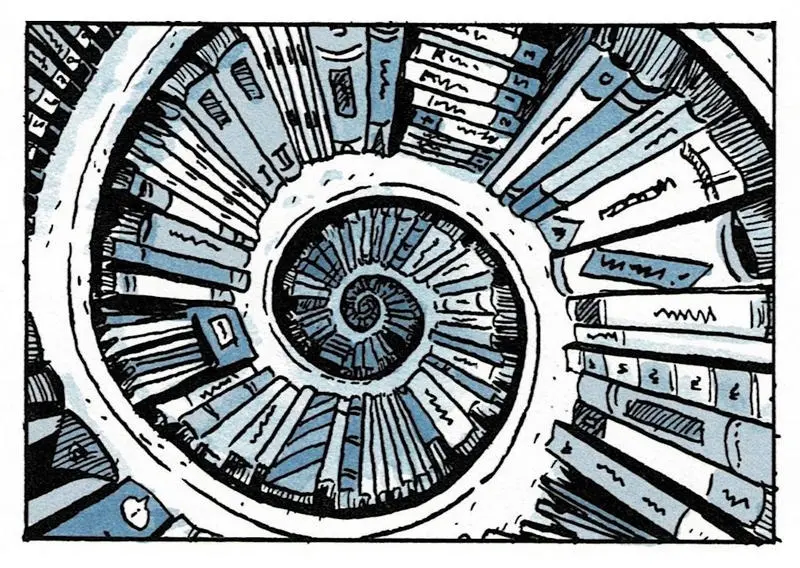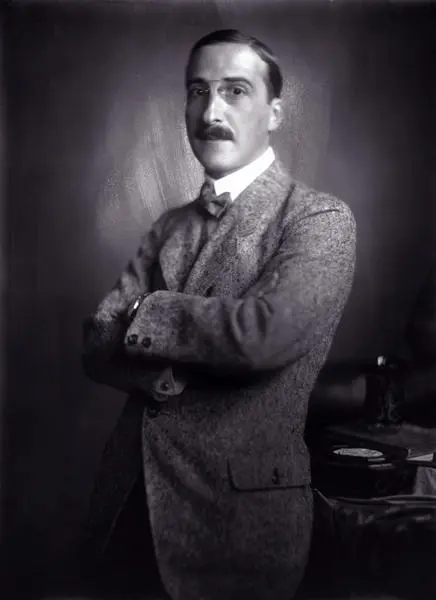Ainsi créent-elles sur nos écrans. Télé, vidéo, ciné
L’intention est ambitieuse : traverser les lieux de la télévision, des jeux vidéo et du cinéma au Québec, et observer la présence des femmes, leur rôle et les influences qu’elles y exercent, leurs avancées et les… Ainsi créent-elles sur nos écrans. Télé, vidéo, ciné