Dieu merci, Alice Munro n’a plus besoin de présentation. Son dernier recueil de nouvelles, paru en français aux éditions du Boréal, Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout1, vient confirmer, si besoin était, l’immense talent de l’écrivaine ontarienne dont l’œuvre est essentiellement consacrée à la nouvelle. D’aucuns ont laissé entendre que ses nouvelles s’apparentaient davantage à de petits romans, comme si la longueur était le critère cardinal pour en juger. Soit, elle ne privilégiait pas la brièveté, mais laissons à d’autres le loisir de s’égarer dans d’inutiles classements taxinomiques (autrement, à titre de romancière, elle ravirait la palme à Simenon quant au nombre de romans publiés).
Le recueil regroupe neuf nouvelles qui plongent à nouveau au cœur des relations humaines, de l’amour sous ses formes les plus diverses qu’Alice Munro dissèque minutieusement, sur un mode tantôt dramatique, tantôt humoristique, mêlant très souvent l’un et l’autre modes pour mieux en souligner les grandeurs et misères. Le recueil s’ouvre sur un mauvais tour que croient jouer deux adolescentes à une gouvernante qui tient la maison du grand-père de l’une d’elles dans un village reculé de l’Ontario. Elles cherchent à lui faire croire que le père de l’une, un raté de première parti vivre dans l’Ouest, est amoureux d’elle et qu’il souhaite l’épouser. Le canular se construit autour d’un échange de fausses et de vraies lettres adressées à la gouvernante. Cette dernière se révélera toutefois plus dégourdie qu’elles ne l’avaient cru, et l’histoire se conclura autrement que ce que les deux adolescentes avaient espéré. La nouvelle éponyme est ici très révélatrice de la manière Munro pour ce qui est de construire et de conduire une histoire. Le rythme est lent et épouse le déploiement de chacun des événements autour desquels l’intrigue se développe. La nouvelle se démarque ici par une touche d’humour discrète dans un décor d’une grande sobriété. Aucune effusion sentimentale ne caractérise l’univers d’Alice Munro, cette dernière privilégiant plutôt les descriptions minutieuses des lieux et des personnages qui assurent un appui stable et solide au déroulement de l’histoire. Cette caractéristique a sans doute conduit certains observateurs à qualifier de long stories les nouvelles de Munro, par opposition à short stories.
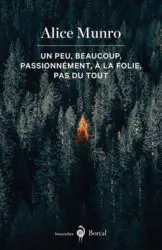 Dans une autre nouvelle, « Le pont flottant », à l’atmosphère plus énigmatique, une jeune fille atteinte d’un cancer rentre chez elle après que le médecin lui eut fait part des derniers résultats de ses analyses. En même temps qu’elle doit affronter le caractère inéluctable de sa maladie, le trouble amoureux lui est révélé lorsqu’un garçon l’entraîne sur un pont flottant pour l’embrasser. Éros et Thanatos sont ici réunis dans un texte d’une grande sensibilité.
Dans une autre nouvelle, « Le pont flottant », à l’atmosphère plus énigmatique, une jeune fille atteinte d’un cancer rentre chez elle après que le médecin lui eut fait part des derniers résultats de ses analyses. En même temps qu’elle doit affronter le caractère inéluctable de sa maladie, le trouble amoureux lui est révélé lorsqu’un garçon l’entraîne sur un pont flottant pour l’embrasser. Éros et Thanatos sont ici réunis dans un texte d’une grande sensibilité.
La nouvelle « Le mobilier familial » a ceci de particulier qu’elle nous livre l’une des clés de lecture pour comprendre ce qui anime Alice Munro. Dans ce texte, la narratrice découvre la vie cachée qu’a menée son père à la fin de la Première Guerre mondiale alors que, jeune homme, il connut ses premiers émois amoureux avec une cousine dont la fille, Alfrida, révélera à la narratrice le secret de cet amour interdit après la mort du père. Cette nouvelle fait en quelque sorte l’exégèse de l’œuvre d’Alice Munro en ce qu’elle soulève la question de la légitimité d’utiliser un matériau narratif personnel et familial, sur lequel une grande partie de son œuvre repose. « Je ne songeais pas à la nouvelle que j’écrirais à propos d’Alfrida – pas à cela en particulier –, mais au travail que je voulais accomplir, qui consistait davantage à saisir les choses flottant dans l’air qu’à construire des histoires. Les cris de la foule me parvenaient, semblables à de gros battements de cœur, emplis de chagrins. Des vagues ravissantes dont le chant solennel, distant, presque inhumain, était à la fois plainte et acceptation. C’était cela que je voulais, c’était ce à quoi je devais prêter attention, pensais-je, c’était à cela que je voulais que ma vie ressemble. » Grande est ici la tentation de donner un sens élargi à ce dernier passage, de confondre la narratrice et l’auteure de la nouvelle, d’y accoler une intention qui dépasse les limites de ce texte.
Alice Munro nous entraîne dans ses histoires comme une araignée tisse patiemment sa toile pour mieux emprisonner sa proie. Elle les construit comme de véritables courtepointes, chaque élément ayant sa facture propre pour ensuite s’insérer dans le motif d’ensemble qui se révèle par petites touches. Les débuts des nouvelles sont toujours annonciateurs d’une histoire qui va nous être racontée. C’est sa façon d’énoncer « Il était une fois… » Rien n’est laissé au hasard dans leur construction, soutenue par une écriture tout aussi soignée que précise. Nous plongeons au cœur de chacune des histoires et découvrons, progressivement, les motivations secrètes des personnages. Ni beaux ni laids, ni grands ni petits, les personnages d’Alice Munro cherchent simplement à prendre vie au fil de l’écriture et à assumer leur rôle, comme dans une pièce de théâtre où le drame qui se joue est plus grand qu’eux. Dans une nouvelle comme « Ce qui reste », l’enterrement sert avant tout à illustrer, à dévoiler la dynamique intime d’un couple. Le texte qui clôt le recueil, « Auprès de ma blonde », est des plus troublants à cet égard. Quand un homme se voit contraint de placer sa femme dans une résidence spécialisée pour personnes atteintes d’Alzheimer, c’est sa propre existence qui se délite sous nos yeux. Au fond, on ne sait jamais trop où Alice Munro cherche à nous entraîner, mais elle y parvient chaque fois, cela est indéniable.
1. Alice Munro, Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, trad. de l’anglais par Agnès Desarthe, Boréal, Montréal, 2019, 379 p. ; 32,95 $.
EXTRAITS
Elle n’était pas, tout bien considéré, le genre de personne vers qui les autres se précipitaient comme vers un aimant. Elle était pourtant exigeante dans ses amitiés, à sa façon.
« Le pont flottant », p. 70.
Je ne comprenais pas pourquoi Alfrida le regardait avec un sourire si insistant et si encourageant. Toute mon expérience de femme avec un homme, de femme écoutant un homme et espérant de toutes ses forces qu’il se révélerait digne de lui inspirer une fierté raisonnable était encore à venir.
« Le mobilier familial », p. 129.
L’histoire que je finirais par concevoir autour de ce motif ne serait pas écrite avant de nombreuses années, pas avant qu’il fût devenu parfaitement sans importance de savoir qui m’en avait donné l’idée au départ.
« Le mobilier familial », p. 134.
Polly n’avait pas de père. C’était ce qu’on disait et ce que Lorna avait pris pour argent comptant durant des années. Polly n’avait pas de père, de la même façon que les chats sur l’île de Man n’ont pas de queue.
« Ossature bois », p. 229.











