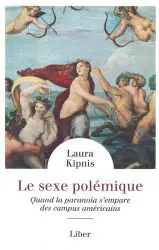De l’avis même de son autrice, l’essai est explosif. Dans le milieu universitaire aux États-Unis règne un paradoxe extrême. Ou le sexe y est récréatif et libertaire, ou il devient le lieu de tous les dangers. Les idéologues, dominés par les sentiments, n’ont nul besoin de débattre de leurs perceptions. Impossible de remettre celles-ci en question ni de les soumettre à un examen. Les processus d’enquête sur les comportements sexuels inappropriés sont inquisitoriaux. L’hystérie impose sa loi. Autrement dit, rien ne va plus, prévient Laura Kipnis.
Le triomphe de Galatée de Raphaël illustre la page couverture du Sexe polémique1 et évoque la sensualité comme un appel urgent à revoir la dynamique des relations intimes sur les campus du haut savoir chez nos voisins du Sud. Deux camps s’y affrontent, l’un prêche le sexe à tout-va, l’autre prône une circonspection paranoïde. Pour le premier, le sexe n’aurait aucun secret, pour le second, il serait menaçant.
Par bonheur titularisée, Laura Kipnis enseigne le cinéma à l’Université Northwestern en Illinois quand, médusée, elle apprend par la bande et non par son administration qu’une marche étudiante de matelas et d’oreillers à son encontre a eu lieu, après la parution dans un journal spécialisé de son article sur la paranoïa sexuelle universitaire. La guerre est déclarée. S’ensuivent une cascade de plaintes, des accusations ambiguës, des interrogatoires vexatoires, une enquête de 72 jours qui blanchira la « défenderesse ». Le processus décrit, surtout décrié sur tous les tons, ne saurait être plus kafkaïen. La vertu préside à la pensée critique pour rendre justice. Les règlements délogent l’analyse. Dans cette ambiance d’une hostilité feutrée, l’hygiène moralisatrice se porte à merveille. De commenter l’essayiste : « De deux choses l’une : ou bien l’endroit s’était transformé en État policier sans que je m’en aperçoive, ou bien d’autres risquaient fort de se scandaliser de ce qu’une loi fédérale contre la discrimination sexuelle serve à punir un professeur pour avoir écrit un article ».
D’une intention louable à l’enfer
La verve corsée d’ironie et la matière foisonnante de Laura Kipnis mettent au jour ce climat de peur qui s’est installé peu à peu et pollue l’air de chaque universitaire qui s’effraie de causer un incident en classe, lequel dégénérerait en désastre professionnel. C’est ainsi que des professeurs de philosophie ou de sociologie éliminent de leur corpus certains sujets, l’avortement ou le viol par exemple. Polémiste certes, presque pamphlétaire, l’essayiste défend à mains nues des positions impopulaires, sans craindre d’arpenter les sentiers tortueux et contradictoires du savoir et du pouvoir, du désir et du sexe. Des doctorants jouent des drames œdipiens à leurs aînés. Des étudiants et des étudiantes de premier cycle s’opposent les uns aux autres par vengeance. Des relations amoureuses s’enveniment et induisent des comportements vindicatifs. Pis, des accusations tirées par les cheveux proviennent souvent d’un collègue. « Toute la profession a été transformée en une classe sexuellement suspecte. » Le conflit n’est pas banal ou limité, puisque 25 millions de personnes travaillent ou étudient sur un campus américain.
Les intérêts pécuniaires des uns et des autres, ceux de l’université et ceux des plaignants, voire des victimes, sont découpés au scalpel. Pour préserver sa réputation auprès du gouvernement fédéral, qui lui offre jusqu’à 70 % des fonds de recherche, l’université préférera verser des indemnités aux plaignantes plutôt que de chercher la vérité. Les administrations sacrifieront ceux qu’on accuse pour éviter d’alarmer le Bureau des droits civils. Des étudiants masculins condamnés font la file auprès des tribunaux civils.
Presque le tiers du livre présente avec force détails le lynchage du très influent professeur de philosophie Peter Ludlow, suivi par le propre cas de l’essayiste. La quantité d’informations et leur intérêt indéniable ne représentent que des fragments de l’affaire, tant et si bien qu’on se voit obligée de croire sur parole l’analyse qu’elle en fait. Ou alors de ressentir tout du long un malaise de ne pouvoir juger par soi-même. On oscille entre l’impression d’assister à un règlement de comptes et celle d’un débat intelligent où Kipnis serait juge et partie. Autre objet de questionnement : celle-ci précise qu’à l’université les allégations passent souvent par des acteurs de l’ombre et leurs desseins secrets. Pour l’essentiel, les personnes mises en cause dans sa diatribe sont enquêteuses, plaignantes, doctorantes, féministes extrémistes, administratrices, mères d’étudiantes, des femmes donc en lutte contre des professeurs masculins qui en sont victimes. Les plaignantes apparaissent comme des manipulatrices, des calculatrices, quand ce ne sont pas des affabulatrices.
Ni logique ni justice
Malgré la sensibilité féministe dont elle se réclame, Kipnis a failli à examiner la situation dans ses nombreux replis en tenant compte des disparités et des inégalités qui touchent les femmes et qui créent tant de distorsions. Dans un aparté, elle écrit : « […] il n’y a pour moi aucun doute que les femmes responsables du titre IX (point de jonction réglementaire des plaintes s’appuyant sur une disposition légale), auxquelles on donne une rare occasion de faire le procès de la sexualité masculine, sont causes d’une bonne partie des abus de pouvoir du programme ». Elle ajoute : « Messieurs, l’heure de la vengeance a sonné ». Son propos ironique mais véhément fait table rase d’une réalité cardinale des jeux de pouvoir. Désormais, que ça plaise ou non, les femmes aspirent au pouvoir. À tous les pouvoirs. Dans une marche irréversible. Cette volonté se heurte encore et encore au refus masculin de céder un millimètre du territoire conquis. Doit-on s’étonner que ce déséquilibre persistant génère dans certains cas des stratégies ou des répliques qui ne procèdent ni de la logique ni de la justice ?
Quand elle extirpe son analyse de sa situation personnelle, la pédagogue nostalgique mais encore éprise de son métier partage des propos inspirants et des réflexions philosophiques clairvoyantes sur le sexe et l’alcool, le sexe et le sport, le sexe et les relations interraciales, etc., et offre ses meilleures plaidoiries. Sa langue déliée l’autorise à conchier – le terme familier est à peine exagéré – par argumentations et démonstrations « le féminisme paternaliste » des universités qui, sous l’exigence du ministère de l’Éducation, mettent en place règlements et procédures qui ne font que débiliter le libre arbitre des femmes. « À quoi et à qui peut bien servir un féminisme si imprégné d’immunité qu’il préfère imaginer les femmes comme des enfants sans défense plutôt que de reconnaître les réalités adultes du sexe ? » C’est là que s’impose une filiation avec l’intellectuelle Camille Paglia. Elle reprend en d’autres mots la croyance que la sexualité est beaucoup plus ténébreuse que les féministes n’ont bien voulu l’admettre. Davantage encore, que deux idées en apparence divergentes peuvent être simultanément vraies : « […] les hommes sont responsables des agressions sexuelles et les femmes qui font comme s’il n’existait pas d’agressions sexuelles se comportent de façon incohérente ».
Le texte met en lumière la recherche, y compris une méta-analyse récente de 69 études empiriques différentes, selon laquelle il n’y aurait aucune réduction des taux d’agression comme résultat démontrable des efforts de prévention. Et pourquoi n’adopte-t-on pas les programmes d’autodéfense et d’affirmation de soi qui ont fait leurs preuves ? Kipnis le déplore et suggère : « Oui, il y a un excédent de puissance masculine dans le monde, mais les femmes doivent être formées pour s’y opposer chaque fois qu’il le faut au lieu d’attendre que les hommes élèvent enfin leur conscience à un stade supérieur – juste au cas où ce jour ne viendrait jamais ». On croit entendre Paglia.
Au Québec, l’ouvrage niché intéressera la large communauté des études supérieures, aussi bien professorale, administrative qu’étudiante qui, elle aussi soumise à l’empire de l’étudiant-consommateur, n’échappe pas à certaines pressions en ce que « […] plus les universités se dévouent à la création de ‘lieux sûrs’, ce nouveau mot d’ordre, plus les campus deviennent dangereux pour les professeurs, et plus l’éducation elle-même est perdue de vue par tout le monde ».
Ici ou là-bas, il est urgent de remettre certaines pendules à l’heure et, en prenant d’importants risques professionnels, l’autrice s’y emploie et y déploie toute son indignation. Elle a souvent raison. Un geste sexiste n’est pas une agression sexuelle. Un baiser forcé n’est pas un viol. La confusion qui embrume cette lutte contre le harcèlement et les agressions sexuelles nuit jusqu’à discréditer les vraies et nombreuses victimes. Dans cet empêtrement débridé, des cas connus d’agressions sexuelles graves n’ont mené à aucune condamnation.
Tout n’est pas perdu puisque les révélations de Laura Kipnis ont suscité plusieurs débats qui avaient trop tardé. Elle salue le président de son université de même que sa doyenne, qui ont pris le parti de défendre la liberté universitaire tout en apaisant les esprits qui voudraient la supprimer. Pour en finir avec ces mauvaises expériences sexuelles, elle s’interroge sur l’utilité que pourrait avoir une commission de vérité et de réconciliation.
1. Laura Kipnis, Le sexe polémique. Quand la paranoïa s’empare des campus américains, Liber, Montréal, 2019, 301 p. ; 24 $.
EXTRAITS
Je ne crois tout simplement pas que l’expérience ou l’identité donne à qui que ce soit de compétence intellectuelle.
p. 47
Si les récents événements ont quelque chose à nous apprendre, c’est que le pouvoir est une entente sociale et non une substance stable.
p. 278
Nous allons au travail et devons faire mine d’être dépourvus d’appareil génital sous nos vêtements, de même que nos collègues.
p. 281
Chacun sait que, si l’on remonte de quelques centimètres, tout peut arriver. Mesurez la distance entre la rotule et l’entrecuisse, divisez par deux, franchissez cette ligne et vous pénétrez la zone du haut des cuisses – je crois que chaque femme sait précisément où cette ligne se trouve sur son corps, et ce que sa transgression signifie.
p. 283