La beauté des paysages de la Gaspésie et la singularité de ses habitants ont inspiré de grands noms de la littérature québécoise, comme Jacques Ferron, Claude Jasmin et Anne Hébert. Elles ont aussi inspiré ses écrivains, qui ont choisi de camper leurs récits dans cette région qui les a vus naître, grandir, partir ou revenir.
À partir, entre autres, des romans de Noël Audet, de Réal-Gabriel Bujold, de Sylvain Rivière, de Rachel Leclerc, d’Éric Dupont, de Marie Christine Bernard, de Mahigan Lepage, de Marie-Ève Trudel Vibert et de Mylène Fortin, on peut faire ressortir les grandes lignes de ce qu’on pourrait appeler le « roman gaspésien » depuis 1980. Bien que ces auteurs aient tous une manière qui leur est propre de mettre en scène la Gaspésie et de la raconter, certains thèmes ou motifs reviennent d’une œuvre de fiction à l’autre. Ainsi, à travers ces histoires de familles, de deuils et de voyages, il est possible d’esquisser un portrait romanesque de cette région telle qu’elle est vue par ceux qui y sont nés.
Raconter
 La narration des « romans gaspésiens » est souvent assurée par un ou des personnages qui racontent l’histoire d’un membre de leur famille ou des souvenirs d’enfance. Dans le premier cas, le narrateur rapporte des faits qui ont été transmis de bouche à oreille ou qui lui ont été livrés par le ou les principaux intéressés. Dans Quand la voile faseille (1980) de Noël Audet, par exemple, le narrateur raconte l’histoire de son oncle Arsène, puis celles de ses tantes et de son père pour, finalement, parler de ses amours, comme s’il fallait d’abord parler des autres pour arriver enfin « à [s]e raconter à [s]oi-même [s]a propre histoire », comme en témoigne André Loubert, narrateur de Ah, l’amour l’amour du même auteur. La patience des fantômes (2011) de Rachel Leclerc présente aussi un narrateur qui raconte l’histoire de sa famille, mais son récit témoigne davantage d’un désir de restituer une mémoire familiale pour corriger le passé et libérer les générations futures d’un legs mémoriel maudit.
La narration des « romans gaspésiens » est souvent assurée par un ou des personnages qui racontent l’histoire d’un membre de leur famille ou des souvenirs d’enfance. Dans le premier cas, le narrateur rapporte des faits qui ont été transmis de bouche à oreille ou qui lui ont été livrés par le ou les principaux intéressés. Dans Quand la voile faseille (1980) de Noël Audet, par exemple, le narrateur raconte l’histoire de son oncle Arsène, puis celles de ses tantes et de son père pour, finalement, parler de ses amours, comme s’il fallait d’abord parler des autres pour arriver enfin « à [s]e raconter à [s]oi-même [s]a propre histoire », comme en témoigne André Loubert, narrateur de Ah, l’amour l’amour du même auteur. La patience des fantômes (2011) de Rachel Leclerc présente aussi un narrateur qui raconte l’histoire de sa famille, mais son récit témoigne davantage d’un désir de restituer une mémoire familiale pour corriger le passé et libérer les générations futures d’un legs mémoriel maudit.
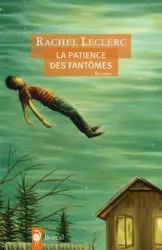
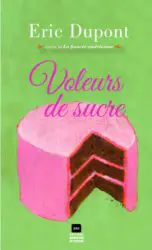 Dans le deuxième cas, celui des récits d’enfance, les narrateurs reviennent sur des événements heureux ou traumatisants, sinon tristes, de leur enfance en Gaspésie. Les romans Voleurs de sucre (2004) et Bestiaire (2008) d’Éric Dupont mettent en scène un personnage-narrateur – qu’on devine être le même garçon dans les deux textes – qui, une fois adulte, évoque des événements qui se sont déroulés d’abord à Amqui, où il est né, ensuite à Matane (Saint-Ulric-de-Matane), où il a déménagé avec son père, sa belle-mère et sa sœur après quelques années passées à Rivière-du-Loup. Le premier roman donne à voir Amqui à travers les yeux d’un jeune enfant qui découvre le monde et qui vit sa première séparation, celle d’avec le « plateau de [s]on bonheur ». Le deuxième roman, quant à lui, dépeint Matane et ses environs comme un milieu hostile où le jeune Éric fait la rencontre de l’adversité. Différent des autres garçons, il souhaite quitter ce lieu auquel il ne se sentira jamais appartenir. La première partie du roman Coulées (2012) de Mahigan Lepage se rapproche en plusieurs points du dernier de Dupont, à l’exception de la question de l’appartenance puisqu’elle y est plus conflictuelle. Le narrateur, bien qu’il soit né dans la Vallée et s’y sente chez lui, ne sera jamais considéré par les autres enfants comme un des leurs parce que son père vient d’ailleurs. Dans cette première partie, le narrateur raconte « le monde des Plateaux » où il a grandi. À travers ses souvenirs d’enfance tantôt heureux, tantôt douloureux, il rapporte aussi quelques anecdotes concernant la vie de ses parents avant son arrivée. On remarque que ces romans, où les narrateurs replongent dans leur enfance, s’inscrivent sous le signe de la perte : ils racontent un lieu déserté, une famille éclatée, des amis perdus, bref un passé qui tend à s’effacer et qui menace de disparaître.
Dans le deuxième cas, celui des récits d’enfance, les narrateurs reviennent sur des événements heureux ou traumatisants, sinon tristes, de leur enfance en Gaspésie. Les romans Voleurs de sucre (2004) et Bestiaire (2008) d’Éric Dupont mettent en scène un personnage-narrateur – qu’on devine être le même garçon dans les deux textes – qui, une fois adulte, évoque des événements qui se sont déroulés d’abord à Amqui, où il est né, ensuite à Matane (Saint-Ulric-de-Matane), où il a déménagé avec son père, sa belle-mère et sa sœur après quelques années passées à Rivière-du-Loup. Le premier roman donne à voir Amqui à travers les yeux d’un jeune enfant qui découvre le monde et qui vit sa première séparation, celle d’avec le « plateau de [s]on bonheur ». Le deuxième roman, quant à lui, dépeint Matane et ses environs comme un milieu hostile où le jeune Éric fait la rencontre de l’adversité. Différent des autres garçons, il souhaite quitter ce lieu auquel il ne se sentira jamais appartenir. La première partie du roman Coulées (2012) de Mahigan Lepage se rapproche en plusieurs points du dernier de Dupont, à l’exception de la question de l’appartenance puisqu’elle y est plus conflictuelle. Le narrateur, bien qu’il soit né dans la Vallée et s’y sente chez lui, ne sera jamais considéré par les autres enfants comme un des leurs parce que son père vient d’ailleurs. Dans cette première partie, le narrateur raconte « le monde des Plateaux » où il a grandi. À travers ses souvenirs d’enfance tantôt heureux, tantôt douloureux, il rapporte aussi quelques anecdotes concernant la vie de ses parents avant son arrivée. On remarque que ces romans, où les narrateurs replongent dans leur enfance, s’inscrivent sous le signe de la perte : ils racontent un lieu déserté, une famille éclatée, des amis perdus, bref un passé qui tend à s’effacer et qui menace de disparaître.
D’autres romans, surtout publiés après 2010, mélangent passé familial, souvenirs et histoire personnelle dans le présent de la narration. Les romans La fille de Coin-du-Banc (2014) de Marie-Ève Trudel Vibert et Philippe H. ou La malencontre (2015) de Mylène Fortin, par exemple, fonctionnent 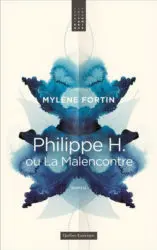 sur ce mode, les narratrices rattachant leur « folie » et leur histoire familiale. Enfin, que ces récits prennent l’une ou l’autre de ces formes, ils ont tous un point en commun, outre la nécessité de raconter pour survivre, celui de ne pas pouvoir exister en dehors du territoire gaspésien, à tel point qu’ils forcent plusieurs protagonistes exilés à y retourner, sans quoi il leur serait impossible de raconter leur histoire et celles de leurs proches.
sur ce mode, les narratrices rattachant leur « folie » et leur histoire familiale. Enfin, que ces récits prennent l’une ou l’autre de ces formes, ils ont tous un point en commun, outre la nécessité de raconter pour survivre, celui de ne pas pouvoir exister en dehors du territoire gaspésien, à tel point qu’ils forcent plusieurs protagonistes exilés à y retourner, sans quoi il leur serait impossible de raconter leur histoire et celles de leurs proches.
L’exploitation des pêcheurs gaspésiens par les Jersiais
L’exploitation des pêcheurs gaspésiens par les compagnies jersiaises jusque dans les années 1900 est un des principaux thèmes abordés dans les œuvres gaspésiennes. La belle embarquée (1994) de Sylvain Rivière et Noces de sable (1995) de Rachel Leclerc dénoncent, sous le couvert de la fiction, l’état de dépendance dans lequel était maintenue la population à l’époque où les Jersiais avaient le monopole de la morue. Ils montrent comment, aidés par les gouvernements et certains membres du clergé, les propriétaires des compagnies de pêche assujettissaient les habitants. En prenant le contrôle du commerce de détail, en étant les seuls employeurs de la région et en mêlant politique et intérêts personnels, les Jersiais avaient le pouvoir de soumettre entièrement les pêcheurs et leur famille à leur autorité.

 Dans Noces de sable, l’exploiteur prend le visage de Richard Thomas, riche propriétaire qui tient la population dans la misère et la pauvreté, alors que dans La belle embarquée, c’est Charles Robin qui occupe ce rôle. Ces deux personnages opèrent de la même façon : ils s’assurent que leurs engagés s’endettent toujours plus à chaque saison de pêche, les obligeant à acheter à crédit leur matériel, leurs denrées, leurs vêtements, etc., leur maigre salaire étant directement versé dans les comptes de la compagnie qui détient le magasin général. Pour ces hommes d’affaires, garder leur pouvoir sur le peuple gaspésien est simple : il suffit de le « tenir dans la misère, loin des écoles, de l’agriculture et de toute idée de progrès » (La belle embarquée). Ainsi ces romans montrent-ils par quels mécanismes politiques et économiques cette soumission a pu se transmettre de génération en génération, à une époque où les fils de pêcheurs doivent s’engager dès qu’ils sont en âge de prendre la mer pour rembourser les dettes familiales.
Dans Noces de sable, l’exploiteur prend le visage de Richard Thomas, riche propriétaire qui tient la population dans la misère et la pauvreté, alors que dans La belle embarquée, c’est Charles Robin qui occupe ce rôle. Ces deux personnages opèrent de la même façon : ils s’assurent que leurs engagés s’endettent toujours plus à chaque saison de pêche, les obligeant à acheter à crédit leur matériel, leurs denrées, leurs vêtements, etc., leur maigre salaire étant directement versé dans les comptes de la compagnie qui détient le magasin général. Pour ces hommes d’affaires, garder leur pouvoir sur le peuple gaspésien est simple : il suffit de le « tenir dans la misère, loin des écoles, de l’agriculture et de toute idée de progrès » (La belle embarquée). Ainsi ces romans montrent-ils par quels mécanismes politiques et économiques cette soumission a pu se transmettre de génération en génération, à une époque où les fils de pêcheurs doivent s’engager dès qu’ils sont en âge de prendre la mer pour rembourser les dettes familiales.
Certains personnages de ces romans vont se révolter contre les « maîtres ». C’est le cas des frères Foucault dans Noces de sable et de Tipon Barillôt dans La belle embarquée. Animés par un désir de vengeance, ils veulent se libérer de l’asservissement dans lequel ils sont plongés. Mais toute tentative pour se « mettre debout » devant l’exploitateur échoue. C’est le cas aussi dans Mademoiselle Personne (2008) de Marie Christine Bernard, alors que le capitaine Will McBearthy fonde une coopérative de pêcheurs à Sable-Rouge. Les Jersiais, qui détiennent le monopole des pêches, tentent par plusieurs moyens de le décourager et de faire peur à ceux qui s’engagent avec lui, d’abord par des menaces, ensuite par des gestes concrets : des pirates coulent le navire du capitaine McBearthy lors de sa première sortie en mer et personne ne survivra au naufrage. Ces trois histoires d’exploitation se terminent de la même manière : après avoir vidé la mer de ses poissons, les Jersiais partent et laissent derrière eux les Gaspésiens à bout de souffle.
Exode rural et expropriation
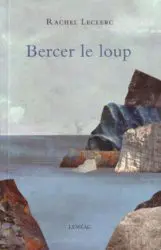
 Certains auteurs gaspésiens abordent la question des fermetures de villages qui ont eu lieu dans les années 1960 et 1970 en Gaspésie. Dans La sang-mêlé d’arrière-pays (1981), Réal-Gabriel Bujold expose les dessous de la fermeture d’un village fictif, Saint-Antoine-de-Ramelet, situé dans les terres gaspésiennes. Son narrateur montre les manigances des gouvernements pour forcer la population à quitter « ces petites colonies […] devenues inutiles et fort coûteuses pour l’État ». La procédure est la même partout : on relève le notaire, le médecin et le curé de leur fonction, on ferme les bureaux de poste et les écoles et on supprime les services publics. Coulées de Mahigan Lepage fait aussi référence aux fusions et aux fermetures de villages comme Saint-Alexis-de-Matapédia et Saint-Jean-de-Matapédia. Devant cette réalité, les familles s’exilent dans les grandes villes.
Certains auteurs gaspésiens abordent la question des fermetures de villages qui ont eu lieu dans les années 1960 et 1970 en Gaspésie. Dans La sang-mêlé d’arrière-pays (1981), Réal-Gabriel Bujold expose les dessous de la fermeture d’un village fictif, Saint-Antoine-de-Ramelet, situé dans les terres gaspésiennes. Son narrateur montre les manigances des gouvernements pour forcer la population à quitter « ces petites colonies […] devenues inutiles et fort coûteuses pour l’État ». La procédure est la même partout : on relève le notaire, le médecin et le curé de leur fonction, on ferme les bureaux de poste et les écoles et on supprime les services publics. Coulées de Mahigan Lepage fait aussi référence aux fusions et aux fermetures de villages comme Saint-Alexis-de-Matapédia et Saint-Jean-de-Matapédia. Devant cette réalité, les familles s’exilent dans les grandes villes.
La plupart des personnages de ces romans restent dans leur maison jusqu’à la fin, c’est-à-dire jusqu’à la date butoir, et s’organisent entre eux jusqu’à ce qu’il ne reste pratiquement plus personne dans les rangs. D’autres personnages, comme Marguerite dite Chicklet dans La sang-mêlé, voient enfin leur rêve de « sacrer leur camp » se réaliser. Séduits par les fausses promesses des agents expropriateurs, les habitants pensent trouver argent et confort en ville plutôt que pauvreté et misère dans leurs campagnes gaspésiennes. Ils laisseront derrière eux leur maison et leurs terres familiales, bref tout « c’que [leurs] ancêtres ont mis dé z’années à bâtir ». Et c’est précisément cette dernière idée, celle d’abandonner un patrimoine familial, qui nourrit la haine qu’entretiennent certains personnages à l’égard des gouvernements responsables des expropriations. À ce sujet, le roman Bercer le loup (2016) de Rachel Leclerc raconte l’expropriation de Forillon à travers l’histoire des Synnott. Janice, la petite-fille de Louis Synnott, entreprend de venger sa famille et de faire payer ceux qui avaient jadis mis le feu aux maisons de Forillon. Ce roman montre les injustices vécues par les expropriés et les traumatismes qui en découlent.
Enfin, ces romans mettent de l’avant le rapport d’inégalité entre les instances de pouvoir et la population gaspésienne. Toutes les décisions prises par les représentants de l’État dans ces histoires se font au détriment des Gaspésiens. On rase des forêts et des maisons pour améliorer le panorama offert aux touristes dans les parcs nationaux et on chasse les familles de leur demeure pour investir les fonds publics dans les grands centres. Et quoi qu’entreprennent les derniers enracinés, toute tentative d’avortement des plans des gouvernements échoue : la machine de l’expropriation est en marche… il est déjà trop tard.
Les soirées en famille et les fêtes entre voisins
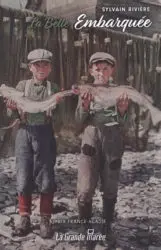 Un des thèmes qui revient dans les romans des auteurs gaspésiens est celui de la fête. Les traditions familiales et les célébrations – Noël, le jour de l’An, Pâques, les mariages, les baptêmes – se déroulent autour de la table : moules, homards, pâtés aux coques, langues de morue, galettes de mélasse, six-pâtes, œufs farcis, salades de macaronis, sandwichs pas de croûtes et mousses aux crevettes composent le menu des fêtes en famille. La fête prend aussi la forme de soirées où les voisins et amis se réunissent pour festoyer : feux de joie sur la grève, jeux de cartes, festivals, bénédiction des bateaux de pêche. Dans les romans où il est question de la dureté de la vie des habitants de la péninsule, comme dans La belle embarquée de Sylvain Rivière, les quelques rares rassemblements festifs donnent aux pêcheurs un moment de répit : « La musique, la bonne humeur générale, la danse permettaient d’oublier les fatigues éreintantes de la routine ». Durant ces soirées, où se côtoient violoneux et conteurs, on se raconte des légendes et des rumeurs de villages, des histoires de bateaux fantômes et d’ancêtres illustres. Pour les engagés de la Charles Robin Company et leur famille, les fêtes de Noël et du jour de l’An offrent un moment de repos et de joie « le temps de leur faire oublier et leurs crédits et leurs conditions d’esclaves ». Partager un moment de bonheur avec ceux qui vivent dans les mêmes conditions difficiles qu’impose la réalité saisonnière agit comme un baume.
Un des thèmes qui revient dans les romans des auteurs gaspésiens est celui de la fête. Les traditions familiales et les célébrations – Noël, le jour de l’An, Pâques, les mariages, les baptêmes – se déroulent autour de la table : moules, homards, pâtés aux coques, langues de morue, galettes de mélasse, six-pâtes, œufs farcis, salades de macaronis, sandwichs pas de croûtes et mousses aux crevettes composent le menu des fêtes en famille. La fête prend aussi la forme de soirées où les voisins et amis se réunissent pour festoyer : feux de joie sur la grève, jeux de cartes, festivals, bénédiction des bateaux de pêche. Dans les romans où il est question de la dureté de la vie des habitants de la péninsule, comme dans La belle embarquée de Sylvain Rivière, les quelques rares rassemblements festifs donnent aux pêcheurs un moment de répit : « La musique, la bonne humeur générale, la danse permettaient d’oublier les fatigues éreintantes de la routine ». Durant ces soirées, où se côtoient violoneux et conteurs, on se raconte des légendes et des rumeurs de villages, des histoires de bateaux fantômes et d’ancêtres illustres. Pour les engagés de la Charles Robin Company et leur famille, les fêtes de Noël et du jour de l’An offrent un moment de repos et de joie « le temps de leur faire oublier et leurs crédits et leurs conditions d’esclaves ». Partager un moment de bonheur avec ceux qui vivent dans les mêmes conditions difficiles qu’impose la réalité saisonnière agit comme un baume.
Dans Mademoiselle Personne de Marie Christine Bernard, on entend aussi le son des violons. Lors des soirées à la maison de la Pointe-à-Caillou, « on chantait, on buvait peu, on riait surtout, on riait beaucoup ». C’est le maire Bourgeois qui fournit à ses concitoyens l’alcool de contrebande lors de ces fêtes qui paraissent être des « parodie[s] de consolation ». Dans La fille de Coin-du-Banc de Marie-Ève Trudel Vibert, ces festivités en famille prennent aussi des airs de mascarade. La narratrice, Marine Harbour, prend part aux fêtes avec une « joie semi-déguisée » et ces moments semblent lui être bien plus imposés que souhaités : « En famille élargie, on ne regarde pas la dépense. Le fla-fla. On joue gros. Pour bien paraître. C’est pourquoi je laisse ma parenté envahir mon intérieur ». Quant à Ah, l’amour l’amour (1981) de Noël Audet, il oppose l’authenticité de la famille gaspésienne du narrateur et la fausseté des réunions de famille des bourgeois de la métropole. Chaque année, André et sa conjointe reçoivent à Petite-Matane la famille montréalaise d’Astrid et les fêtes de Noël se déroulent dans « le suave et l’exquis », alors que les célébrations du jour de l’An sont des « orgie[s] de chicanes et de ruptures sans retour jusqu’aux prochaines fêtes » où tout le monde boit trop, crie et sacre parce qu’« ils sont comme ça. Pour s’amuser, il leur faut marquer le coup par un événement historique qui laisse des traces ». Enfin, dans ces romans, toutes les scènes de fête, de quelque type soient-elles, viennent marquer une pause dans le quotidien des personnages gaspésiens et soulignent l’importance qu’occupent les traditions dans leur vie.ù
La mer et les paysages
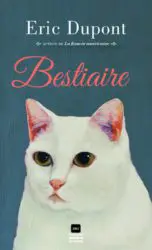 Les histoires des « romans gaspésiens » se passent entre la mer et les montagnes. Elles prennent principalement place dans deux endroits : au cœur des terres gaspésiennes et au bord de la mer. Le décor des terres se compose de roches, de montagnes, de forêts, de boisés, de champs et de bâtiments abandonnés. Par exemple, les romans La sang-mêlé d’arrière-pays de Réal-Gabriel Bujold et Bestiaire d’Éric Dupont se situent dans les campagnes de la Haute-Gaspésie. Les romans Voleurs de sucre de ce dernier auteur et Coulées de Mahigan Lepage se déroulent quant à eux dans la vallée de la Matapédia. Les voyages en autocar et en pick-up du narrateur de Lepage lui donnent l’occasion de décrire longuement les paysages de la vallée avec ses arbres, ses fermes, ses scieries, ses murs de roches, ses plateaux et ses rivières. Quant au narrateur de Bestiaire, il fait entendre aux lecteurs « la trame sonore [du] paysage » de Saint-Ulric composé des « chants de la mésange à tête noire, du bruant à gorge blanche, de la grive des bois et du grand-duc d’Amérique ».
Les histoires des « romans gaspésiens » se passent entre la mer et les montagnes. Elles prennent principalement place dans deux endroits : au cœur des terres gaspésiennes et au bord de la mer. Le décor des terres se compose de roches, de montagnes, de forêts, de boisés, de champs et de bâtiments abandonnés. Par exemple, les romans La sang-mêlé d’arrière-pays de Réal-Gabriel Bujold et Bestiaire d’Éric Dupont se situent dans les campagnes de la Haute-Gaspésie. Les romans Voleurs de sucre de ce dernier auteur et Coulées de Mahigan Lepage se déroulent quant à eux dans la vallée de la Matapédia. Les voyages en autocar et en pick-up du narrateur de Lepage lui donnent l’occasion de décrire longuement les paysages de la vallée avec ses arbres, ses fermes, ses scieries, ses murs de roches, ses plateaux et ses rivières. Quant au narrateur de Bestiaire, il fait entendre aux lecteurs « la trame sonore [du] paysage » de Saint-Ulric composé des « chants de la mésange à tête noire, du bruant à gorge blanche, de la grive des bois et du grand-duc d’Amérique ».
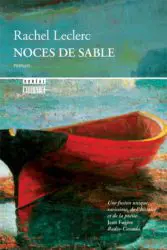 Les paysages de bord de mer sont les plus exploités dans les « romans gaspésiens ». Plusieurs récits s’inscrivent le long de la côte. Ces romans débordent d’échoueries, de marées, de caps, de ports, de campings, de falaises, d’anses, de baies, de barachois, de plages et de maisons dépareillées. Cette Gaspésie est bien sûr visuellement décrite, mais elle est aussi entendue, goûtée, sentie et touchée. Les personnages y sentent le vent, le soleil sur leur peau et le sable sous leurs pieds, y entendent la houle et les mouettes, y respirent l’odeur de varech, d’argile, d’algues et d’eau salée qui caractérise ce coin de pays. Le quotidien et le destin des personnages qui évoluent dans ces romans, comme dans Noces de sable de Rachel Leclerc et Mademoiselle Personne de Marie Christine Bernard, sont régis par la mer qui prend alors toute la place dans leur vie et dans le texte. En effet, la destinée des fils de pêcheurs, par exemple, est de suivre leur père en mer et celle des pêcheurs, d’y mourir noyés. Pourtant, ces hommes la connaissent par cœur : « Leur livre, c’est le ciel. Leur alphabet, c’est toutes les couleurs de la mer » (Mademoiselle Personne). Même s’ils peuvent détecter les tempêtes, aucun n’est à l’abri d’un naufrage parce que la mer n’épargne personne. Dans les romans, l’eau tue : la mer avale marins, femmes de pêcheurs et enfants. Souvent anthropomorphisée, la mer possède toutes les caractéristiques d’un personnage de fiction : elle parle, elle agit, elle possède des traits de caractère, elle remplit des fonctions précises. Elle personnifie souvent une figure maternelle, notamment dans Ah, l’amour l’amour et La fille de Coin-du-Banc, où elle met au monde les enfants, les berce et leur raconte des histoires pour les endormir avant, finalement, de les rappeler à elle. C’est précisément pour cette raison que plusieurs personnages gaspésiens la détestent.
Les paysages de bord de mer sont les plus exploités dans les « romans gaspésiens ». Plusieurs récits s’inscrivent le long de la côte. Ces romans débordent d’échoueries, de marées, de caps, de ports, de campings, de falaises, d’anses, de baies, de barachois, de plages et de maisons dépareillées. Cette Gaspésie est bien sûr visuellement décrite, mais elle est aussi entendue, goûtée, sentie et touchée. Les personnages y sentent le vent, le soleil sur leur peau et le sable sous leurs pieds, y entendent la houle et les mouettes, y respirent l’odeur de varech, d’argile, d’algues et d’eau salée qui caractérise ce coin de pays. Le quotidien et le destin des personnages qui évoluent dans ces romans, comme dans Noces de sable de Rachel Leclerc et Mademoiselle Personne de Marie Christine Bernard, sont régis par la mer qui prend alors toute la place dans leur vie et dans le texte. En effet, la destinée des fils de pêcheurs, par exemple, est de suivre leur père en mer et celle des pêcheurs, d’y mourir noyés. Pourtant, ces hommes la connaissent par cœur : « Leur livre, c’est le ciel. Leur alphabet, c’est toutes les couleurs de la mer » (Mademoiselle Personne). Même s’ils peuvent détecter les tempêtes, aucun n’est à l’abri d’un naufrage parce que la mer n’épargne personne. Dans les romans, l’eau tue : la mer avale marins, femmes de pêcheurs et enfants. Souvent anthropomorphisée, la mer possède toutes les caractéristiques d’un personnage de fiction : elle parle, elle agit, elle possède des traits de caractère, elle remplit des fonctions précises. Elle personnifie souvent une figure maternelle, notamment dans Ah, l’amour l’amour et La fille de Coin-du-Banc, où elle met au monde les enfants, les berce et leur raconte des histoires pour les endormir avant, finalement, de les rappeler à elle. C’est précisément pour cette raison que plusieurs personnages gaspésiens la détestent.
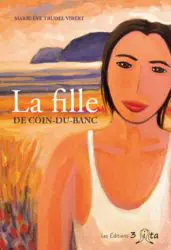 Ah, l’amour l’amour et Mademoiselle Personne montrent deux avenues possibles dans pareille situation : ou bien la réconciliation avec la mer est possible ou bien aucune réparation n’est offerte au personnage principal. Pour Céleste Dugas, la mer, qu’elle aimait tant jadis, l’a trahie en emportant dans ses eaux son père, son amant, son fils et jusqu’à son nom : « […] ce que j’étais avant, c’est mort. Tout ce que j’étais, la mer me l’a pris. Mon nom c’est Personne ». Incapable de lui pardonner ces trahisons, elle se jette en bas du cap de la Pointe-à-Caillou, là où elle allait engueuler la mer les soirs de beuverie. Quant à André Loubert, c’est à travers le regard de sa nouvelle amie de cœur qu’il arrive à aimer la mer de nouveau, après qu’elle lui a pris sa fille cadette des années plus tôt : « […] l’eau nous submerge un instant comme si nous jouions à la noyade, mais je n’ai plus peur. Je me réconcilie lentement avec la mer ». Enfin, dans cette Gaspésie romanesque, les couleurs du paysage et la vie des habitants sont réglées au rythme des saisons.
Ah, l’amour l’amour et Mademoiselle Personne montrent deux avenues possibles dans pareille situation : ou bien la réconciliation avec la mer est possible ou bien aucune réparation n’est offerte au personnage principal. Pour Céleste Dugas, la mer, qu’elle aimait tant jadis, l’a trahie en emportant dans ses eaux son père, son amant, son fils et jusqu’à son nom : « […] ce que j’étais avant, c’est mort. Tout ce que j’étais, la mer me l’a pris. Mon nom c’est Personne ». Incapable de lui pardonner ces trahisons, elle se jette en bas du cap de la Pointe-à-Caillou, là où elle allait engueuler la mer les soirs de beuverie. Quant à André Loubert, c’est à travers le regard de sa nouvelle amie de cœur qu’il arrive à aimer la mer de nouveau, après qu’elle lui a pris sa fille cadette des années plus tôt : « […] l’eau nous submerge un instant comme si nous jouions à la noyade, mais je n’ai plus peur. Je me réconcilie lentement avec la mer ». Enfin, dans cette Gaspésie romanesque, les couleurs du paysage et la vie des habitants sont réglées au rythme des saisons.
Il ressort des « romans gaspésiens » le rapport affectif qu’entretiennent les personnages vis-à-vis du territoire. Pour eux, la Gaspésie recèle nombre de promesses, de souvenirs, de traditions, d’épreuves, de déceptions et de malheurs. Qu’il soit natif de la région ou qu’il vienne d’ailleurs, aucun personnage n’est indifférent devant la force du vent, la grandeur des montagnes et l’immensité de la mer.
Ouvrages évoqués dans l’article :
Noël Audet, Ah, l’amour l’amour, Quinze, 1981.
Noël Audet, Quand la voile faseille, Hurtubise, 1980.
Marie Christine Bernard, Mademoiselle Personne, Hurtubise, 2008.
Réal-Gabriel Bujold, La sang-mêlé d’arrière-pays, Leméac, 1981.
Éric Dupont, Voleurs de sucre, Marchand de feuilles, 2004.
Éric Dupont, Bestiaire, Marchand de feuilles, 2008.
Mylène Fortin, Philippe H. ou La malencontre, Québec Amérique, 2015.
Rachel Leclerc, Noces de sable, Boréal, 1995.
Rachel Leclerc, La patience des fantômes, Boréal, 2011.
Rachel Leclerc, Bercer le loup, Leméac, 2016.
Mahigan Lepage, Coulées, Mémoire d’encrier, 2012.
Sylvain Rivière, La belle embarquée, D’Acadie, 1992.
Marie-Ève Trudel Vibert, La fille de Coin-du-Banc, 3 sista, 2014.
EXTRAITS
Raconter
Je glanais des informations ici et là, essayant de reconstituer l’histoire avec des morceaux de trame qu’on voulait bien me fournir. Et conscient, bien entendu, qu’il y a toujours une part de mensonge dans ce genre de récit. On invente, on brode, on enjolive.
Marie Christine Bernard, Mademoiselle Personne, p. 47-48.
L’exploitation des pêcheurs gaspésiens par les Jersiais
Pour la première fois j’ai vu le monde tel qu’il lui avait été offert, la chair modeste des poissons, froide dans la mer de septembre, les abdications, les confessions, le chantage, les promesses de servitude, les X pâles au bas des papiers, les signatures accablantes qui engagent toute une descendance, un tas d’immondices dans un palais doré, le troc du cœur pour une maison pleine de trous, même pas une maison, une cabane étriquée, un squelette de bois.
Rachel Leclerc, Noces de sable, p. 148.
Exode rural et expropriation
Puis, un bon matin, – c’est comme en expropriation – un orage coupe l’électricité, le téléphone et les routes. On ne répare plus rien, ni le lendemain, ni l’autre, ni jamais, ni plus tard encore moins.
Réal-Gabriel Bujold, La sang-mêlé d’arrière-pays, p. 236.
Les soirées en famille et les fêtes entre voisins
Le rang Saint-Jean était peuplé de maisons amies. On y allait souvent, avec ma mère, mon père et ma sœur. Il y avait des fêtes. Les adultes parlaient fort, riaient et fumaient. Nous, les enfants, nous explorions les recoins et les verticales, les caves et les greniers. […] C’était l’époque où nous étions encore nombreux. Dans les maisons du rang Saint-Jean, les soirs de fête, on était enveloppé, au chaud. On se sentait appartenir.
Mahigan Lepage, Coulées, p. 32-33.
La mer et les paysages
C’est ça la mer, Astrid, une merde, un engrais, une richesse peut-être, un monstre indomptable en tout cas. Et ne me parle plus de ton père qui rêvait de mourir à la mer, comme un bourgeois, encore s’il avait dit en mer ! comme un marin.
Noël Audet, Ah, l’amour l’amour, p. 43.
Qu’il était fier, beau et grand, le pays réinventé dans toute sa plénitude de falaises et d’échancrures gossées au couteau d’un sculpteur de talent, depuis la pointe Navarre jusqu’à Gachepé, littoral d’anses, de baies et de montagnes sans fin, habité d’oiseaux curieux escortant les navires comme s’ils étaient les maîtres du continent.
Sylvain Rivière, La belle embarquée, p. 39.










