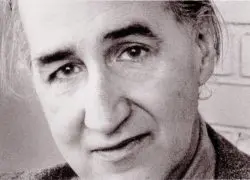Trois recueils de contes qui sont aussi trois des plus grands livres de l’histoire de la littérature québécoise sont issus de la Gaspésie, ont trouvé leur inspiration dans cette région maritime : Contes pour un homme seul (1944) d’Yves Thériault, puis Contes du pays incertain (1962) et Contes anglais (1964) de Jacques Ferron1.
 Victor-Lévy Beaulieu observait il y a vingt ans : « Dans Rosaire, Jacques Ferron a écrit : ‘C’est dans la topographie qu’un récit, fictif ou non, trouve son assiette. Sans elle, il s’éparpille et perd de sa cohésion naturelle.’ C’est une petite phrase qui a l’air de rien, mais qui est pourtant d’une extrême importance, aussi bien pour l’œuvre de Ferron que pour l’œuvre de Thériault2 ». Chez Ferron – car c’est de lui que je parlerai ici –, la phrase nous ramène aux contes que l’auteur commence à écrire dès les années 1940.
Victor-Lévy Beaulieu observait il y a vingt ans : « Dans Rosaire, Jacques Ferron a écrit : ‘C’est dans la topographie qu’un récit, fictif ou non, trouve son assiette. Sans elle, il s’éparpille et perd de sa cohésion naturelle.’ C’est une petite phrase qui a l’air de rien, mais qui est pourtant d’une extrême importance, aussi bien pour l’œuvre de Ferron que pour l’œuvre de Thériault2 ». Chez Ferron – car c’est de lui que je parlerai ici –, la phrase nous ramène aux contes que l’auteur commence à écrire dès les années 1940.
En mai 1942, quand paraît son premier conte dans la revue Amérique française, Ferron est étudiant à la Faculté de médecine de l’Université Laval. En juillet 1945, après avoir reçu son diplôme, il est mobilisé dans les forces armées du Canada (il changera d’affectation huit fois en un an). À son retour à la vie civile, il choisit de s’installer en tant que médecin à Petite-Madeleine, puis à Rivière-Madeleine, en Gaspésie. Dans les faits, le médecin Ferron couvre un territoire large d’une centaine de kilomètres, qu’il parcourt hiver comme été dans des conditions souvent éreintantes. Il n’y sera que deux ans, mais ce sont des années qui comptent, où à l’apprentissage de la littérature s’ajoute celui de la politique.
Spécialisé dans les accouchements à domicile, il vit au contact d’une population pauvre et pittoresque qui l’enchante. Parfois, l’accouchement prenait des heures, une nuit entière ; alors par respect pour le médecin, on passait le temps en lui racontant des histoires. « En Gaspésie, ajoute Ferron, il n’y avait pas d’électricité : ça favorisait la veillée. La veillée favorise la parole et le conte, parce qu’on ne peut pas faire autre chose, surtout quand il n’y a pas de télévision ou de radio. » Ferron est fasciné par le riche langage vernaculaire des Gaspésiens et leur art de raconter. Dans une certaine mesure, ce séjour gaspésien le libère de la formation livresque acquise au collège Jean-de-Brébeuf et lui permet de renouer avec l’univers populaire que, plus jeune, il aimait. Ferron avait d’abord été méfiant à l’endroit du régionalisme, car il était un élément central de l’idéologie groulxienne, et donc un aspect indissociable de la vision cléricale du pays qu’il contestait. Il lui aura fallu vivre en Gaspésie pour pouvoir se déprendre de cette idéologie et apprendre ce qu’était vraiment la vie rurale. Bref, il lui fallait passer de la théorie à la pratique et, du coup, assimiler une langue orale qu’il aura su mettre à sa main par l’écriture de ses contes.
Le style de Ferron peut être déconcertant ; c’est simplement qu’il a une écriture bien à lui, imagée et ironique, elliptique, aux sujets toujours étonnants, une écriture allusivement grivoise, d’allure juvénile mais farcie de sagesse, et qui a plus d’un tour dans son sac. « Une fâcheuse compagnie » est un de ses contes les plus fameux, dont l’anecdote est d’ailleurs authentique. Il relate comment le médecin Ferron, sur le chemin de la maison où il est attendu, dans le village de Saint-Yvon, n’arrive pas à se défaire de cochons qui le suivent comme s’ils l’accompagnaient. Quant au conte « Les Méchins », qui met en scène un médecin faisant preuve de compassion pour un cheval misérable, il pourrait métaphoriser, selon Marcel Olscamp3, l’engagement de Ferron envers les démunis. D’un autre ton, « Le chien gris » relève en quelque sorte d’un certain folklore canadien-français : une fille de Grand-Étang aurait été mise enceinte par un loup-garou. La mer est parfois envahissante, puissante. C’est elle que, dans « Les cargos noirs de la guerre », une veuve condamnée à la solitude fixe toute sa vie, espérant apercevoir le bateau qui ramènerait son fils parti faire la guerre. « Son réduit n’avait qu’une fenêtre du côté de la mer. Quand elle y regardait, il arrivait par temps clair que le verre collât à l’espace et que la masse immense de cette fusion la pénétrât de l’horizon jusqu’au fond des yeux. » Cette belle image, on la retrouve dans le magnifique conte qu’est « Le paysagiste » : « un paresseux doublé d’un simple d’esprit » est happé par la grandeur du paysage, où le ciel descend vers la mer et la mer monte vers le ciel. Dans son village de montagnes et de couleurs, « disposé vers la mer comme au théâtre », le paysagiste peint sur le jour, suivant du regard le déploiement des couleurs et des aspérités de la réalité au fil du temps qui passe ; esquisse d’un jour à recommencer le lendemain, indéfiniment. Ailleurs, dans « La corde et la génisse », le curé Godfrey et le marchand Bezeau se sont fait voler qui la corde rattachée au clocher de l’église, qui une génisse si « dévotionneuse » qu’on dirait « presque une enfant de Marie ». Le curé finit par comprendre que le capitaine de la goélette avait demandé au neveu de la servante de lui amener une « génisse ». Dans son sermon du dimanche, le curé condamne furieusement le « taureau noir » qu’est le capitaine, mais le neveu est épargné par sa naïveté, laquelle fait qu’il peut être considéré comme « un vrai catholique et un bon Gaspésien ». Cette pirouette rhétorique, qui dédommage en se moquant, est tout à fait caractéristique de l’humour de l’écrivain.
Ces deux années gaspésiennes vont accompagner toute l’œuvre narrative à venir de Ferron, des contes au roman La chaise du maréchal ferrant (1972) et au récit Gaspé-Mattempa (1980), et avant cela les nombreuses évocations régionalistes des Historiettes (1969). Le conte, chez Ferron, c’est une esthétique. « Le conte pour moi est quelque chose de très sérieux, de très significatif et de plus vrai que la réalité. Il fait partie du monde de l’aveu, comme au théâtre. Je me suis trouvé en Gaspésie avec un groupe qui venait des vieilles paroisses. C’est en fréquentant le peuple que j’ai appris : je ne crois pas beaucoup aux élites. Un personnage devient intéressant pour autant qu’il est accepté par le peuple, qui le raconte à sa façon. » Et l’essayiste Jean Marcel4 croyait avec raison que toute l’œuvre de Ferron relevait du conte, à la fois par la manière et par la matière, c’est-à-dire parce que le conte relève de la tradition orale, et que cette tradition, disait Ferron, « est l’expression de la mémoire collective ». Cette oralité est logée chez le conteur cartographe à l’enseigne du pays incertain, à l’intérieur des formes neuves du passé ; formes créatives de cet « éblouissement » dont parle Victor-Lévy Beaulieu (dans la préface à l’édition de la Bibliothèque québécoise), pour qui les contes de Ferron « révélai[en]t le pays et ce qu’on trouve du pays quand les mots, pour être enfin habités, il est possible de parler de lui au nom de la plus haute autorité ».
1. Ces deux recueils de Jacques Ferron et quelques inédits sont réunis dans Contes, Bibliothèque québécoise, Montréal, 1999, 298 p.
2. Victor-Lévy Beaulieu, Un loup nommé Yves Thériault, Trois-Pistoles, Trois-Pistoles, 1999, p. 73.
3. Marcel Olscamp, Le fils du notaire. Jacques Ferron, 1921-1949 : genèse intellectuelle d’un écrivain, Fides, Montréal, 1997, p. 346.
4. Jean Marcel, Jacques Ferron malgré lui, réédition revue et augmentée, Presses de l’Université Laval, Québec, 2013 [1970], 230 p.
EXTRAIT
La Mi-Carême, en Gaspésie, a remplacé les Sauvages devenus très fatigués et très vieux ; elle personnifie l’accouchement, qui bouleverse toujours un peu la maison, et permet de l’expliquer aux non-initiés, du moins d’en rendre compte. Par exemple, lorsque les enfants, qu’on avait envoyés pour la circonstance chez le voisin, reviendront chez eux, la sage-femme leur dira : « Ne touchez pas à votre mère : la Mi-Carême l’a battue. » Cette façon de s’exprimer, correcte et efficace, donne lieu à la rencontre de deux personnages, l’un réel, la sage-femme, et l’autre imaginaire, la Mi-Carême, qui se donnent la main et se complètent, l’un garant de l’autre. C’est aussi que le conte est intimement lié à la réalité et qu’on peut le concevoir comme un moyen d’expression à la fois audacieux et décent.
« La sorcière et le grain d’orge », Contes, Bibliothèque québécoise, 1999, p. 277.