Parlez-vous français ? La réponse à cette question va de soi, direz-vous, puisque vous lisez ces lignes. Mais quel français parlez-vous ?
Parce qu’il faut savoir que la langue évolue et diffère, ce que les linguistes scandent en chœur depuis des années. À travers le temps, d’une part, les situations et les lieux – c’est sa variation diatopique, dit-on –, d’autre part. Source inépuisable de griefs, cette dimension variationnelle a causé et continue de causer des maux de tête aux puristes de ce monde, tout comme à ceux qui subissent les contrecoups de leur discours. Or, s’il est admis que le français est en transformation constante, peut-on en dire autant des opinions, dépréciatives surtout, que l’on émet sur lui ?
Les français d’ici et d’ailleurs
Ces jugements de valeur qui flottent, sans âge, parmi le discours social, sont l’un des effets collatéraux du lutétiotropisme, mot savant employé pour désigner la puissance attractive de Paris comme centre politique et culturel de la francophonie et, conséquemment, comme référence du français normatif. Plusieurs locuteurs francophones, à un moment ou à un autre de leur vie, se tournent vers ce modèle pour évaluer la conformité de leurs pratiques linguistiques. Pour peu que l’on s’éloigne de ce centre à partir duquel rayonne le bon usage, l’on trouvera toutefois nombre de français qui ne lui correspondent qu’imparfaitement.
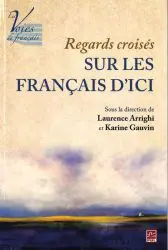 Dans Regards croisés sur les français d’ici1, Michel Francard répertorie quatre conséquences de cette forte centralisation de la norme : la sujétion au modèle français (ou parisien), l’autodépréciation (marque de la fameuse insécurité linguistique) et ses concomitantes stratégies de compensation, ainsi que le discours alarmiste des « clercs » quant à l’avenir compromis du français, une rengaine que le Québec connaît bien.
Dans Regards croisés sur les français d’ici1, Michel Francard répertorie quatre conséquences de cette forte centralisation de la norme : la sujétion au modèle français (ou parisien), l’autodépréciation (marque de la fameuse insécurité linguistique) et ses concomitantes stratégies de compensation, ainsi que le discours alarmiste des « clercs » quant à l’avenir compromis du français, une rengaine que le Québec connaît bien.
Dirigé par Laurence Arrighi et Karine Gauvin, professeures à l’Université de Moncton, ce collectif regroupe, outre celui de Francard, une dizaine de textes sur le thème « Les français d’ici », selon l’intitulé du colloque international tenu depuis cinq ans et dont cet ouvrage, une collection d’actes, est tiré. L’origine scientifique des articles ne fait d’ailleurs pas de doute à la lecture de certains des titres proposés : « L’assibilation des occlusives /t/ et /d/ en français parlé au Nouveau-Brunswick : un nouveau regard sur la question » (Cichocki et Perreault) et « La variation dans les formes quand / quand queen français acadien du nord-est du Nouveau-Brunswick : 1882-1968 » (Beaulieu et Cichocki) en sont de bons exemples.
Si ces contributions, qui ont pour caractéristique d’ausculter le français dans une optique différentielle, sont destinées à un public spécialisé, quelques-unes traitent de sujets accessibles au commun des lecteurs. Parmi celles-ci, retenons l’étude lexicographique des diatopismes nord-américains d’Hélène Labelle, qui montre que le dictionnaire en ligne Usitosubstitue à la norme exogène française la norme endogène québécoise, bien qu’il laisse une place de plus en plus significative aux autres variétés de français nord-américaines (acadienne, notamment). Ou cette analyse fascinante d’André Thibault sur le discours épilinguistique tenu par Jean-Baptiste Labat, père dominicain, et Pierre Dessalles, riche béké instruit de la Martinique, sur les langues parlées en terres caraïbes, tantôt qualifiées de baragouin ou de jargon, tantôt de langage nègre ou de créole.
Les états de langue et les idées reçues
Non pas LE français, mais LES français : voilà ce que suggère de part en part Regards croisés sur les français d’ici. Une fois cette précieuse mise au point admise, plusieurs critiques à l’endroit de la langue parlée au Québec se disqualifient d’elles-mêmes. Et pourtant, avec tous les états d’âme qu’il suscite, il est un sport national – certains le diront périlleux –, qui soulève ici les passions au moins autant que le hockey, et ce, depuis plus longtemps encore : parler de langue, avance Marty Laforest, est sans contredit l’une des activités préférées des Québécois, avec tout ce que cela implique de partisanerie et de contemption.
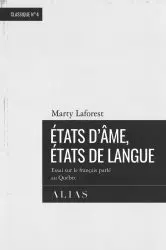 Au début de 2018 paraissait, préfacée par Louis Cornellier, la seconde réédition d’États d’âme, états de langue. Essai sur le français parlé au Québec2, bref mais non moins percutant essai de la linguiste rédigé à l’origine (1996) en réponse à l’acrimonieux Anna braillé ène shot, un pamphlet dans lequel Georges Dor défend la thèse suivante : le français parlé au Québec n’est pas une langue, mais au mieux un sabir sibyllin frappé d’incohérence. On voit que la position de Dor, adoptée il y a plus de vingt ans, pourrait bien être celle de quelque chroniqueur de quotidien contemporain. À ce compte, on dira que plus cela change, plus c’est en réalité pareil.
Au début de 2018 paraissait, préfacée par Louis Cornellier, la seconde réédition d’États d’âme, états de langue. Essai sur le français parlé au Québec2, bref mais non moins percutant essai de la linguiste rédigé à l’origine (1996) en réponse à l’acrimonieux Anna braillé ène shot, un pamphlet dans lequel Georges Dor défend la thèse suivante : le français parlé au Québec n’est pas une langue, mais au mieux un sabir sibyllin frappé d’incohérence. On voit que la position de Dor, adoptée il y a plus de vingt ans, pourrait bien être celle de quelque chroniqueur de quotidien contemporain. À ce compte, on dira que plus cela change, plus c’est en réalité pareil.
Laforest s’affaire précisément à démonter ce genre de jugements à l’emporte-pièce. Excellente vulgarisatrice, elle démêle habilement ce qui, dans le débat linguistique, relève de l’opinion (états d’âme) de ce qui se rapporte aux faits (états de langue). À vocabulaire pauvre, pensée confuse ; la langue des Québécois en est une déstructurée, désossée, victime de scoliose syntaxique ; l’éducation réussit de moins en moins à former les jeunes à la maîtrise de la langue : autant de poncifs qui feront l’objet d’un recadrage, seront déconstruits ou relativisés, mais dans tous les cas passés au crible d’une relecture éclairée et éclairante.
C’est à ce même genre d’entreprise que Benoît Melançon prête sa voix dans Le niveau baisse ! (et autres idées reçues sur la langue)3. Avec l’humour et la finesse qu’on lui connaît, ce qui ne gâte rien, le professeur en études littéraires s’adonne au déboulonnage de croyances tenaces issues de la mythologie populaire sur la langue. Quelques articles de son blogue L’Oreille tendues’y retrouvent, parmi une sélection de courtes interventions critiques réfutant chaque fois une idée reçue.
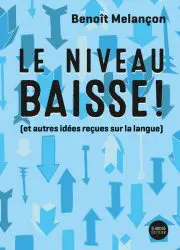 Les Québécois parlent-ils franglais ? Que non, de régler l’auteur, pas plus qu’ils ne parlent québécois : les habitants du Québec parlent une variété régionale du français, respectent les règles syntaxiques en vigueur dans le reste de la francophonie, lesquelles ont une valeur linguistique fondatrice. Le niveau baisse-t-il ? Il faudrait d’abord savoir ce qu’implique une affirmation aussi imprécise. Est-il question d’orthographe ? De syntaxe ? De lexique ? Qui plus est, faute de données comparables, difficile de trancher.
Les Québécois parlent-ils franglais ? Que non, de régler l’auteur, pas plus qu’ils ne parlent québécois : les habitants du Québec parlent une variété régionale du français, respectent les règles syntaxiques en vigueur dans le reste de la francophonie, lesquelles ont une valeur linguistique fondatrice. Le niveau baisse-t-il ? Il faudrait d’abord savoir ce qu’implique une affirmation aussi imprécise. Est-il question d’orthographe ? De syntaxe ? De lexique ? Qui plus est, faute de données comparables, difficile de trancher.
D’ailleurs, les résultats d’une enquête belge sur la perception qu’ont les locuteurs de l’évolution de leur langue indiquent une étrange tendance, fort éloquente dans le contexte. De façon générale, les personnes sondées conviennent que la langue dépérit, mais croient en même temps mieux la maîtriser que leurs parents. Conclusion : « [s]i on prend les individus isolément », résume Melançon, « le niveau monte […] ; si on les prend globalement, en additionnant les individus, il doit monter aussi ; en affirmant, dans le même temps, que le niveau baisse, les individus sondés laissent entendre que c’est le niveau des autres, jamais le leur, qui baisse4». Mais voilà, les Belges parlent toujours français, ni plus ni moins que les Québécois, malgré ce niveau prétendument en baisse depuis des siècles, malgré leur « bouche molle » et les « défauts » de prononciation, et malgré la survivance de tous ces -ismesqu’ils continuent d’utiliser.
L’anglicisme, voilà l’ennemi !
Michel Francard évoquait comme stratégie compensatoire, destinée à combler l’écart à la norme hexagonale, tout le soin employé à détecter puis à corriger les « -ismes honteux » tels que, dans le cas belge qui le retient, les belgicismes, flandricismes et wallonismes. Au Québec, on a fait peu de cas de la plupart de ces -ismes, tout consacrés qu’étaient généralement les douaniers de la langue à refouler l’invasion d’un seul ennemi envers lequel il fallait faire front commun : l’anglicisme. Depuis aussi loin que 1840, date de ratification de l’Acte d’Union qui vient fragiliser la présence francophone en terre d’Amérique, l’intrusion de l’anglais dans le français a en effet été abondamment décriée, ferveur zélote à l’appui, comme s’il s’agissait alors de combattre la présence anglaise elle-même.
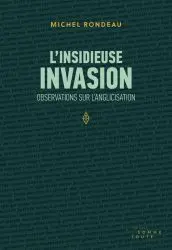 Avec L’insidieuse invasion. Observations sur l’anglicisation5, Michel Rondeau, concepteur-rédacteur publicitaire de profession, ajoute son nom à une longue lignée de vaillants pourfendeurs d’anglicismes. Le point de départ de cette traque, patiente et minutieuse, est encore une fois ce constat de la déliquescence du français, gangrené qu’il est par la prolifération de corps linguistiques étrangers, non seulement suspects, mais, semble-t-il, hautement dangereux. Or, inquiétants, ils le paraissent effectivement, vu leur nombre élevé et les subtiles techniques de camouflage adoptées pour assiéger le français d’ici : leurs formes les plus connues sont les emprunts (mots importés tels quels), les calques (traductions littérales de mots ou d’expressions) et les faux amis (le sens d’un terme anglais attribué à un mot français).
Avec L’insidieuse invasion. Observations sur l’anglicisation5, Michel Rondeau, concepteur-rédacteur publicitaire de profession, ajoute son nom à une longue lignée de vaillants pourfendeurs d’anglicismes. Le point de départ de cette traque, patiente et minutieuse, est encore une fois ce constat de la déliquescence du français, gangrené qu’il est par la prolifération de corps linguistiques étrangers, non seulement suspects, mais, semble-t-il, hautement dangereux. Or, inquiétants, ils le paraissent effectivement, vu leur nombre élevé et les subtiles techniques de camouflage adoptées pour assiéger le français d’ici : leurs formes les plus connues sont les emprunts (mots importés tels quels), les calques (traductions littérales de mots ou d’expressions) et les faux amis (le sens d’un terme anglais attribué à un mot français).
La nomenclature est longue des termes et formulations fautifs recensés dans cet ouvrage pensé en fonction des principaux domaines visés par cette invasion (le commerce, les arts et spectacles, l’informatique, etc.). Aussi le lecteur doit-il s’armer de patience, malgré tous les brillants efforts de Rondeau et quelques effets de toge bien sentis, devant une démonstration qui s’étire aussi longtemps que perdure la forme du dictionnaire commenté. Il ne fait donc pas de doute que là où il devient le plus stimulant de lire l’auteur, c’est lorsqu’il s’adonne à l’essai. Cela dit, intéressant ne signifie pas nécessairement convaincant, tant s’en faut. Ainsi, à la question de savoir en quoi et pourquoi ces calques seraient en définitive si néfastes, en quoi et pourquoi l’usage de bon matin(calque de good morning) ou de bienvenue(calque de you’re welcome) serait aussi indécent, l’argument du triomphe de ce fumeux « génie » de l’anglais, pour le moins vague et poussiéreux, laisse perplexe.
La remarque vaut pour cette vision monolithique de l’Amérique étatsunienne que colporte l’essayiste, comme s’il n’en sortait que de la junkculture à laquelle personne ne s’opposerait, vecteur d’une pensée unique, unilatéralement néolibérale, en passe de s’imposer au monde entier. Et, inversement porté aux nues, le français n’en subit pas moins, beau paradoxe, une proportionnelle réduction à la pensée unique, considérée cette fois comme tout à fait souhaitable : « c’est qu’au-delà des mots », lit-on, « dans sa façon de dire, de représenter les choses, d’être organisé, agencé, rythmé le français – comme toute langue –, constitue une manière différente, unique, de voir le monde. Et cette dynamique qui lui est propre […], elle est précieuse justement à cause de son caractère unique6». C’est là en revenir à une conception extrêmement rigide et uniforme de la langue. Qu’un Québécois converse seulement avec un Sénégalais et il remettra bien vite en doute la soi-disant unicité de cette vision du monde attribuable à une langue, c’est-à-dire LE français.
Il va de soi que beaucoup de conviction ne remplace pas une argumentation solide, plus subtile, bien que cela ait le mérite d’offrir, durant ces passages particulièrement incisifs, une lecture séduisante, et ce, que l’on soit pour ou contre les positions de Rondeau. En alimentant le débat sur la langue, son ouvrage, nonobstant sa lecture parfois longue, donne donc matière à réfléchir, ce qui n’est pas la moindre de ses qualités. De quoi assurer la vitalité de notre sport national, le seul d’ailleurs où les arbitres sont peut-être aussi nombreux que les joueurs.
1. Sous la dir. de Laurence Arrighi et Karine Gauvin, Regards croisés sur les français d’ici, Presses de l’Université Laval, Québec, 2018, 265 p. ; 35 $.
2. Marty Laforest, États d’âme, états de langue. Essai sur le français parlé au Québec, Alias, Montréal, 2018, 113 p. ; 12,95 $.
3. Benoît Melançon, Le niveau baisse ! (et autres idées reçues sur la langue), Del Busso, Montréal, 2015, 118 p. ; 14,95 $.
4. Benoît Melançon, Le niveau baisse !,p. 21.
5. Michel Rondeau, L’insidieuse invasion. Observations sur l’anglicisation, Somme toute, Montréal, 2018, 350 p. ; 29,95 $.
6. Michel Rondeau, L’insidieuse invasion, p. 34.
EXTRAITS
La variation géographique n’a pas eu bonne presse dans le monde francophone jusqu’à une époque récente. À l’instar d’autres types de variations, eux aussi largement décriés, comme la variation sociale ou stylistique, cette variation géographique a très tôt été perçue comme particulièrement néfaste pour un usage « correct » du français.
Michel Francard, « Le français d’iciest-il du français ? », dans Laurence Arrighi et Karine Gauvin (dir.), Regards croisés sur les français d’ici,p. 253.
Il n’y a pas, en matière de langue, un avant édénique, aux bornes chronologiques jamais définies, et un après infernal (maintenant). Il faut nuancer ce genre d’affirmations sur plusieurs plans.
Benoît Melançon, Le niveau baisse ! (et autres idées reçues sur la langue), p. 18.
En fait, le Québec, dans sa hantise de l’assimilation, souffre de correctionnite aiguë. Dans sa poursuite obsessionnelle de la faute, le moindre écart par rapport à la norme étant toujours perçu comme le symptôme annonciateur de la mort prochaine du français en Amérique, le Québécois identifie comme des tares des emplois séculaires, aussi français que Shakespeare est anglais.
Marty Laforest, États d’âme, états de langue. Essai sur le français parlé au Québec, p. 105.
Il ne s’agit pas de démoniser l’anglo-américain, mais plutôt de ne pas minimiser l’importance de ce que cette langue, comme support et même fer de lance de cette pensée unique, est en train d’instiller puis d’installer dans les esprits. Parce que l’enjeu qui est en train de se dessiner, quel est-il sinon, après l’assujettissement économique et politique, l’asservissement intellectuel par une grande opération d’homogénéisation ?
Michel Rondeau, L’insidieuse invasion. Observations sur l’anglicisation, p. 292.










