Romancier, poète, conteur, essayiste et chroniqueur littéraire, Yvon Paré quitte Montréal en 1972 après des études universitaires en lettres pour revenir s’installer à La Dorée, son village natal situé dans le haut du Lac-Saint-Jean. Après plus d’une douzaine de publications, dont cinq romans, deux essais, un recueil de poésie et trois récits de voyage écrits en collaboration avec Danielle Dubé, il revient sur son parcours d’écrivain, ses obsessions et ses craintes dans son plus récent livre, L’enfant qui ne voulait plus dormir.
Écrire le pays
Comme son personnage de poète dans Anna-Belle, Yvon Paré rentre chez lui après trois ans dans la métropole, son premier recueil L’octobre des Indiens sous le bras. Inspiré par ses lectures d’œuvres québécoises et par Jean Giono, en qui il trouve un maître, Paré sait dorénavant qu’il est possible de parler dans ses livres du pays de ses ancêtres, celui « de bouleaux et de pins et de fougères au bas des montagnes ». Dans un entretien publié dans Lettres québécoises, il confie à Christiane Laforge, à propos de la littérature d’ici : « Ça m’a donné le droit de devenir écrivain en parlant de mon territoire, de ma géographie et des gens de ma famille. Ces écrivains-là m’ont ramené vers le Québec ». De retour à La Dorée, voulant « tout dire et tout révéler » de son village et de sa famille, il entreprend d’écrire une saga familiale qu’il imagine sur quelque deux mille pages.
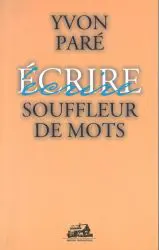 Une dizaine de romans sur trois générations, tel est le projet qu’il entame avec Le violoneux et La mort d’Alexandre, suivi des Oiseaux de glace. Dans un style réaliste, proche de l’oralité, Paré y raconte la mort de son père et le travail forestier, « la colère, les cris et les jurons » de ses oncles et frères bûcherons. Ces romans « rongés par une grande misère morale et physique », comme les qualifie leur auteur, ne font pas l’unanimité parmi les critiques, et si une recension ne tue pas un écrivain, comme le dit Paré, elle peut certainement le paralyser : « Monsieur Réginald [Martel] n’a fait que me donner une petite poussée et j’ai basculé. Alors est venue l’aventure des carnets. Avant, j’écrivais mes romans comme des documentaires, me contentant d’être fidèle à la réalité, au vécu de ma famille, puisant dans ces secrets que personne ne veut entendre ». Mais s’il laisse tomber sa saga à la suite de cette mauvaise critique publiée dans La Presse, Paré n’en cesse pas moins d’écrire : des nouvelles, des récits de voyage, des réflexions sur le Québec et des essais. Dans Souffleur de mots, il confie justement à propos de cette époque : « J’explorais la ligne qui passe dans l’imaginaire et le réel, pour me tenir debout dans le récit. C’est peut-être là que j’ai su. Je reviendrais à la fiction dans une écriture changée ». À partir de là, même si tout le ramène dans le sillage de son village du Bout du Monde, comme il le nomme avec affection, Paré abandonne l’écriture plus réaliste de ses premiers romans pour renouer avec les légendes et les mythes, avec « le temps du conteur et l’espace de l’homme-mémoire ».
Une dizaine de romans sur trois générations, tel est le projet qu’il entame avec Le violoneux et La mort d’Alexandre, suivi des Oiseaux de glace. Dans un style réaliste, proche de l’oralité, Paré y raconte la mort de son père et le travail forestier, « la colère, les cris et les jurons » de ses oncles et frères bûcherons. Ces romans « rongés par une grande misère morale et physique », comme les qualifie leur auteur, ne font pas l’unanimité parmi les critiques, et si une recension ne tue pas un écrivain, comme le dit Paré, elle peut certainement le paralyser : « Monsieur Réginald [Martel] n’a fait que me donner une petite poussée et j’ai basculé. Alors est venue l’aventure des carnets. Avant, j’écrivais mes romans comme des documentaires, me contentant d’être fidèle à la réalité, au vécu de ma famille, puisant dans ces secrets que personne ne veut entendre ». Mais s’il laisse tomber sa saga à la suite de cette mauvaise critique publiée dans La Presse, Paré n’en cesse pas moins d’écrire : des nouvelles, des récits de voyage, des réflexions sur le Québec et des essais. Dans Souffleur de mots, il confie justement à propos de cette époque : « J’explorais la ligne qui passe dans l’imaginaire et le réel, pour me tenir debout dans le récit. C’est peut-être là que j’ai su. Je reviendrais à la fiction dans une écriture changée ». À partir de là, même si tout le ramène dans le sillage de son village du Bout du Monde, comme il le nomme avec affection, Paré abandonne l’écriture plus réaliste de ses premiers romans pour renouer avec les légendes et les mythes, avec « le temps du conteur et l’espace de l’homme-mémoire ».
Contes et récits : nouvelles formes, mêmes obsessions
Une nouvelle idée d’écriture de fiction émerge en même temps que l’écriture quotidienne des carnets. Désormais, Paré emprunte la voie de Jacques Ferron en choisissant « le chemin du conte et du récit ». Mais bien que la forme change, le décor reste le même : « Et encore la feuille du bouleau, la petite fleur au bout de la branche de pin, les épinettes et les pousses nouvelles d’un vert tendre. Se mettre à l’écoute des hirondelles, parler aux ouananiches et faire des sourires aux bleuets. Écrire pour que ce pays que je connais ne s’évanouisse jamais ». Les plus belles années, récit dans lequel Paré raconte les rires et les bonheurs de son enfance à l’École numéro Neuf, porte la marque de cette nouvelle écriture qui demeure ancrée dans le territoire. « Je pus revenir dans les chemins de mon enfance et tout réinventer », écrit-il dans Le souffleur de mots. Dans son livre suivant, Le voyage d’Ulysse, l’écrivain propose de traduire « un monde à la fois possible et impossible, visible et invisible, vrai et imaginaire ».
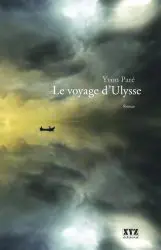 Son héros, parti du Bout du Monde, entreprend un périple autour du Grand Lac sans fin ni commencement et revient chez lui au terme d’un long voyage. À travers l’histoire de son Ulysse, Paré retrace les grandes lignes de l’histoire du Lac-Saint-Jean, ses mythes fondateurs ainsi que ses personnages historiques et légendaires, tout en y entremêlant ici et là des références à d’autres grandes œuvres. Dans le même entretien avec Christiane Laforge, l’écrivain confie : « Le voyage d’Ulysse, c’est le livre où j’ai assemblé tous mes aspects : l’amour de l’oralité du conte, des légendes, l’amour de la lecture, des écrivains aussi. Toutes mes perspectives, mes intérêts sont réunis dans ce livre. Et tous les genres littéraires sont utilisés. Le conte, le roman, le théâtre et même le haïku. J’ai mis dix ans pour ce livre ». Son lecteur est transporté dans un univers plus imagé, plus fantastique, mais il y retrouve les mêmes enjeux et préoccupations que dans les premiers romans et essais de l’auteur : le paysage, le voyage, la famille, l’amour, la mort, le temps qui passe… Paré l’écrit lui-même dans son dernier ouvrage : « Tous mes livres sont des fragments d’enfance et des retours au village ».
Son héros, parti du Bout du Monde, entreprend un périple autour du Grand Lac sans fin ni commencement et revient chez lui au terme d’un long voyage. À travers l’histoire de son Ulysse, Paré retrace les grandes lignes de l’histoire du Lac-Saint-Jean, ses mythes fondateurs ainsi que ses personnages historiques et légendaires, tout en y entremêlant ici et là des références à d’autres grandes œuvres. Dans le même entretien avec Christiane Laforge, l’écrivain confie : « Le voyage d’Ulysse, c’est le livre où j’ai assemblé tous mes aspects : l’amour de l’oralité du conte, des légendes, l’amour de la lecture, des écrivains aussi. Toutes mes perspectives, mes intérêts sont réunis dans ce livre. Et tous les genres littéraires sont utilisés. Le conte, le roman, le théâtre et même le haïku. J’ai mis dix ans pour ce livre ». Son lecteur est transporté dans un univers plus imagé, plus fantastique, mais il y retrouve les mêmes enjeux et préoccupations que dans les premiers romans et essais de l’auteur : le paysage, le voyage, la famille, l’amour, la mort, le temps qui passe… Paré l’écrit lui-même dans son dernier ouvrage : « Tous mes livres sont des fragments d’enfance et des retours au village ».
L’enfant qui ne voulait plus dormir
Andréanne R. Gagné, après deux années d’enseignement du français et de la littérature au cégep de la Gaspésie et des Îles, est revenue à Chicoutimi où elle poursuit des études supérieures en lettres. Financée par le FRQSC, sa recherche doctorale porte sur l’imaginaire gaspésien dans les romans québécois de 1970 à 2015. Elle travaille à l’UQAC comme chargée de cours en littérature québécoise et comme assistante de recherche.
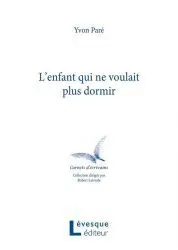 Dans son dernier livre, L’enfant qui ne voulait plus dormir, publié en 2014 chez Lévesque éditeur dans la collection « Carnets d’écrivains », Paré se montre encore plus préoccupé, songeur, nostalgique. Hanté à ce moment par l’écriture de son Ulysse, il s’interroge sur la place qu’occupe la littérature dans sa vie et au Québec : « Écrire est-il encore possible en ce pays de Québec ? […] Qui serais-je sans les livres et la littérature ? Un enfant effarouché qui ne veut plus dormir, un homme invisible à la fenêtre, un chasseur de lune qui n’arrive plus à fermer l’œil ? » Il revient sur les jours instables d’octobre 1970, cette époque où « être écrivain avait alors de l’importance ». Comme toujours, il revient aussi au pays de son enfance, aux souvenirs de son père et de sa mère, de ses oncles et de ses tantes, de ses grands-parents. Paré y raconte également son séjour à Pohénégamook avec sa conjointe, durant lequel ils ont participé au camp d’écriture de Robert Lalonde, et leur voyage en Acadie avec leur petit-fils Alexis : « Traversée du lointain pays de Saguenay jusqu’au fleuve, un peu de navigation et encore la route jusqu’au bout du continent. Il y aura la côte acadienne et le monde de Claude Le Bouthillier ». Et à nouveau une réflexion sur son écriture, sur son statut d’« écrivain invisible » dans son pays où personne même ne pense à offrir ses livres. Et encore Ulysse. Et s’il y écrivait une suite ? Et Presquil, son roman de mille six cents pages qui le suit depuis trente ans, son « histoire sans fin ni commencement »… Ou peut-être reviendra-t-il plutôt à la poésie dans ce Québec de révolte et de carrés rouges ? Le lecteur ferme le livre sur un Yvon Paré inquiet et bouleversé au lendemain de l’attentat politique perpétré contre Pauline Marois. Il conclut : « Me revoilà redevenu l’enfant qui ne veut plus dormir, l’adulte qui ne pourra plus rêver, l’autre qui se débat dans ses cauchemars ».
Dans son dernier livre, L’enfant qui ne voulait plus dormir, publié en 2014 chez Lévesque éditeur dans la collection « Carnets d’écrivains », Paré se montre encore plus préoccupé, songeur, nostalgique. Hanté à ce moment par l’écriture de son Ulysse, il s’interroge sur la place qu’occupe la littérature dans sa vie et au Québec : « Écrire est-il encore possible en ce pays de Québec ? […] Qui serais-je sans les livres et la littérature ? Un enfant effarouché qui ne veut plus dormir, un homme invisible à la fenêtre, un chasseur de lune qui n’arrive plus à fermer l’œil ? » Il revient sur les jours instables d’octobre 1970, cette époque où « être écrivain avait alors de l’importance ». Comme toujours, il revient aussi au pays de son enfance, aux souvenirs de son père et de sa mère, de ses oncles et de ses tantes, de ses grands-parents. Paré y raconte également son séjour à Pohénégamook avec sa conjointe, durant lequel ils ont participé au camp d’écriture de Robert Lalonde, et leur voyage en Acadie avec leur petit-fils Alexis : « Traversée du lointain pays de Saguenay jusqu’au fleuve, un peu de navigation et encore la route jusqu’au bout du continent. Il y aura la côte acadienne et le monde de Claude Le Bouthillier ». Et à nouveau une réflexion sur son écriture, sur son statut d’« écrivain invisible » dans son pays où personne même ne pense à offrir ses livres. Et encore Ulysse. Et s’il y écrivait une suite ? Et Presquil, son roman de mille six cents pages qui le suit depuis trente ans, son « histoire sans fin ni commencement »… Ou peut-être reviendra-t-il plutôt à la poésie dans ce Québec de révolte et de carrés rouges ? Le lecteur ferme le livre sur un Yvon Paré inquiet et bouleversé au lendemain de l’attentat politique perpétré contre Pauline Marois. Il conclut : « Me revoilà redevenu l’enfant qui ne veut plus dormir, l’adulte qui ne pourra plus rêver, l’autre qui se débat dans ses cauchemars ».
Yvon Paré a publié :
L’octobre des Indiens, Du Jour, 1971 ; Anna-Belle, Du Jour, 1972 ; Le violoneux, Cercle du livre de France, 1979 ; La mort d’Alexandre, VLB, 1982 ; Les oiseaux de glace, Québec Amérique, 1987 ; Le réflexe d’Adam, Trois-Pistoles, 1996 ; Un été en Provence, en collaboration avec Danielle Dubé, XYZ, 1999 ; Les plus belles années, XYZ, 2000 ; Souffleur de mots, Trois-Pistoles, 2002 ; Le tour du lac en 21 jours, en collaboration avec Danielle Dubé, XYZ, 2005 ; Le bonheur est dans le fjord, en collaboration avec Danielle Dubé, XYZ, 2008 ; Le voyage d’Ulysse, XYZ, 2013 ; L’enfant qui ne voulait plus dormir, Lévesque, 2014 ; L’orpheline de visage, Pleine lune, 2018.
EXTRAITS
Il me fallait rentrer au village, pas seulement pour m’y faire bûcheron mais pour y échafauder des livres, des romans qui sentent la gomme de sapin et la sueur.
Souffleur de mots, p. 80.
Revenons à notre rivière. Elle coule jour et nuit, hiver comme été. Qui peut dire en regardant les vagues que l’une est du passé, qu’une autre est du présent ou encore que la plus petite, celle que l’on distingue à peine, est l’avenir ? Le temps est à la fois passé, présent et avenir. Un tout. Tout comme il y a l’enfant, l’adulte et le vieillard dans le même être humain à tous les moments de la vie.
Le voyage d’Ulysse, p. 52.
Le froissement des ailes d’un chardonneret, un merle, une tourterelle quelque part dans le pli du jour. Je me lève, effleure les livres pour me calmer. Mon frère, son regard, son sourire, son indifférence devant la destruction du monde. Pourquoi se faufile-t-il dans mes rêves ?
L’enfant qui ne voulait plus dormir, p. 12.










