Des admonestations francophiles du frère Untel jusqu’à la sortie de Marc Cassivi contre les puristes échaudés par les sonorités d’un franglais à la mode, la langue demeure un sujet particulièrement sensible au Québec, une pomme de discorde que se disputent âprement les experts tant patentés qu’improvisés, et ce, depuis maintenant plusieurs décennies.
Souvent, au Québec, les débats sur la langue dépassent les simples dimensions linguistiques et normatives pour rejoindre le terrain fondamental de l’identité collective. En ce sens, tout ce qui touche la langue peut devenir délicat et prendre parfois des proportions considérables dans notre contexte si particulier. « Notre langue, c’est nous ! », pourrait-on dire d’une manière péremptoire. Ces controverses sur le statut du français ou sur la qualité de la langue ne sont pas nouvelles et ne nous sont pas exclusives.
Yves Laberge, préface du Français québécois entre réalité et idéologie, p. XIII.
Marqueur social, courroie de transmission des savoirs, matériau artistique, mais surtout vecteur identitaire, le français offre en effet un beau casse-tête aux sociolinguistes d’ici, davantage encore lorsqu’il s’agit de convenir des politiques d’aménagement linguistique ou de la norme à adopter par les locuteurs de la province. Au fait, doit-on parler de français ou de québécois ? À moins qu’il ne s’agisse de franbécois ? Pour aider à y voir plus clair dans les débats sur la langue et à mieux comprendre les enjeux entourant la norme linguistique au Québec, deux auteurs proposent des essais fort différents, ne serait-ce qu’en vertu des positions qu’ils défendent, mais tout aussi intelligents et instructifs.
LES INSOLENCES D’ANNE-MARIE BEAUDOIN-BÉGIN
Mieux connue, sur les réseaux sociaux, sous le joli nom d’emprunt de l’Insolente linguiste, Anne-Marie Beaudoin-Bégin est chargée de cours à l’Université Laval en plus de tenir une chronique sur les ondes radiophoniques de l’émission Québec réveille ! En 2015, elle s’est fait connaître du public avec la sortie d’un premier essai consacré à la question de l’insécurité linguistique, cette impression paralysante qu’ont certains Québécois de mal parler leur langue, de ne pas maîtriser le bon français, c’est-à-dire le français français, le seul réellement digne de ce nom pour les grands esprits épris de francité hexagonale1. Chez les victimes de cette insécurité, la langue se fait alors source de stigmatisation en ayant pour conséquence paradoxale de museler les locuteurs plutôt que de leur fournir un outil efficace de communication.
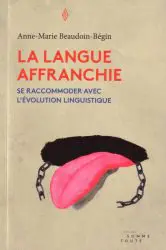 La langue affranchie. Se raccommoder avec l’évolution linguistique2 prolonge la réflexion en proposant cette fois, le titre l’indique clairement, un bref coup d’œil sur l’évolution linguistique. Les deux essais ont au fond partie liée dans la mesure où l’insécurité linguistique est souvent le fruit de changements pouvant être perçus comme une menace par les gardiens du bon usage. Et gardons-nous bien de penser que cette attitude de rejet s’avère nouvelle chez les francophones du Québec. Elle remonte à aussi loin qu’à l’Acte d’Union de 1840, au moment où se répand dans les rangs de l’élite canadienne l’idée selon laquelle la norme hexagonale doit primer afin de préserver les Canadiens français de l’assimilation anglaise. Voilà qui sonnait du même coup l’ouverture de la chasse aux anglicismes et aux barbarismes.
La langue affranchie. Se raccommoder avec l’évolution linguistique2 prolonge la réflexion en proposant cette fois, le titre l’indique clairement, un bref coup d’œil sur l’évolution linguistique. Les deux essais ont au fond partie liée dans la mesure où l’insécurité linguistique est souvent le fruit de changements pouvant être perçus comme une menace par les gardiens du bon usage. Et gardons-nous bien de penser que cette attitude de rejet s’avère nouvelle chez les francophones du Québec. Elle remonte à aussi loin qu’à l’Acte d’Union de 1840, au moment où se répand dans les rangs de l’élite canadienne l’idée selon laquelle la norme hexagonale doit primer afin de préserver les Canadiens français de l’assimilation anglaise. Voilà qui sonnait du même coup l’ouverture de la chasse aux anglicismes et aux barbarismes.
Or, vulgarise brillamment Beaudoin-Bégin, les sources de variation linguistique sont nombreuses et concernent autant l’âge, le lieu, la classe socioéconomique et le moyen de communication (oral ou écrit) que la situation de communication dans laquelle se trouve le locuteur. De plus, l’économie linguistique (dire plus avec le moins d’efforts possible), le développement des moyens de communication, les contacts immédiats et quotidiens avec d’autres langues et les interventions humaines contribuent tous à refaçonner les conventions d’une langue aux multiples inflexions. Ce que tente ainsi de montrer la linguiste, c’est que la différence est tout à fait normale, et qu’il faut donc se décomplexer des pratiques qui dévient de la norme internationale.
L’une des thèses centrales défendues par l’auteure est aussi qu’à déprécier les pratiques dites du « mauvais » français, on dénigre la langue elle-même, qui perd conséquemment de son attrait. Beaudoin-Bégin va même jusqu’à arguer que l’anglais gagne du terrain au Québec parce que les jeunes n’ont plus d’intérêt pour ce français de tous les jours frappé d’indigence culturelle. Si le diagnostic laisse songeur – on peut se demander si les « jeunes » ont réellement ce recul par rapport à leurs pratiques linguistiques –, le remède prescrit a de quoi surprendre. Comment permettre au français de retrouver ses lettres de noblesse auprès de ses locuteurs ? L’Insolente linguiste répond à ce propos qu’il faut déloger la langue de son piédestal afin d’en promouvoir une plus conviviale, plus invitante : « Une bonne idée », avance-t-elle, « serait d’arrêter de leur présenter le français comme une langue prestigieuse ». Ainsi, à en croire Beaudoin-Bégin, la meilleure façon de redonner son prestige au français serait de le lui enlever, comme s’il suffisait d’éradiquer la richesse pour contrer la pauvreté…
L’AUTRE REGARD SUR LA LANGUE : LE POINT DE VUE DE LIONEL MENEY
 Tout autre est le point de vue de Lionel Meney. En conclusion de sa plus récente monographie, un ouvrage d’érudition touffu, le linguiste et lexicographe retraité de l’Université Laval avance de façon quasi prophétique : « Les Québécois désirent un retour au français international. La parenthèse endogéniste est peut-être sur le point de se refermer3 ». Celui qui est connu pour être un ardent défenseur du français normé international s’est auparavant penché sur le sujet dans Main basse sur la langue. Idéologie et interventionnisme linguistique au Québec (2010), bruyant réquisitoire contre les partisans d’une norme proprement québécoise du français, ou les tenants de ce qu’il a baptisé, il y a plusieurs années de cela, la norme endogène.
Tout autre est le point de vue de Lionel Meney. En conclusion de sa plus récente monographie, un ouvrage d’érudition touffu, le linguiste et lexicographe retraité de l’Université Laval avance de façon quasi prophétique : « Les Québécois désirent un retour au français international. La parenthèse endogéniste est peut-être sur le point de se refermer3 ». Celui qui est connu pour être un ardent défenseur du français normé international s’est auparavant penché sur le sujet dans Main basse sur la langue. Idéologie et interventionnisme linguistique au Québec (2010), bruyant réquisitoire contre les partisans d’une norme proprement québécoise du français, ou les tenants de ce qu’il a baptisé, il y a plusieurs années de cela, la norme endogène.
Meney reprend d’ailleurs plusieurs pans de ses travaux antérieurs au sein de son essai Le français québécois entre réalité et idéologies. Un autre regard sur la langue, paru l’hiver dernier. Dans cette somme marquant l’aboutissement d’une prolifique carrière de chercheur, le linguiste s’intéresse aux particularités du français québécois, qu’il attribue moins à ses aspects phonétiques, morphologiques ou syntaxiques que lexicaux : « C’est par le lexique », explique le spécialiste, « que le français québécois se différencie le plus du français standard. Il se caractérise par des conservatismes, des emprunts et des innovations. Au nombre des conservatismes, on compte des dialectalismes et des archaïsmes. Au nombre des emprunts, des amérindianismes et des anglicismes4 ».
Les diverses formes d’anglicismes retiennent Meney durant une bonne partie de son essai. L’auteur procède en effet à une patiente recension des types d’anglicismes et des conditions de pénétration de ceux-ci dans la langue française en se basant sur des exemples de traduction déficiente dans les indications inscrites sur les produits de consommation. C’est là, selon lui, une des principales portes d’entrée à l’anglicisation du français et à la formation d’une interlangue, le franbécois, néologisme forgé à partir des termes « franglais » et « québécois ». À cause du contexte de diglossie dans lequel il doit évoluer, le français (langue basse), au Québec, ne peut que subir la contamination de l’anglais, langue dominante et lingua franca moderne.
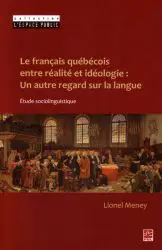 Compte tenu du fait que le franbécois diffère du français international, quelle norme faudrait-il alors adopter, demande Meney ? Le problème se pose depuis longtemps sans pourtant jamais n’avoir été vidé. L’auteur présente d’ailleurs l’argumentaire de quelques-uns des intervenants qui se sont prononcés dans cette véritable querelle de clocher qui oppose endogénistes et internationalistes. Cela lui permet notamment d’établir des nuances plus fines entre les positions endogénistes populistes (Henri Bélanger et Marcel Boudreault) et endogénistes élitistes (Jean-Claude Corbeil), puis entre internationalisme internationalisant (Jean Marcel) et internationalisme francisant (Gérard Dagenais). L’exposé, en dépit de ce que peuvent laisser croire les précédentes subtilités, est clair et accessible. À travers l’examen minutieux – et parfois un peu longuet, il est vrai – de ces discours dont plusieurs ne datent pas d’hier, la position de Meney, pour qui l’ignore, affleure, de plus en plus claire.
Compte tenu du fait que le franbécois diffère du français international, quelle norme faudrait-il alors adopter, demande Meney ? Le problème se pose depuis longtemps sans pourtant jamais n’avoir été vidé. L’auteur présente d’ailleurs l’argumentaire de quelques-uns des intervenants qui se sont prononcés dans cette véritable querelle de clocher qui oppose endogénistes et internationalistes. Cela lui permet notamment d’établir des nuances plus fines entre les positions endogénistes populistes (Henri Bélanger et Marcel Boudreault) et endogénistes élitistes (Jean-Claude Corbeil), puis entre internationalisme internationalisant (Jean Marcel) et internationalisme francisant (Gérard Dagenais). L’exposé, en dépit de ce que peuvent laisser croire les précédentes subtilités, est clair et accessible. À travers l’examen minutieux – et parfois un peu longuet, il est vrai – de ces discours dont plusieurs ne datent pas d’hier, la position de Meney, pour qui l’ignore, affleure, de plus en plus claire.
ENDOGÉNISTES ET INTERNATIONALISTES : UN DIALOGUE SANS FIN
Finalement, on peut bien se demander qui sort vainqueur de ce débat, mais c’est pour rapidement convenir à un match nul (ou à une partie égale, c’est selon). Meney montre d’ailleurs éloquemment, de nombreuses synthèses tabulaires à l’appui, que chacune des positions à l’égard de la langue dépend de convictions idéologiques bien plus que de la démonstration d’une vérité infuse. Mais lui-même pèche parfois par excès de fausse objectivité en se plaçant sous l’égide triomphante de la réalité, et oublie d’où il se prononce dans cette arène linguistique pourtant entièrement régie par les idéologies. Nul n’y échappe, pour la simple et bonne raison que la question de la langue, peu importe le domaine où elle s’impose, est constitutivement idéologique. Ainsi, que l’on soit anglophile ou francophobe, partisan du décrochage hexagonal ou de l’american way of life, la langue et le choix d’une norme restent une affaire de stratégie et de positionnement politique.
Roublarde et polémique à ses heures, l’Insolente linguistique défend pour sa part une conception assez désinvolte de la norme québécoise qui pourrait bien déboucher sur un relativisme contre-productif : « Cessons de critiquer. Cessons de condamner5 », de conclure l’essayiste, débonnaire. Mais, avec ce genre d’attitude, un problème en vient ultimement à se poser. Car si rien n’est fautif, cela veut aussi dire que rien n’est correct. Et si ce constat concerne prioritairement la langue parlée, il en dit peu sur l’usage de l’écrit et les mesures à prendre pour l’enseignement du français à l’école. En général, donc, autant Meney que Beaudoin-Bégin s’accommodent fort peu des demi-mesures, montrant par là que les attitudes à l’égard de la langue et de son « bon usage » sont toujours aussi tranchées et tranchantes. Au Québec, en fait, dans ce dialogue de sourds auquel se livrent endogénistes et internationalistes, tout porte à croire que l’on ne parle pas non plus la même langue.
1. Anne-Marie Beaudoin-Bégin, La langue rapaillée. Combattre l’insécurité linguistique des Québécois, Somme toute, Montréal, 2015, 114 p. ; 12,95 $.
2. Anne-Marie Beaudoin-Bégin, La langue affranchie. Se raccomoder avec l’évolution linguistique, Somme toute, Montréal, 2017, 122 p. ; 14,95 $.
3. Lionel Meney, Le français québécois entre réalité et idéologies. Un autre regard sur la langue, Presses de l’Université Laval, Québec, 2017, 625 p. ; 49,95 $, p. 620.
4. Le français québécois, p. 153.
5. La langue affranchie, p. 111-112.
EXTRAITS
« Pas allable », les mêmes mots que ceux de mon grand-père lorsqu’il me racontait cette inondation durant les années 1920 au Lac-Saint-Jean, un déluge qui avait laissé, paraît-il, dans son sillage une quantité phénoménale de billots de bois sur le chemin de fer : « y avait des pitounes sur la track, c’était pas allable ! » Est-ce mal, docteur ? Réponse courte ? Pantoute.
La langue affranchie, préface de Matthieu Dugal, p. 9.
Et puis il y a ce réel, ce sacré réel. Qui nous nargue, qu’il faut nommer. Il s’agit maintenant de savoir si nous voulons nous parler du présent avec une langue jalousement gardée, pour la forme, dans une ère pré-textos ou si nous voulons faire du français une langue qui raconte le XXIe siècle à la manière du XXIe siècle.
La langue affranchie, préface de Matthieu Dugal, p. 11.
Après l’Acte d’Union de 1840, lorsque les autorités britanniques ont ouvertement véhiculé la volonté d’assimiler les francophones, les lettrés canadiens ont pensé que pour défendre la langue française contre cette assimilation, il fallait la purger de tous les traits qui la rendaient différente de la variété hexagonale, le « français de France », le « véritable français », comme l’a appelée le penseur Raoul Rinfret dans son Dictionnaire de nos fautes contre la langue française (1896). Louable intention, certes, mais qui n’a pas donné le résultat escompté.
La langue affranchie, p. 17.
La langue française, comme le vert, n’existe pas. Il s’agit d’une opération de l’esprit. En soi, il n’y a pas un français, comme il n’y a pas un vert. Il y a un ensemble de codes de communication desquels on accumule les caractéristiques pour les regrouper dans la catégorie français.
La langue affranchie, p. 20.
Les francophones parlent une langue tellement prestigieuse qu’ils n’ont pas le droit d’en faire ce qu’ils veulent, de peur de l’abîmer ou de la salir. Ils le font, évidemment, mais ils se sentent un peu comme ces clochards qui portent de vieux habits qui auraient jadis été beaux, mais qui ont maintenant perdu leur lustre.
La langue rapaillée, p. 111.
La problématique du langage est complexe et touche à l’identité individuelle ou collective. Cela favorise l’apparition d’idées préconçues, de représentations erronées, d’idéologies. Le débat sur la norme linguistique et la qualité de la langue au Québec est, en bonne partie, brouillé par un manque de distinction entre ces notions. Il convient donc de débrouiller la question en examinant d’abord la réalité linguistique, en décrivant ce qui caractérise le français québécois par rapport au français dit de référence.
Le français québécois, p. 10.
En réalité, il n’y a pas un marché linguistique québécois, mais deux. Un marché régional, où les francophones unilingues et le français dominent. Un marché montréalais où les francophones sont relativement moins nombreux qu’en région et où le français subit la très forte concurrence de l’anglais. C’est sur ce marché-là que se joue le destin du français, non seulement celui de son statut, mais aussi de son corpus, partant de sa qualité.
Le français québécois, p. 12.
Au Québec, quand il s’agit de définir le modèle souhaitable de français parlé et écrit, deux thèses s’affrontent, l’une que je qualifie d’« endogéniste », et l’autre, d’« internationalisante ».
Le français québécois, p. 379.
Derrière la question du choix d’un modèle linguistique se trouve en réalité celle du Québec à lui-même et à l’extérieur, à la France en particulier, à travers sa langue.
Le français québécois, p. 599.











