Avant de s’enfoncer dans son quatrième roman, Cet été-là (1967), Marie Cardinal s’inquiète. Saura-t-elle un jour se foutre de la littérature et se libérer de l’étau des écrivains qu’elle a d’abord enseignés, et qui maintenant obstruent son passage de l’autre côté du miroir ?
Proust, Flaubert, Dostoïevski, Sartre, Beauvoir qu’elle a lus de façon désordonnée, avide, éclectique l’empêchent d’y voir clair et de tracer son propre chemin.
Le jugement qu’elle porte sur ses débuts en littérature est acéré. Deux des trois premiers romans, Écoutez la mer (1962) et La souricière (1965), comptent leur part de tâtonnements, mais foisonnent déjà d’idées fécondes. Bien que ses débuts inspirent de la tendresse à l’écrivaine en herbe, elle les qualifie d’œuvrettes. La plume est plus assurée dans La mule de corbillard (1963). Une vieille femme sauvage, abandonnée par son amour de jeunesse sans une explication, envoûte tout du long. Parvenue à dompter son destin, elle en paie le prix sans rechigner : « Voyez la vieille fourmi que je suis. Je traîne une charge plus grosse que moi : mon corps rempli d’amours assassinées ». Le terme chef-d’œuvre a été évoqué pour parler de ce court roman. Vient ensuite le premier grand succès de librairie, La clé sur la porte (1972), où elle observe avec finesse et gravité ses enfants et une jeunesse à cheval entre attentisme et révolution, dans l’agitation de la vie moderne.
Le surgissement du soliton
D’un texte à l’autre, Cardinal travaille avec une constance digne de la mer qui hante ses navigations en écriture. Puis paraît son vaisseau amiral, Les mots pour le dire (1975). Tel un soliton, capable de provoquer raz-de-marée et vagues scélérates, il emporte clichés et préjugés sur son passage, et impose sa puissance. Il fait déferler des millions de lames de fond un peu partout, dans une vingtaine de langues et, dans l’accès progressif à l’inconscient, met en lumière une autre vérité. Narratrice et auteure se confondent si parfaitement qu’on oublie être dans un roman. Surtout, cela importe peu. On suit Marie Cardinal trébuchant dans l’impasse parisienne rendue célèbre par son texte, impasse qui la mène au divan du psychanalyste. On emprunte avec elle ses descentes en folie. « Là tout n’est que chaos et suée / Peur, terreur et cruauté. » Elle nous dévoile le mal qui se transmet de mère en fille. D’utérus en utérus au sens propre. Celui de la mère qui essaie par mille subterfuges de se débarrasser en vain du fœtus qui s’accroche dans son ventre à celui de sa fille, devenue adulte, qui cherche à son tour à avorter d’elle-même en évacuant de son ventre le sang hémorragique. Placentaire.
Les mots littéraires en substrat de sa psychanalyse, laquelle a eu lieu dans les années 1960, sont saisissants. La démarche analytique a vaincu la folie, mais n’a pas guéri l’analysante, car on ne guérit pas. Quelques années plus tard, dans Au pays de mes racines (1980), on lira : « Finalement impuissante, résignée, vaincue, déçue et humiliée, elle [sa mère] m’a laissée glisser vivante dans la vie, comme on laisse glisser un étron ». Sa souffrance primale, quasi létale, apaisée, la narratrice se crée une existence neuve sur les blessures cicatrisées. En explorant sans reprendre son souffle les dédales analytiques, sous l’œil du « petit docteur », elle retrouve la jeune femme qui a voulu se débarrasser d’elle. La mère aimée et crainte, surinvestie dans l’enfance, devient objet de répulsion, puis reconnue dans l’immensité de sa folie, obligée de camper un rôle maternel intenable, retrouve aux yeux de sa fille ses dons, son intelligence et sa quête pressante d’amour, anéantis par sa culture bourgeoise. On croit la boucle bouclée. Il n’en va pas ainsi, ce que révélera le texte suivant.
D’Annie à Marie
De crainte de n’avoir pas été assez claire dans son œuvre maîtresse, Marie Cardinal presse Annie Leclerc, la philosophe, de se prêter à un jeu où celle-ci sera le faire-valoir et la locomotrice de ce relais maïeutique d’Annie à Marie, de Marie à toutes celles qui l’ont lue et qui, mortes de faim, réclament une suite à cette parole de femme. La simplicité de sa manière, l’originalité de sa pensée, la profondeur de son intuition sont bouleversantes. Davantage encore si l’on se rappelle que ces entretiens qui deviendront Autrement dit (1977) se sont tenus il y a 40 ans. Foin d’une prétendue objectivité : je suis béate d’admiration devant ce feu, ce désir cardinal de donner des mots à celles qui n’en ont pas, et « qui pourtant savent tout ». Littérature de la chair, du sang, des viscères. Des sanies donc, mot que Cardinal exécrait puisqu’il ment et cache les excréments.
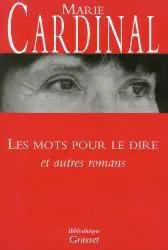 Au beau milieu de ce travail, tandis qu’elle séjourne à Montréal, Marie Cardinal subit une agression sexuelle. Elle écrit : « Y a-t-il un mot pour exprimer le refus essentiel du viol ? Il n’y en a pas ». On croit qu’à son retour à Paris, auprès d’Annie Leclerc, elle abordera de front cette plongée en noirceur. Ni peu ni prou, elle restera muette. Que déduire de ce silence sibyllin ? Autre raté de l’inconscient : pendant qu’elle crée Les mots pour le dire, un cancer lui pousse dans le ventre. Elle confie cet événement énorme à Leclerc, et explique qu’elle l’a alors tu pour ne pas engager le livre sur une autre voie. « Une fois de plus j’avais somatisé, j’avais passé dans mon corps la détresse inavouée causée par la mort de ma mère. »
Au beau milieu de ce travail, tandis qu’elle séjourne à Montréal, Marie Cardinal subit une agression sexuelle. Elle écrit : « Y a-t-il un mot pour exprimer le refus essentiel du viol ? Il n’y en a pas ». On croit qu’à son retour à Paris, auprès d’Annie Leclerc, elle abordera de front cette plongée en noirceur. Ni peu ni prou, elle restera muette. Que déduire de ce silence sibyllin ? Autre raté de l’inconscient : pendant qu’elle crée Les mots pour le dire, un cancer lui pousse dans le ventre. Elle confie cet événement énorme à Leclerc, et explique qu’elle l’a alors tu pour ne pas engager le livre sur une autre voie. « Une fois de plus j’avais somatisé, j’avais passé dans mon corps la détresse inavouée causée par la mort de ma mère. »
Le premier sexe, et le deuxième
Les hommes cardinaliens sont sensuels, désirables et égocentriques. Ils jouent à l’amour, et souvent s’en jouent. L’un d’eux, indifférent à ce qui n’est pas lui, se repaît de la jeunesse de son épouse, et l’infantilise dans le parfait cliché : pendant qu’elle crée la vie, il crée une pièce de Plaute en latin, aveugle au choc post-puerpéral de sa compagne, à sa lente déchéance jusqu’au suicide annoncé. Ailleurs, elle écorche jusqu’au sang un intouchable du cinéma de la nouvelle vague française. La surprise est grande quand elle part à la recherche de l’homme-père dans son audacieux et renversant Le passé empiété (1983). L’imagination en cavale, qui malaxe la mythologie et réinvente Clytemnestre, ravit. Ce faisant, l’écrivaine nous confie quantité de secrets sur le processus créatif qu’elle dissèque devant nous.
Aux prises avec de profondes crises psychologiques, les personnages féminins pédalent dans la vaseline de l’amour-glu jusqu’à ce qu’un événement force leur évolution et que leurs ouvrages de dame se révèlent être des œuvres valables, même puissantes, quelquefois universelles. La romancière s’ingénie à mettre au jour la part « dénaturée, masquée, transférée, déguisée, amenuisée de la formidable et infuse force des êtres humains de sexe féminin », tout autant qu’elle cherche à nommer du féminin ce qui ne l’est que trop rarement : « Je me rappelle, quand Alain avait enfin choisi un endroit convenable, le spasme qui pinçait ce fruit mûr que j’avais entre les jambes, cette figue juteuse, ce brugnon satiné, cette nèfle prête à se fendre » (Une vie pour deux, 1979).
Marie d’Algérie, de Paris, de Montréal aussi
Née en Algérie en 1928 de parents français, elle s’exilera en France à cause de la guerre d’indépendance. Chassée du pays aimé, la jeune Pied-Noir n’y retournera que 24 ans plus tard. Les terres de l’enfance, magnifiées dans des élans d’une grande beauté littéraire, ne la quitteront jamais. Son pays, c’est Alger. Sa citoyenneté, c’est la Méditerranée. Ses livres regorgent de pins maritimes, d’arbousiers, de néfliers et de figuiers. Partout, ils convoquent la nature salvatrice et ses volutes odorantes, ses garrigues et ses champs de vigne, l’ensemble pimenté de fleurons linguistiques québécois, car elle séjournera souvent parmi nous, venant rejoindre son complice d’une longue vie. Le politique s’infiltre partout dans ses textes, en toile de fond, mais dans Comme si de rien n’était (1990), il se révèle objet central, porté par une colère sourde.
Elle est décédée depuis douze ans quand paraît son œuvre complète chez Grasset1. Presque 2000 pages, c’est lourd de sens, d’expectatives, de plaisir et de refus. Le gros livre séduit par sa promesse de tout contenir – à l’exception de ses créations théâtrales et de L’inédit (2012), ouvrage posthume – tout autant qu’il agace par son poids, encombrant le sac de plage ou de ski, intenable dans la baignoire ou le transport en commun. La magie de tout avoir sous la main, de reconnaître les thèmes initiatiques ou compulsifs, les lieux et les profils humains, fait pencher du bon côté le rapport amour/haine avec l’objet–livre.
Écriture et féminisme
Cardinal l’affirme haut et fort : l’écriture est sauvage. Chez elle, la fiction ressemble à la chronique ou s’apparente au récit, sans en être. Elle serait à la littérature ce qu’Anne Claire Poirier est à notre cinéma, l’une et l’autre façonnant des objets d’art très métissés. Sur un léger ton d’agacement, elle répond à la question de la part biographique du roman tel qu’on le ferait d’un refrain éculé. « Comme si tous les romans n’étaient pas autobiographiques ! »
L’écriture qui nous est offerte à l’encre crue est riche ainsi qu’on le dit de la nourriture. Riche, copieuse, gourmande. Excessive quelquefois. Qui recherche l’épure, le met délicat et minimaliste pourrait être trop vite rassasié. À vouloir tout dire, il arrive que l’auteure dise trop. Par exemple, Une vie pour deux ou Au pays de mes racines fait naître une certaine irritation, mais elle rattrape vite notre intérêt par son esprit singulier qui se rit des codes littéraires et ne cesse de les brouiller, tandis qu’elle entrecroise sans vergogne les voix narratives, ou dissout dans ses textes des pans connus de sa vie, et par là met à nu les faux-fuyants de la fiction.
L’insoutenable poids de l’injustice actionne chez elle un questionnement sans relâche sur l’oppression des femmes et les relations femmes-hommes. Son féminisme, amplement politique et si intime, est vécu comme le plus grand humanisme, puisqu’il touche la moitié des humains. Mais la clochard du doute se tient à juste distance des chapelles et des dogmes. Peu de ses mots pour le dire sont devenus obsolètes. S’y abreuver, c’est frapper d’anathème les poncifs accolés à l’un et l’autre sexe. S’y abreuver, c’est enrichir notre pensée et notre vision du monde.
1. Marie Cardinal, Les mots pour le dire et autres romans, Grasset, Paris, 2013, 1973 p. ; 73,95 $.
EXTRAITS
Ah ! je me sens forte, je lutterai bien avec le Bon Dieu s’il existe et s’il se met sur mon chemin.
Cet été-là, p. 345.
J’ai su qu’on ne pouvait parler de l’analyse que pour décrire un échec. Moi, je les choquais avec ma guérison, ma force neuve.
Les mots pour le dire, p. 695.
« Je » est un masque.
Autrement dit, p. 748.
C’est pour elles que j’ai envie d’écrire, j’ai envie de leur passer des mots qui seront des armes.
Autrement dit, p. 783.
C’est un peuple [les Québécois] que j’aime et j’aime leur langue. Ils ont une grande difficulté à se situer dans le monde. Ils sont tiraillés par les Américains, par les Français, par les Anglais.
Autrement dit, p. 792.
Et Dieu sait que leur virilité les embarrasse autant que notre féminité nous embarrasse. Seulement la féminité c’est un bagne tandis que la virilité c’est un trône.
Autrement dit, p. 840.











