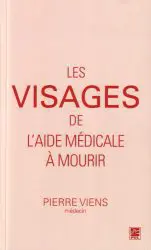Osons le dire, la lecture de cet essai écrit par un « vieux » médecin s’avère une absolue nécessité. Il s’agit là d’un témoignage choc sur les premiers mois d’application de la Loi concernant les soins de fin de vie, entrée en vigueur en décembre 2015.
Cette loi marque selon Pierre Viens une avancée en faveur d’une fin de parcours dans la dignité, mais doit encore être améliorée au nom du respect des personnes dont la vie n’est plus que souffrance.
Les visages de l’aide médicale à mourir1 se divise en trois parties. La première présente douze récits de fin de vie, profondément émouvants et beaux dans leur vérité, malgré les difficultés procédurières assimilant l’aide médicale à mourir à une course à obstacles, pour la personne demanderesse et pour son entourage. L’une de ces histoires est celle d’Hélène L., réduite à se laisser mourir de faim parce que le dernier soin lui était refusé et qui a voulu faire connaître son cas pour sensibiliser la population. La deuxième partie présente les propositions de l’auteur pour améliorer la loi. Enfin, la troisième regroupe des conseils pratiques à l’intention des proches dans l’accompagnement d’un malade en fin de vie.
L’auteur appuie son propos sur une expérience de 25 ans en soins palliatifs. Son essai, motivé par la compassion et l’urgence d’agir, raconte dans le détail comment la loi québécoise est assortie d’un protocole décourageant, à la fois pour le malade et pour son médecin. Formulaires fastidieux à remplir, renouvellement ad nauseam du consentement, prescriptions techniques superflues, non-disponibilité ou objection de conscience d’un grand nombre de médecins ; les embûches sont légion. Comme si cela ne suffisait pas, le Canada venait encore embrouiller les choses avec sa propre loi en juin 2016. Le docteur Viens témoigne, non seulement de l’expérience des malades auxquels il a assuré un soutien en fin de vie, mais également de son expérience personnelle de médecin, à la fois touché par la force de ses protégés à l’heure de la mort et choqué des contraintes dont l’effet cumulatif va à l’encontre de l’objectif premier de la loi québécoise.
On comprend à la lecture de l’essai que l’opposition à l’aide médicale à mourir, qui a forcé le législateur à introduire dans la loi une série de conditions aux lourdes conséquences, est fondée sur une conception étroite de l’existence. Les détracteurs des soins de fin de vie sont obsédés par la dimension physiologique de la vie et négligent la dimension sociale. « Penser, aimer, se souvenir et planifier, profiter d’un coucher de soleil et d’un bon verre de vin, rencontrer des amis, serrer son petit-fils dans ses bras, écrire à son amoureux, font intimement partie de la vie d’une personne humaine. […] Et lorsque cela n’existe plus, et n’existera jamais plus, il est concevable qu’il n’y a plus vraiment de vie humaine, et qu’il est acceptable d’aider cette personne à terminer la partie animale de sa vie si elle le demande. »
Notre regretté collègue Laurent Laplante, qui a eu recours à l’aide médicale à mourir en 2017, faisait un constat similaire dans une lettre publiée dans Le Devoir2 à titre posthume. Avec son aplomb coutumier, même en face-à-face avec la mort, Laplante demandait qu’on améliore la loi québécoise, notamment en se préoccupant davantage de la douleur psychologique ou spirituelle des malades. Il déplorait également le manque d’engagement d’une partie du corps médical à répondre aux besoins de la population.
De son côté, le docteur Viens a été surpris de constater l’opposition vive et organisée en provenance du milieu québécois des soins palliatifs. Pour ce médecin expérimenté dans le domaine, les soins de fin de vie doivent s’inscrire dans la continuité des soins palliatifs, lorsque ces derniers ont atteint leur limite. La plupart des maisons de soins palliatifs ont rejeté ce principe, poussant l’auteur à quitter la maison au sein de laquelle il pratiquait.
Parmi les nombreux amendements suggérés par Pierre Viens au législateur, mentionnons la notion de fin de vie, correspondant dans la loi à un pronostic de moins de douze mois à vivre, ce qui empêche un trop grand nombre de malades de se libérer de leur carcan de douleur. De même, l’aptitude à décider jusqu’au dernier souffle, requise par la loi, est irréaliste dans un trop grand nombre de cas, considérant l’imminence des dysfonctions en fin de vie. Il n’est pas logique non plus d’exiger du médecin des preuves de « souffrances constantes et intolérables » ; en définitive, seul le malade est en mesure d’en juger, d’après ses propres critères.
Dans un style limpide et sur un ton toujours juste, le docteur Viens balise le chemin à parcourir pour en arriver à mieux tenir compte des besoins et de la volonté des personnes en bout de course. Comme il le rappelle justement, ces personnes sont la plupart du temps dans l’impossibilité de mener quelque bataille que ce soit pour faire respecter leur droit à une fin dans la dignité. L’auteur interpelle l’ensemble de la société à agir pour améliorer une situation où nous risquons tous de nous retrouver un jour ou l’autre.
1. Pierre Viens, Les visages de l’aide médicale à mourir, Presses de l’Université Laval, Québec, 2017, 157 p. ; 20 $.
2. Laurent Laplante, « Un deuxième souffle est requis pour l’aide médicale à mourir », Le Devoir, 17 mars 2017 [http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/494105/l-aide-medicale-a-mourir-laurent-laplante-en-beneficie-et-lui-demande-des-ameliorations].
EXTRAITS
Vous me pardonnerez de parler au « je », ce n’est pas par prétention mais seulement parce que j’y étais, c’est donc aussi mon histoire de cette longue dernière année.
p. 4
Toutes, elles savaient qu’elles allaient mourir bientôt, et elles l’avaient accepté. C’étaient des personnes arrivées au fond d’une immense et permanente souffrance. Des personnes dignes, libres, et respectueuses de ceux et celles qu’elles aimaient au point de vouloir leur éviter le spectacle de leur déchéance prochaine et de leurs indignités.
p. 6
Au moment de la quitter, elle manifeste le désir de dire quelque chose. Le premier « oui » bloque le « m ». Le deuxième le « e ». Je pense que vous voulez dire « merci »? Elle éclate en sanglots. Et je me hâte de sortir de la chambre parce que mon professeur de psychiatrie m’avait fait comprendre, bien des années auparavant, qu’un médecin ne doit pas pleurer devant ses patients.
p. 13-14
Le silence… même les chiens se sont tus… Sa conjointe m’étreint les mains : « Que serait-il arrivé si vous n’aviez pas été mis sur notre chemin? » Je n’ai pas de réponse, juste des hypothèses. Que je demanderai à Mozart, tout à l’heure, de me faire vite oublier.
p. 53
Il faut enfin accepter que toute personne lucide et apte ait le droit de décider pour elle-même de ce qu’elle veut faire de cette vie qui lui reste. Cette vie lui appartient d’abord. Elle seule est à même d’en évaluer la valeur et la qualité.
p. 120