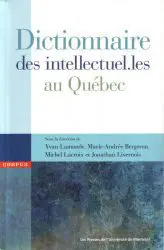Élaborer un dictionnaire thématique est une entreprise périlleuse, à plus forte raison lorsqu’il s’agit de s’intéresser à une notion aussi riche et ambiguë que celle de l’intellectuel.
Le collectif de 86 auteurs1 sous la direction d’Yvan Lamonde, Marie-Andrée Bergeron, Michel Lacroix et Jonathan Livernois relève le défi avec brio. À travers le parcours de ceux et celles qui ont été d’ardents protagonistes du débat public, l’ouvrage s’impose comme une référence majeure, à la fois pour les consensus et pour les débats qu’il ne manquera pas de susciter.
La très grande majorité des entrées du dictionnaire, 115 sur 137, concerne des acteurs marquants de l’espace intellectuel depuis le XIXe siècle (avec deux cas de précurseurs du XVIIIe siècle). Les 22 autres entrées portent sur des revues ou institutions constituant autant de jalons dans la trajectoire intellectuelle du Québec. Les articles sur les revues apportent un éclairage particulièrement pertinent, mettant au jour la contribution d’autres intellectuels que ceux de la courte liste et faisant voir les liens entre les individus et diverses mouvances intellectuelles.
Un réflexe normal du lecteur le moindrement intéressé par la trajectoire des idées au Québec sera de vérifier si unetelle ou untel a été inclus dans le dictionnaire. Le texte d’introduction de l’ouvrage, où les directeurs du collectif exposent les orientations ayant guidé leurs choix, pourra réduire dans une certaine mesure l’effet de déconvenue, sans toutefois éliminer la possibilité de désaccord. Ainsi, la définition de l’intellectuel sur laquelle est construit l’ouvrage privilégie la fonction plutôt que le statut, ce qui permet entre autres de tenir compte de la contribution des femmes au débat public, selon les moyens à leur disposition dans un contexte donné. Par contre, en définissant l’intellectuel, sur un mode opérationnel, comme celle ou celui qui « intervient publiquement » sur des « enjeux collectivement significatifs », « incarne la liberté de parole » et « a laissé des traces écrites », on met de côté la contradiction assumée entre universalisme et particularisme, tout autant que l’engagement pour l’émancipation des dominés et des exploités, points essentiels promus par Jean-Paul Sartre dans son Plaidoyer pour les intellectuels. Il en découle que l’intellectuel du dictionnaire « peut tout aussi aisément que quiconque s’avérer misogyne, sexiste, raciste, homophobe ou anti-intellectuel ». Le texte d’introduction désolidarise également le dictionnaire de l’assertion d’André Belleau, parue à l’origine dans Liberté et reprise dans son recueil d’essais Y a-t-il un intellectuel dans la salle ?, selon laquelle tout écrivain serait aussi un intellectuel. Un dictionnaire n’étant pas le lieu indiqué pour les développements théoriques, la question y est trop rapidement abordée et mériterait d’être examinée avec plus d’ampleur dans un autre cadre.
Le concept central de l’ouvrage étant pour ainsi dire neutralisé, on retrouve dans ses pages, aux côtés d’intellectuels dans le plein sens du terme, des personnalités dont la présence en ces lieux a de quoi étonner. Prenons pour exemples quelques cas aux extrêmes. Fernand Dumont, Hubert Aquin, Pierre Vadeboncœur et Fernande Saint-Martin devraient faire l’unanimité. Par contraste, le choix des Michel Chartrand et Pierre Elliott Trudeau paraît contestable. Michel Chartrand, d’abord, a défendu ses idées en syndicaliste et en militant. Il est d’ailleurs risible de trouver dans l’article sur son parcours qu’il reçoit chez lui Edgar Morin et Alain Touraine, qu’il lit Le Monde diplomatique, cela étant donné comme preuve de son appartenance à la caste intellectuelle. Comme on le mentionne dans l’article, Chartrand « n’aurait pas revendiqué cette étiquette ». Accepter qu’il ait joué un rôle de premier plan dans l’évolution de la société québécoise, sans être un intellectuel, serait peut-être davantage lui rendre justice (et à ceux qu’il représente) que de forcer son inclusion dans une catégorie hors de laquelle il n’y aurait point de salut. Pour ce qui est de Pierre Elliott Trudeau, bien qu’il ait aspiré au statut d’intellectuel, son action a été avant tout celle d’un politicien. De plus, lui consacrer une entrée est en contradiction avec l’orientation du dictionnaire annonçant que les hommes politiques ne seront pas retenus.
Sur un autre plan, l’utilisation du terme « figure » par différents auteurs du collectif devrait alimenter la réflexion en vue d’une éventuelle réédition. Dans l’introduction, on affirme vouloir proposer une « liste des principales figures d’intellectuel.les de l’histoire du Québec », puis, dans l’article sur Fernand Dumont, on qualifie ce dernier de « plus haute figure intellectuelle » de la seconde moitié du XXe siècle. Par ailleurs, dans l’article sur L’Action française et L’Action nationale, Yvan Lamonde conclut que « davantage de figures intellectuelles que d’intellectuels ont animé les deux revues sur presque cent ans ». À la différence de ses collègues, Lamonde semble considérer les figures intellectuelles comme des personnalités ayant fait carrière dans le monde des idées, sans avoir marqué le champ au point de mériter le titre d’intellectuel. Pourtant, l’affirmation contraire servirait mieux le projet du dictionnaire. Tel qu’il se présente dans sa présente livraison, l’ouvrage donne l’impression de refuser le titre d’intellectuel à celles et ceux qui n’ont pas été retenus pour la publication. L’utilisation systématique de l’expression « figure intellectuelle » pour désigner des intellectuelles et des intellectuels dont l’action a été marquante tiendrait mieux compte de la réalité de l’espace intellectuel. De même, on pourrait éviter la solution typographique « intellectuel.les », répercutée du titre à l’ensemble de l’ouvrage, pour tenir compte de la contribution des femmes. Cette pratique, fortement déconseillée par l’Office québécois de la langue française, nuit à la lisibilité et dénote une attention post-rédaction à la participation des femmes.
Somme toute, que l’on adhère ou non à la perspective du Dictionnaire des intellectuel.les au Québec, l’ouvrage a le mérite de rendre accessible une collection de données constituant à la fois une synthèse et une base de référence. Les entrées ont chacune leur valeur propre et la densité de l’ensemble est due entre autres au fait que la plupart des articles sont rédigés par des spécialistes du sujet traité. Du rapprochement des portraits individuels, de l’accumulation des démarches intellectuelles particulières se dégage également un énoncé transtextuel des aspirations profondes d’une société.
Gérald Baril
CE QU’EN DIT ANDRÉE FERRETTI
Un ouvrage aussi décevant qu’intéressant.
Décevant par les inexpliquées et inexplicables absences de notices consacrées à des personnes répondant en tout point aux critères établis par les concepteurs de l’ouvrage, exposés dans leur introduction. Pour m’en tenir à quatre exemples évidents, je nommerai pour le passé récent : Esdras Minville et Richard Arès ; pour l’immédiat : Djemila Benhabib et Louis Cornellier.
Décevant par l’incomplétude des informations, parfois l’inexactitude dans le contenu des 137 entrées qui construisent l’ouvrage. Pour notre instruction, quelques-unes rendent compte de manière exhaustive de la biographie et de l’œuvre des auteurs. Mais la grande majorité nous laisse sur notre faim.
Intéressant par la mise en lumière, ne serait-ce que par la citation de leur nom, du grand nombre de Québécoises et Québécois qui ont créé, construit et animé la vie culturelle de notre nation, depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à maintenant.
Intéressant, d’une manière remarquable, par l’importance, phénomène inédit, accordée à la contribution des femmes au développement autant qualitatif que quantitatif de la culture savante et populaire, autant référentielle qu’immédiate du Québec.
Bref, un ouvrage qui nécessite de nombreuses améliorations, mais dont nous serions malvenus et malveillants de bouder la première édition.
Pour ma part, je n’hésite pas à en recommander la consultation. Et cela n’a rien à voir avec la fierté que j’éprouve d’avoir été digne d’être évaluée par les auteurs comme une intellectuelle, moi l’autodidacte typique des Québécoises de ma génération.
Ce livre a tout à voir avec la nécessité où notre nation se trouve de se reconnaître comme une nation qui a une riche histoire, une culture unique, un avenir assuré, fondé sur cette histoire et sur cette culture.
Cela pour rappeler que, comme l’affirmait Gaston Miron : « Cela ne pourra pas toujours ne pas arriver », tant est original et créatif notre apport à l’amplitude de la culture humaine.
Andrée Ferretti
1. Sous la dir. d’Yvan Lamonde, Marie-Andrée Bergeron, Michel Lacroix et Jonathan Livernois, Dictionnaire des intellectuel.les au québec, Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 2017, 314 p. ; 45,95 $.