« Quelle est ta route mon pote1 » La question lancée par Dean Moriarty depuis les profondeurs de sa nuit new-yorkaise, il y a de cela près de 60 ans, résonne encore dans tout un pan de la littérature vagabonde du Québec.
À tel point que les réponses offertes par les romanciers se sont même multipliées au cours des dernières années. La rentrée automnale confirme cet engouement en appelant à une modeste cartographie des nouvelles voies/voix de la fiction. Voici donc trois romans pour prendre la clé des champs en compagnie de jeunes auteurs d’ici, trois tentatives originales de réinventer la roue, la route et le voyage.
Go West, Léa
Aller voir ailleurs, si l’herbe n’y pousserait pas plus grasse. La recette a fait date. Chaque génération a d’ailleurs eu droit à ses destinations privilégiées, ses endroits de prédilection. Pour les hippies de la vague psychédélique, l’Eldorado se nichait quelque part en Californie, sur un axe dessiné par San Francisco et Berkeley. Les voyageurs en quête de l’Illumination mystique préféraient encore confluer vers les plages du Mexique, Katmandou ou Pondichéry. Mais depuis quelques années, l’Ouest canadien semble trôner au pinacle de ce prestigieux palmarès en s’attirant les faveurs d’une certaine bohème en mal de nature, de grand air, de rencontres ou simplement d’expériences inédites.

Après Sarah Rocheville, Marie-Christine Lemieux-Couture et Mahigan Lepage2, pour ne nommer qu’eux, c’est au tour de Sara Lazzaroni de nous offrir sa version de la ruée vers l’Ouest. Précocement révélée au monde littéraire québécois, celle-ci a encore la verte vingtaine malgré une feuille de route qui a de quoi faire des envieux. Okanagan3, en effet, est sa troisième publication en autant d’années, mais aussi et surtout un hymne à la jeunesse, à la liberté et à l’aventure entonné par Léa, la narratrice, qui décide un beau matin de rouler vers la mythique vallée du « Bici », là où, dit-on, l’argent pousse dans les arbres. Préposée aux bénéficiaires dans un centre de Québec depuis plus d’un an, Léa sait désormais l’urgence de cueillir les fruits de la vie avant qu’ils ne flétrissent. Ajoutons à cela une peine d’amour vécue à la suite de sa rupture avec Loïc, musicien séduisant doublé d’un habile chanteur de pomme, et le compte y est. Partir devient alors pour elle un moyen d’oublier, de soigner son cœur en déroute, de panser ses blessures en s’ouvrant aux battements du vaste continent. Léa fonce vider son compte à la banque du coin avant de s’engager auprès de Victor, Gaëlle, Cédric et Évelyne, des amis de plus ou moins longue date, à courir les emplois de fruit picking à travers l’Okanagan.
 Une traversée dans un tacot pourri qui rappelle la joyeuse équipée de Further, le « magic bus » de Ken Kesey et de ses joyeux drilles. Peinturlurée à l’aide d’un ventilateur, leur voiture affiche le même esprit festif. Et s’il y a bien en cours de séjour quelques initiations aux champignons magiques en compagnie d’une communauté de déserteurs cosmopolite, c’est plutôt dans le refus du bonheur bourgeois que résident les points communs des deux entreprises : « Je sais que la banlieue est un camp de concentration où l’on tue le temps à coups de tondeuse à gazon ». À plusieurs reprises, la plume de Lazzaroni adopte d’ailleurs le style aphoristique de la maxime zen : « Il ne s’agit pas de simplicité volontaire, mais nécessaire. Le désir meurt dans l’abondance. Le plaisir s’étiole dans la répétition ». Malgré son jeune âge, Léa partage donc la sagesse d’une femme qui a beaucoup vécu. Après avoir récolté les cerises à Oliver, les pommes à Summerland puis à Naramata, elle retourne à son quotidien, les « blues du retour » en bandoulière et l’échec de sa relation avec Loïc toujours à vif, filant sur la route à travers un rai de lumière qui lui procure l’impression d’un proche retour à la sérénité.
Une traversée dans un tacot pourri qui rappelle la joyeuse équipée de Further, le « magic bus » de Ken Kesey et de ses joyeux drilles. Peinturlurée à l’aide d’un ventilateur, leur voiture affiche le même esprit festif. Et s’il y a bien en cours de séjour quelques initiations aux champignons magiques en compagnie d’une communauté de déserteurs cosmopolite, c’est plutôt dans le refus du bonheur bourgeois que résident les points communs des deux entreprises : « Je sais que la banlieue est un camp de concentration où l’on tue le temps à coups de tondeuse à gazon ». À plusieurs reprises, la plume de Lazzaroni adopte d’ailleurs le style aphoristique de la maxime zen : « Il ne s’agit pas de simplicité volontaire, mais nécessaire. Le désir meurt dans l’abondance. Le plaisir s’étiole dans la répétition ». Malgré son jeune âge, Léa partage donc la sagesse d’une femme qui a beaucoup vécu. Après avoir récolté les cerises à Oliver, les pommes à Summerland puis à Naramata, elle retourne à son quotidien, les « blues du retour » en bandoulière et l’échec de sa relation avec Loïc toujours à vif, filant sur la route à travers un rai de lumière qui lui procure l’impression d’un proche retour à la sérénité.
La cavale fantasmée d’un astronome dur à cuire

Si Okanagan présente un récit fidèle aux conventions du genre, L’astronome dur à cuire4 de Jonathan Ruel montre une composition plus ambitieuse, jouant volontiers des miroirs de la fiction et des stratégies d’autoreprésentation. À poursuivre le jeu des comparaisons, on se rend aussi compte que la priorité de Lazzaroni concerne la langue, qu’elle privilégie les images fortes et les phrases qui frappent, tandis que l’écriture de Jonathan Ruel reste discrète, toujours à l’arrière-plan, sur le pilote automatique en quelque sorte. Sa créativité s’exprime donc autrement. En racontant une « histoire à la Bonnie and Clyde », le romancier nous entraîne sur des sentiers moins fréquentés par les romanciers de la route, où l’influence du roman noir de type « hard boiled » joue à plein, comme en témoigne le titre.
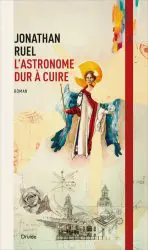 Partis de Boston à bord d’une voiture de location, Jonathan, le narrateur, et Moira, son amie, roulent vers Chicago dans le but de rencontrer Charles Attaway, un éminent spécialiste de l’Évangile apocryphe selon Thomas. Eux-mêmes travaillent de concert sur un projet intitulé L’Évangile secret de Jacques, le frère de Jésus, dont le point de départ est le suivant : Jésus de Nazareth ne serait pas mort sur la croix ; ce serait plutôt son frère jumeau, Judas Thomas, alias Jude, alias Jacques qui, avant d’être crucifié, aurait été empoisonné. Construit autour de la thématique du double et du faux-semblant, ce récit où cohabitent leçons d’herméneutique biblique et théories du complot est raconté par un narrateur imaginatif qui semble avoir trop lu Dashiell Hammett. Ce qui l’amène à plaquer sur cette tranquille excursion un scénario de cavale improbable au cours duquel lui et Moira sont poursuivis par les forces obscures du crime organisé ou par quelque agent de contre-espionnage du même acabit. La réalité rattrape la fiction lorsque arrivé à Chicago, le duo apprend la mort d’Attaway, survenue dans des circonstances suspectes. Comment et pourquoi est-il mort ? Une brève enquête est par la suite menée dans les arcanes du monde universitaire avant que la vérité, d’une étonnante banalité, nous soit enfin dévoilée.
Partis de Boston à bord d’une voiture de location, Jonathan, le narrateur, et Moira, son amie, roulent vers Chicago dans le but de rencontrer Charles Attaway, un éminent spécialiste de l’Évangile apocryphe selon Thomas. Eux-mêmes travaillent de concert sur un projet intitulé L’Évangile secret de Jacques, le frère de Jésus, dont le point de départ est le suivant : Jésus de Nazareth ne serait pas mort sur la croix ; ce serait plutôt son frère jumeau, Judas Thomas, alias Jude, alias Jacques qui, avant d’être crucifié, aurait été empoisonné. Construit autour de la thématique du double et du faux-semblant, ce récit où cohabitent leçons d’herméneutique biblique et théories du complot est raconté par un narrateur imaginatif qui semble avoir trop lu Dashiell Hammett. Ce qui l’amène à plaquer sur cette tranquille excursion un scénario de cavale improbable au cours duquel lui et Moira sont poursuivis par les forces obscures du crime organisé ou par quelque agent de contre-espionnage du même acabit. La réalité rattrape la fiction lorsque arrivé à Chicago, le duo apprend la mort d’Attaway, survenue dans des circonstances suspectes. Comment et pourquoi est-il mort ? Une brève enquête est par la suite menée dans les arcanes du monde universitaire avant que la vérité, d’une étonnante banalité, nous soit enfin dévoilée.
Bien qu’il emprunte des airs intrépides lorsqu’il se prend pour un héros de Dan Brown, l’astronome dur à cuire a pourtant le cœur tendre comme du beurre. Depuis son départ pour l’Université Harvard, où il poursuit des études de doctorat, Jonathan vit sous le signe de la synchronicité une série de rencontres féminines qui ravivent chez lui le souvenir de Marie-Hélène, son ancienne amoureuse laissée en plan quand il avait préféré au Québec l’élite de l’éducation américaine. Le parcours personnel de Jonathan Ruel, lui-même docteur en physique de la prestigieuse reine de la Ivy League, l’a sans doute bien servi au moment d’aborder cet autre aspect de son premier opus, lié de près aux milieux estudiantin et scientifique contre lesquels il se permet au passage quelques piques.
Une quête électrisante dans un monde de la fin
La route, surtout si elle s’inspire du roman ou du film noir américain, est souvent source d’angoisses et d’inquiétudes, qu’elles soient simulées comme dans L’astronome dur à cuire ou non. Sans se réclamer de telles influences, Le fil des kilomètres5, paru à l’origine en 2013 aux éditions de La Peuplade, suggère une atmosphère encore plus anxiogène et suffocante. Le titre de Christian Guay-Poliquin parle ainsi à double sens : le fil des kilomètres fait bien sûr référence au voyage sur la route, mais aussi au vaste réseau de fils électriques qui agit comme le système nerveux de l’Amérique. Or, qu’arrive-t-il quand les nerfs lâchent et que des kilomètres de fils électriques sont soudain court-circuités ? L’univers vacille, le cours normal des choses est détraqué et une suite de réactions en chaîne s’ensuit qui nimbe le monde d’une aura crépusculaire.

Pour suivre les multiples implications de cette stimulante prémisse, le romancier propose un personnage de mécanicien qui quitte son emploi dans un village anonyme de l’Ouest minier. Il part vers l’Est rejoindre son père rongé par l’amnésie. Au total, 4736 kilomètres seront parcourus au cours d’une quête marquée par quelques rencontres, dont celle d’une mystérieuse femme et d’un individu au comportement suspect. Peu à peu, les pertes d’électricité gagnent du terrain, causent le rationnement et l’inflation des biens de consommation. Puis l’anarchie s’installe, effet papillon oblige. Le roman se déchaîne lorsque l’insomnie gagne le narrateur en accentuant le sentiment d’urgence qui tenaille le lecteur. Les nombreux paysages déserts et les villages fantômes sillonnés renforcent l’effet de crise, en plus des personnages déshumanisés s’agitant au cœur de ce monde désincarné ; le mécanicien n’est d’ailleurs jamais nommé, non plus que la femme.
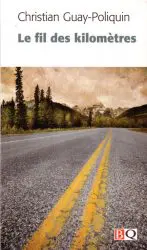 Une trame de fond aux relents de fin du monde s’installe qui n’est pas sans rappeler les Mad Max de Georges Miller ou La route de Cormac McCarthy, dont tout le brio consiste à décrire sur plus de 200 pages le vide laissé par une catastrophe inconnue. Contrairement au ténor des lettres américaines, Guay-Poliquin situe toutefois son récit dans un temps pré-apocalyptique, ce qui lui laisse tout le loisir d’observer la lente dislocation du monde organisé. Et si au premier coup d’œil, la finale à la va-vite nous laisse un peu sur notre faim, la parution d’une suite, Le poids de la neige, au même moment où paraît cette réédition, vient en expliquer la cause. Le fil des kilomètres est un premier roman mené à fond de train, écrit par un mécanicien du style qui a bien compris qu’en voiture comme en littérature, la sobriété a meilleur goût.
Une trame de fond aux relents de fin du monde s’installe qui n’est pas sans rappeler les Mad Max de Georges Miller ou La route de Cormac McCarthy, dont tout le brio consiste à décrire sur plus de 200 pages le vide laissé par une catastrophe inconnue. Contrairement au ténor des lettres américaines, Guay-Poliquin situe toutefois son récit dans un temps pré-apocalyptique, ce qui lui laisse tout le loisir d’observer la lente dislocation du monde organisé. Et si au premier coup d’œil, la finale à la va-vite nous laisse un peu sur notre faim, la parution d’une suite, Le poids de la neige, au même moment où paraît cette réédition, vient en expliquer la cause. Le fil des kilomètres est un premier roman mené à fond de train, écrit par un mécanicien du style qui a bien compris qu’en voiture comme en littérature, la sobriété a meilleur goût.
Déroute, cavale et quête : tels sont, en somme, les points cardinaux vers lesquels tend le roman de la route québécois. Il ressort d’ailleurs de ce bref tour d’horizon une vitalité remarquable et une diversification grandissante de ces pratiques littéraires. En fait, l’état des routes québécoises n’aura jamais mieux paru que dans la fiction romanesque. Quelles directions prendront-elles encore ? L’avenir le dira, même si le mélange des genres, avec le roman noir, celui d’anticipation ou de science-fiction, dessine déjà de belles possibilités et promet d’étendre à d’autres territoires la cartographie de l’imaginaire routier.
* Route des Pionniers à Saint-Séverin (Beauce, novembre 2016). Merci à Eliane Gauvin.
1. Jack Kérouac, Sur la route, Gallimard, Paris, 1960, p. 356.
2. Voir Sarah Rocheville, Go West, Gloria, Leméac, Montréal, 2014, 141 p. ; Marie-Christine Lemieux-Couture, Toutes mes solitudes !, Ta Mère, Montréal, 2012, 304 p. ; Mahigan Lepage, Vers l’Ouest, Mémoire d’encrier, Montréal, 2011, 97 p.
3. Sara Lazzaroni, Okanagan, Leméac, Montréal, 2016, 167 p. ; 19,95 $.
4. Jonathan Ruel, L’astronome dur à cuire, Druide, Montréal, 2016, 520 p. ; 29,95 $.
5. Christian Guay-Poliquin, Le fil des kilomètres, La Peuplade, Chicoutimi, 2013 et Bibliothèque québécoise, Montréal, 2016, 198 p. ; 11,95 $.
EXTRAITS
Ce long pèlerinage pour rejoindre l’utopie d’un paradis perdu, tout au bout de l’océan, de l’autre côté de la terre, un grand rêve fou […].
Okanagan, p. 55.
Pendant que je marchais vers l’hôtel pas cher, la peur qu’il soit miteux a grandi en moi. Il s’est avéré plutôt un motel miteux, ce qui était beaucoup mieux : exactement le genre d’endroit où les criminels se cachent dans les films où ils se font tuer. C’était comme une version moins chère du parc Universal Studios, et sans les files d’attente […].
L’astronome dur à cuire, p. 131.
Nous arrivons aux abords d’une petite ville. Je ralentis à la vue d’une barricade faite de deux immenses troncs d’arbres et de barils de métal. Une dizaine d’hommes font le guet. Ils sont armés. Je me retourne vers le type à l’arrière. Qu’est-ce qu’on fait ?
Le fil des kilomètres, p. 145.











