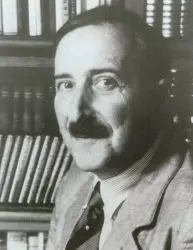Trois décennies de l’histoire européenne vues à travers les lettres1 qu’échangèrent à partir de 1910 deux écrivains qui furent les témoins privilégiés des catastrophes du XXe siècle et des bouleversements qui s’ensuivirent. Tous deux grands épistoliers comme l’étaient alors les écrivains : un total de 945 lettres sont publiées en deux volumes. Un troisième annoncé conduira à la mort de Zweig en 1942 précédant celle de Rolland en 1944.

 La patience qu’exige la lecture de cet impressionnant corpus trouve sa récompense d’abord dans sa qualité littéraire. Parmi les échanges d’informations, vœux de circonstance, récits de démêlés avec les éditeurs, politesses qui composent l’inévitable de semblables correspondances, les auteurs veulent, comme s’ils travaillaient à une œuvre, le mot juste pour décrire une situation, exprimer un sentiment, énoncer un jugement – Zweig écrit souvent directement en français et Rolland recourt au vocabulaire allemand quand il n’existe pas de terme adéquat dans sa langue. La spontanéité des réactions, la vivacité des formules, une certaine impétuosité chez Rolland, plus d’application chez Zweig enrichissent la connaissance intime des deux écrivains. Surtout on y voit l’histoire d’une époque en train de se faire presque au jour le jour, au milieu des événements qui se répercutent sur les deux témoins, mais éclairée, mise déjà en perspective. Et l’on admire ces deux hommes passionnés, épris de justice et de paix, toujours payant de leur personne, ces créateurs d’une puissance de travail stupéfiante quand on songe à la diversité des œuvres en chantier, à leur rythme sans fléchissement malgré les circonstances, qu’accompagnent l’activité journalistique, les tournées de conférences, les rencontres et voyages qui ne cessent pas pendant la guerre (Rolland est alors en Suisse et Zweig son voisin en Autriche, ils peuvent ainsi se rendre visite).
La patience qu’exige la lecture de cet impressionnant corpus trouve sa récompense d’abord dans sa qualité littéraire. Parmi les échanges d’informations, vœux de circonstance, récits de démêlés avec les éditeurs, politesses qui composent l’inévitable de semblables correspondances, les auteurs veulent, comme s’ils travaillaient à une œuvre, le mot juste pour décrire une situation, exprimer un sentiment, énoncer un jugement – Zweig écrit souvent directement en français et Rolland recourt au vocabulaire allemand quand il n’existe pas de terme adéquat dans sa langue. La spontanéité des réactions, la vivacité des formules, une certaine impétuosité chez Rolland, plus d’application chez Zweig enrichissent la connaissance intime des deux écrivains. Surtout on y voit l’histoire d’une époque en train de se faire presque au jour le jour, au milieu des événements qui se répercutent sur les deux témoins, mais éclairée, mise déjà en perspective. Et l’on admire ces deux hommes passionnés, épris de justice et de paix, toujours payant de leur personne, ces créateurs d’une puissance de travail stupéfiante quand on songe à la diversité des œuvres en chantier, à leur rythme sans fléchissement malgré les circonstances, qu’accompagnent l’activité journalistique, les tournées de conférences, les rencontres et voyages qui ne cessent pas pendant la guerre (Rolland est alors en Suisse et Zweig son voisin en Autriche, ils peuvent ainsi se rendre visite).
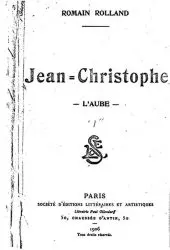 Quand Zweig prend l’initiative de la correspondance, il jouit déjà à Vienne d’un renom assuré dans la nouvelle, la biographie et surtout au théâtre. Rolland, son aîné, qui reçoit le Nobel en 1915, est une figure mondialement admirée. Traduit, lu, joué en Allemagne, il est l’auteur de l’immense roman d’éducation Jean-Christophe, conçu dès les années 1890 et publié en 1912 – le musicien rebelle entre la Rhénanie et Paris qui, tel Beethoven, fait son œuvre géniale ; l’auteur d’études sur la musique, sa grande passion avec le théâtre pour lequel il a déjà écrit Les loups inspiré par l’affaire Dreyfus, d’un Saint Louis ouvrant une série de pièces consacrées à de grandes figures historiques, de biographies de Michel-Ange, Haendel, Tolstoï. Zweig le considère à travers toute la correspondance comme son maître à penser dont il sollicite les conseils et les vues, ce que fait également à l’occasion Rolland en toute humilité, qui verra en Zweig « le dépositaire de [sa] pensée intime d’artiste » (25 novembre 1926). Les deux échangent leurs livres, se racontent, se confient dans leurs doutes, leurs craintes, parlent de leurs amis communs, s’exhortent dans l’épreuve et au milieu de l’isolement que tous deux ressentent douloureusement à garder foi et confiance. Échanges de haute tenue par leur style, leur substance et leur portée. Dans leur lutte commune pour la défense de la paix et celle de la liberté intellectuelle, les deux « combattants de l’esprit » sont présents sur tous les fronts mais les guettent l’épuisement, le désespoir devant le déchaînement des haines nationalistes, « l’union des fanatiques », comme le dit Rolland, devant la trahison des intellectuels dont certains, tel Barrès, embouchèrent bien vite les trompettes guerrières (Verhaeren, qui les avait rapprochés, les déçut cruellement). Horreur devant la folie meurtrière qui domine les esprits, devant la mort partout répandue. Mais il ne faut pas céder au découragement ou au retrait cynique : « Souffrir avec l’humanité, mais non couler au fond avec l’humanité », écrit Rolland en décembre 1917.
Quand Zweig prend l’initiative de la correspondance, il jouit déjà à Vienne d’un renom assuré dans la nouvelle, la biographie et surtout au théâtre. Rolland, son aîné, qui reçoit le Nobel en 1915, est une figure mondialement admirée. Traduit, lu, joué en Allemagne, il est l’auteur de l’immense roman d’éducation Jean-Christophe, conçu dès les années 1890 et publié en 1912 – le musicien rebelle entre la Rhénanie et Paris qui, tel Beethoven, fait son œuvre géniale ; l’auteur d’études sur la musique, sa grande passion avec le théâtre pour lequel il a déjà écrit Les loups inspiré par l’affaire Dreyfus, d’un Saint Louis ouvrant une série de pièces consacrées à de grandes figures historiques, de biographies de Michel-Ange, Haendel, Tolstoï. Zweig le considère à travers toute la correspondance comme son maître à penser dont il sollicite les conseils et les vues, ce que fait également à l’occasion Rolland en toute humilité, qui verra en Zweig « le dépositaire de [sa] pensée intime d’artiste » (25 novembre 1926). Les deux échangent leurs livres, se racontent, se confient dans leurs doutes, leurs craintes, parlent de leurs amis communs, s’exhortent dans l’épreuve et au milieu de l’isolement que tous deux ressentent douloureusement à garder foi et confiance. Échanges de haute tenue par leur style, leur substance et leur portée. Dans leur lutte commune pour la défense de la paix et celle de la liberté intellectuelle, les deux « combattants de l’esprit » sont présents sur tous les fronts mais les guettent l’épuisement, le désespoir devant le déchaînement des haines nationalistes, « l’union des fanatiques », comme le dit Rolland, devant la trahison des intellectuels dont certains, tel Barrès, embouchèrent bien vite les trompettes guerrières (Verhaeren, qui les avait rapprochés, les déçut cruellement). Horreur devant la folie meurtrière qui domine les esprits, devant la mort partout répandue. Mais il ne faut pas céder au découragement ou au retrait cynique : « Souffrir avec l’humanité, mais non couler au fond avec l’humanité », écrit Rolland en décembre 1917.
En 1914, celui-ci a défendu l’indéfendable : alors que la France et l’Allemagne se préparaient à une destruction réciproque totale, il a voulu se placer « au-dessus de la mêlée ». On le lui fit payer très cher. Les attaques venant à la fois des pacifistes et des nationalistes, les inventions calomnieuses, les insultes furent d’autant plus violentes que son prestige était grand. Zweig, moins exposé en Autriche, connaîtra sa part de persécutions surtout aux approches de la Deuxième Guerre, et sa qualité d’écrivain juif le conduira, on le sait, à l’exil et au suicide. Tous deux ont voulu demeurer européens. Rares furent les écrivains qui ne cédèrent pas à l’hystérie nationaliste, y compris Hugo von Hofmannsthal, Thomas Mann, voire au début Rainer Maria Rilke. Cependant un Henri Barbusse, un Heinrich Mann, un Hermann Hesse résistèrent en 1914 ou en 1939. Aujourd’hui encore, même après la guerre du Vietnam et celle d’Algérie, nous avons peine à imaginer le courage qu’il faut pour garder sa lucidité et son jugement dans ces situations extrêmes.
L’époque nouvelle

L’après-guerre vu par les deux écrivains est une période de misère en Allemagne et en Autriche où règnent la famine et le marasme moral. L’inflation vertigineuse, l’enrichissement des industriels et des banquiers pendant la guerre, la haine revancharde alimentent les troubles sociaux et politiques provoqués à la fois par les communistes et l’extrême droite qui conduisent à l’assassinat du chancelier Rathenau que Zweig a approché (« un souvenir prodigieux… jamais l’Allemagne n’a eu comme ministre un homme de cette qualité, d’une telle supériorité »). Rolland s’enflamme : « Les misérables fous ! Par amour furieux pour l’Allemagne ils ont tué les plus grands hommes de l’Allemagne » (25 juin 1922). La faible République de Weimar ne résistera pas. Alors que progressent la volonté haineuse de revanche et le rêve pangermaniste, tout est propice à l’ascension de Hitler (qui apparaîtra dans le troisième tome de la correspondance).
Les deux écrivains sont sans illusions sur l’époque nouvelle. Dès 1923, Zweig voit lucidement « la rage rouge » qui explosera. Tout aussi inquiet, Rolland, qui à cette époque s’intéresse à l’action de Gandhi (ils se rencontreront en Suisse), aimerait pouvoir, comme il l’a inlassablement proclamé, « réanimer entre les peuples un pâle sentiment de fraternité morale, issu d’une compassion mutuelle » (18 juillet 1915), même s’il voit l’Occident « condamné à la ruine ». Tous deux continuent à écrire par besoin profond, « parce qu’il faut vivre pour les choses éternelles », réaffirme Rolland.
Nous connaissons la suite. La Deuxième Guerre que tout annonçait, l’exil de Zweig au Brésil où, complètement désespéré devant l’effondrement du « monde d’hier », il se donnera la mort. Rolland échoue à créer une véritable communauté d’esprits libres. Dans sa retraite du Vézelay, devenu suspect au gouvernement de Vichy, il meurt peu après le débarquement allié.
Lutteurs pour la paix
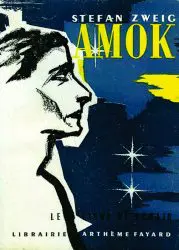 Si l’étoile de Romain Rolland a pâli – son œuvre littéraire a vieilli, surtout par son lyrisme un peu indiscret, son enthousiasme qui n’est plus à la mode du jour quand il évoque les figures des grands créateurs –, cette correspondance illustre sa figure d’intellectuel exemplaire, courageux, intransigeant dans sa défense des valeurs humanistes, refusant les compromissions dans lesquelles ont glissé tant de ses confrères. L’œuvre de Zweig par contre semble trouver de nouveaux lecteurs qui vont surtout à ses remarquables recueils de nouvelles et romans (Amok, La confusion des sentiments, Vingt-quatre heures de la vie d’une femme) et à ses biographies (dont Trois maîtres : Balzac, Dickens, Dostoïevski), mais n’oublions pas qu’il fut en son temps plus qu’un amoureux des livres, du théâtre, de la musique et s’est voulu engagé dans l’action.
Si l’étoile de Romain Rolland a pâli – son œuvre littéraire a vieilli, surtout par son lyrisme un peu indiscret, son enthousiasme qui n’est plus à la mode du jour quand il évoque les figures des grands créateurs –, cette correspondance illustre sa figure d’intellectuel exemplaire, courageux, intransigeant dans sa défense des valeurs humanistes, refusant les compromissions dans lesquelles ont glissé tant de ses confrères. L’œuvre de Zweig par contre semble trouver de nouveaux lecteurs qui vont surtout à ses remarquables recueils de nouvelles et romans (Amok, La confusion des sentiments, Vingt-quatre heures de la vie d’une femme) et à ses biographies (dont Trois maîtres : Balzac, Dickens, Dostoïevski), mais n’oublions pas qu’il fut en son temps plus qu’un amoureux des livres, du théâtre, de la musique et s’est voulu engagé dans l’action.
On pourrait conclure à l’échec de l’entreprise de ces deux lutteurs pour la paix – dans la mesure où ce terme d’« échec » a ici un sens – et cependant ils ont semé. La réconciliation s’est faite entre la France et l’Allemagne et, il y a un demi-siècle déjà, ils ont entrevu ce que pourrait être une Europe authentique. Mais, une fois encore la lutte est à reprendre car les vieux démons du nationalisme hargneux et égoïste qu’on croyait morts resurgissent. Quand il faudrait coopérer, venir en aide aux migrants chassés de leur pays par la guerre, des pays se clôturent de barbelés. Chacun pour soi ! Rolland, Zweig et quelques autres ont voulu une Europe qui ne serait pas celle que nous voyons aujourd’hui, un marché ouvert à la spéculation sauvage où s’échangent des capitaux. Les deux intellectuels, avec leurs moyens, ont nourri le rêve d’une communauté des bonnes volontés qui travailleraient à la paix et au progrès moral des peuples.
* Photo de Stefan Zweig : ©Rue des Archives
1. Romain Rolland et Stefan Zweig, Correspondance, trad. par Siegrun Barat, Albin Michel, Paris : 1910-1919, 2014, 637 p., 56,95 $ ; 1920-1927, 2015, 731 p., 60,95 $.
EXTRAITS
L’amertume des masses finit par contaminer aussi l’individu. Vous-même, vous n’y échappez pas entièrement à Paris, du moins plus difficilement qu’en Suisse. Et malgré tout, je sais que je conserverai ma richesse intérieure intacte pour la nouvelle époque, cette trinité se composant d’un enthousiasme joyeux, de l’amour du prochain et de la volonté de se sacrifier. Moi aussi je resterai fidèle à l’Europe, à tous ses pays, et à tous ses hommes. Oui, je suis terriblement impatient en observant tous les jours de nouvelles choses se désagréger, impatient de pouvoir participer à leur reconstruction.
Zweig, 21 novembre 1914.
Que de fois mes amis de Paris – mes anciens amis, séparés de moi maintenant – m’ont rappelé et opposé le mot qui termine un de mes drames révolutionnaires – le mot de Saint-Just à la fin de Danton : « les hommes meurent, pour que Dieu vive ! » – Il y a 20 ans que je l’ai écrit. Depuis, j’ai continué ma route. Mais le public est un troupeau paresseux, qui vient longtemps après brouter la trace de vos pas, et qui reste accroché à vos paroles mortes.
Je suis plus isolé, à présent, dans ma France que dans le reste du monde. Pour continuer à y vivre et penser, je dois créer moi-même l’air que je respire.
Je ne me plains pas. Je comprends que cela soit ainsi. La France est héroïque et souffre ; elle ne peut point distraire sa pensée du combat ; à peine songe-t-elle à lécher ses blessures. Daniel lui-même, s’il s’était trouvé dans la fosse avec un lion de cette espèce, il eût été croqué.
Rolland, 4 mai 1915.
C’est maintenant un moment pour finir. Un nouveau monde commence, de nouvelles luttes. Je sens une ivresse dans l’air, ivresse sainte de la joie et en même temps ivresse des foules, qui se sont saoulées de l’odeur du sang. Il y a du rouge à l’horizon : est-ce la nouvelle aurore, est-ce la lueur d’un bûcher énorme qui brûlera toute notre culture ? Je ne sais pas. Mais je sens avec tous mes nerfs qu’une telle crise ne peut pas finir avec un simple apaisement. Nous verrons encore, spectateurs émus, de nouvelles scènes d’une nouvelle tragédie.
Zweig, 18 novembre 1918.