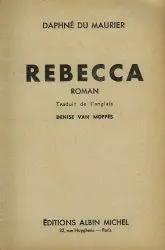Pour beaucoup de cinéphiles, Rebecca (1940) reste l’un des meilleurs longs métrages d’Alfred Hitchcock et son premier classique tourné à Hollywood, après une longue carrière de deux décennies en Grande-Bretagne.
Paru en 1938, le roman avait été traduit une première fois en français en 1940. La rencontre entre le maître du suspense et Daphné du Maurier (1907-1989) n’était pas fortuite ; un an avant Rebecca, Hitchcock avait déjà porté à l’écran un autre roman de l’auteure, L’auberge de la Jamaïque (Jamaica Inn, en 1939), et il allait récidiver avec la nouvelle « Les oiseaux » (en 1963).
 L’intrigue est simple : une jeune orpheline (jouée dans le film par Joan Fontaine) épouse un riche veuf anglais, Maxim de Winter (Laurence Olivier), et s’installe à Manderley, son domaine de Cornouailles. Tout semble les opposer : leur caractère, leur âge, leur statut social ; elle s’intéresse de loin aux mondanités inaccessibles, alors que Maxim a toujours vécu dans le luxe et le pouvoir. Intimidée par la somptuosité des lieux et par l’entourage hautain de son mari, la jeune mariée doit cependant apprendre à vivre dans l’ombre de madame Rebecca de Winter, l’épouse précédente. Rapidement, la narratrice de qui tout le monde parle constate amèrement que les ragots circulent allégrement à son sujet, du moins le croit-elle : « Il l’a ramassée à Monte-Carlo ou un endroit comme ça. Elle n’avait pas un sou ». Mais c’est autour de Rebecca que se tisse toute l’intrigue, amplifiée par la mort mystérieuse de cette dernière.
L’intrigue est simple : une jeune orpheline (jouée dans le film par Joan Fontaine) épouse un riche veuf anglais, Maxim de Winter (Laurence Olivier), et s’installe à Manderley, son domaine de Cornouailles. Tout semble les opposer : leur caractère, leur âge, leur statut social ; elle s’intéresse de loin aux mondanités inaccessibles, alors que Maxim a toujours vécu dans le luxe et le pouvoir. Intimidée par la somptuosité des lieux et par l’entourage hautain de son mari, la jeune mariée doit cependant apprendre à vivre dans l’ombre de madame Rebecca de Winter, l’épouse précédente. Rapidement, la narratrice de qui tout le monde parle constate amèrement que les ragots circulent allégrement à son sujet, du moins le croit-elle : « Il l’a ramassée à Monte-Carlo ou un endroit comme ça. Elle n’avait pas un sou ». Mais c’est autour de Rebecca que se tisse toute l’intrigue, amplifiée par la mort mystérieuse de cette dernière.
Cette parution de Rebecca1, dans une nouvelle traduction de l’anglais par Anouk Neuhoff, étonnera par son style. La comparaison proposée en quatrième de couverture avec Les Hauts de Hurlevent ou Jane Eyre semblera sans doute exagérée ; pour le lecteur du XXIe siècle, cet ouvrage s’apparentant plutôt à la littérature populaire actuelle pourra sembler léger, voire superficiel. En lisant les dialogues du roman, on pense aux films Sissi avec Romy Schneider.
Indirectement, on comprend tout le génie d’Hitchcock en lisant ce « livre jamais lu » par plusieurs cinéphiles qui, dans bien des cas, auront découvert le film avant de lire le roman.
Portrait de l’auteure
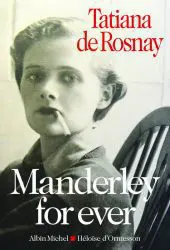 En dépit de ce que son titre anglais laisse entendre, Manderley for ever2 a été rédigé en français. Romancière et anglophile, Tatiana de Rosnay propose un portrait de la prolifique Daphné du Maurier. Le titre fait allusion au domaine qu’habite la jeune épouse dans Rebecca, roman dont la genèse, l’écriture, les ventes en librairie, les différences entre les versions anglaise et française, et l’adaptation au cinéma par Hitchcock – un homme que l’auteure n’appréciait pas du tout – sont ici racontées. Daphné du Maurier a elle aussi habité un vaste domaine dans la région de Cornouailles (Cornwall), au sud de la Grande-Bretagne. Elle a épousé le major Browning, un vétéran tourmenté de la Grande Guerre, ce qui a bouleversé son quotidien de romancière : « Ce que Daphné redoute le plus, sa mère le comprend vite, c’est le rôle d’épouse de militaire qu’elle doit désormais assumer. Quel ennui, ces dames à saluer, ces dîners fastidieux, ces conversations fades, ce rang à tenir ».
En dépit de ce que son titre anglais laisse entendre, Manderley for ever2 a été rédigé en français. Romancière et anglophile, Tatiana de Rosnay propose un portrait de la prolifique Daphné du Maurier. Le titre fait allusion au domaine qu’habite la jeune épouse dans Rebecca, roman dont la genèse, l’écriture, les ventes en librairie, les différences entre les versions anglaise et française, et l’adaptation au cinéma par Hitchcock – un homme que l’auteure n’appréciait pas du tout – sont ici racontées. Daphné du Maurier a elle aussi habité un vaste domaine dans la région de Cornouailles (Cornwall), au sud de la Grande-Bretagne. Elle a épousé le major Browning, un vétéran tourmenté de la Grande Guerre, ce qui a bouleversé son quotidien de romancière : « Ce que Daphné redoute le plus, sa mère le comprend vite, c’est le rôle d’épouse de militaire qu’elle doit désormais assumer. Quel ennui, ces dames à saluer, ces dîners fastidieux, ces conversations fades, ce rang à tenir ».
Francophile dès son jeune âge, Daphné s’enorgueillit de son patronyme à consonance française, de sa particule nobiliaire (« du »), de sa capacité de parler le français presque aussi bien que l’anglais. Pourtant, au pensionnat, elle subit l’humiliation d’être reléguée dans le niveau moyen de français. Son enfance est racontée avec précision (tout le premier quart du livre). Dans ce milieu élitiste des années 1920, elle connaît une amitié trouble avec la directrice du pensionnat français, mademoiselle Fernande Yvon, qu’elle qualifie de « vénitienne », c’est-à-dire d’homosexuelle, selon son lexique personnel. La biographe cite un extrait d’une lettre de la jeune Daphné du Maurier la décrivant en des termes sans équivoque : « Une attraction fatale ! Elle m’a littéralement ensorcelée ».

Dès 1932, elle connaît des succès littéraires répétés, alors que son mariage commence à battre de l’aile. En dépit de toutes les mauvaises critiques pour la plupart de ses romans et de deux procès pour plagiat, Daphné du Maurier est considérée en 1951 comme la romancière la mieux payée du Royaume-Uni.
De nombreux extraits des écrits intimes de l’écrivaine sont cités. Mais on se demande si on ne devrait pas plutôt lire les journaux intimes de la principale intéressée au lieu de ce récit indirect. La lecture de ces carnets permettrait de goûter directement au style de l’époque. Toutefois, la biographie vivante de Tatiana de Rosnay fournit au lecteur du XXIe siècle l’indispensable mise en contexte, par exemple sur les non-dits quant aux penchants homophiles de Daphné.
1. Daphné du Maurier, Rebecca, trad. de l’anglais par Anouk Neuhoff, Albin Michel, Paris, 2015, 534 p. ; 36,95 $.
2. Tatiana de Rosnay, Manderley for ever, Albin Michel/Héloïse d’Ormesson, Paris, 2015, 457 p. ; 32,95 $.
Incipit de Rebecca traduit par Denise van Moppès, puis, en 2015, par Anouk Neuhoff
J’ai rêvé l’autre nuit que je retournais à Manderley. J’étais debout près de la grille devant la grande allée, mais l’entrée m’était interdite, la grille fermée par une chaîne et un cadenas. J’appelai le concierge et personne ne répondit ; en regardant à travers les barreaux rouillés, je vis que la loge était vide.
Aucune fumée ne s’élevait de la cheminée et les petites fenêtres mansardées bâillaient à l’abandon. Puis je me sentis soudain douée de la puissance merveilleuse des rêves et je glissai à travers les barreaux comme un fantôme. L’allée s’étendait devant moi avec sa courbe familière, mais à mesure que j’y avançais, je constatais sa métamorphose : étroite et mal entretenue, ce n’était plus l’allée d’autrefois. Je m’étonnai d’abord, et ce ne fut qu’en inclinant la tête pour éviter une branche basse que je compris ce qui était arrivé. La Nature avait repris son bien, et, à sa manière insidieuse, avait enfoncé dans l’allée ses longs doigts tenaces, avait fini par triompher.
Rebecca, trad. de l’anglais par Denise van Moppès, Le Livre de Poche, 1981.
J’ai rêvé la nuit dernière que je retournais à Manderley. Je me tenais près de la grille qui donnait sur l’allée, mais impossible d’entrer : le portail était fermé par un cadenas et une chaîne. J’appelais le gardien. Personne ne répondait. Regardant mieux entre les barreaux rouillés, je vis que le pavillon était inhabité.
Aucune fumée ne sortait de la cheminée, et les petites fenêtres à carreaux losangés étaient ouvertes, abandonnées. À ce moment-là, comme il arrive dans les rêves, je me trouvais soudain investie de pouvoirs surnaturels et traversais tel un esprit la grille qui me bouchait le passage. L’allée serpentait devant moi avec ses méandres habituels, mais à mesure que je progressais, je m’avisais d’un changement : étroite et mal entretenue, ce n’était plus l’allée que nous avions connue. D’abord déconcertée, je ne comprenais pas, et ce n’est qu’en penchant la tête pour éviter une branche basse que je m’aperçus de ce qui était arrivé. La nature avait repris ses droits et, petit à petit, à sa manière furtive et insidieuse, elle avait gagné sur l’allée en étendant ses longs doigts opiniâtres.
Rebecca, trad. de l’anglais par Anouk Neuhoff, Albin Michel, 2015.