À partir de 1858, entre Aix où est née leur amitié et Paris, deux collégiens commencent à échanger des lettres1. Ils rêvent de gloire et d’amour : Émile veut devenir poète, Paul, peintre. Celui-là sera, après Balzac et Flaubert, le romancier admiré et attaqué des Rougon-Macquart, celui-ci la référence en peinture moderne.
D’abord presque quotidiennes, souvent de longues épîtres, fiévreuses et drôles, naïves ou graves, elles s’espacent selon les époques et les aléas de leur parcours, avec des lacunes. Ces silences ont conduit les commentateurs à d’imprudentes interprétations alors qu’ils s’expliquent par les fréquentes visites que s’échangeaient les deux amis et parce que les lettres n’ont pas toutes été retrouvées. La correspondance retrouvée en compte cependant plus d’une centaine quand elle s’achèvera, ou se perdra, en 1887.
 Émile a perdu jeune son père qui était ingénieur, sa mère lutte pour subvenir aux besoins de la famille. Pendant des années il connaîtra une extrême pauvreté à Paris. Ses romans oseront décrire la misère par l’expérience directe et non comme une fiction. Ses rêves vont se heurter à une impitoyable réalité sociale. En comparaison, Paul, fils de banquier, a une enfance plus confortable, mais il se débattra longtemps contre l’autorité paternelle étouffante. Le récit de leur quotidien respectif tient évidemment beaucoup de place dans leurs échanges adolescents avec des plaisanteries, de l’autodérision, des assurances d’amitié. En 1860 Zola écrit : « […] nous nous connaissons trop parfaitement pour jamais nous détacher » – et ils ne le feront jamais. Ces longues missives consignent des espérances amoureuses, des projets, accompagnent les envois des premiers textes sortis de leur plume. Intérêt anecdotique pour le lecteur d’aujourd’hui mais aussi des surprises : tous deux manifestent une infatigable facilité à versifier, par milliers des vers de mirliton parmi des morceaux poétiques inspirés par leur commune admiration pour Musset. Imagine-t-on Zola poète, et Cézanne aussi ? Déjà, une confiance jamais démentie dans le talent et l’avenir de l’autre, des encouragements à persévérer, et tous les deux en auront grand besoin ! Cézanne est sensible à la littérature et formule des critiques pertinentes sur les livres de Zola, et n’oublions pas que ce dernier aura une longue et tumultueuse expérience de la critique d’art quand il dénoncera la peinture académique de Bouguereau, Meissonier et autres Cabanel qui font la loi et qu’il prendra fait et cause pour Manet tant décrié (Zola est un des seuls avec Baudelaire à défendre Olympia en 1863 contre le torrent d’insultes déversé sur l’œuvre), pour Monet, Renoir, Pissaro et bien sûr son ami, l’éternel refusé des salons.
Émile a perdu jeune son père qui était ingénieur, sa mère lutte pour subvenir aux besoins de la famille. Pendant des années il connaîtra une extrême pauvreté à Paris. Ses romans oseront décrire la misère par l’expérience directe et non comme une fiction. Ses rêves vont se heurter à une impitoyable réalité sociale. En comparaison, Paul, fils de banquier, a une enfance plus confortable, mais il se débattra longtemps contre l’autorité paternelle étouffante. Le récit de leur quotidien respectif tient évidemment beaucoup de place dans leurs échanges adolescents avec des plaisanteries, de l’autodérision, des assurances d’amitié. En 1860 Zola écrit : « […] nous nous connaissons trop parfaitement pour jamais nous détacher » – et ils ne le feront jamais. Ces longues missives consignent des espérances amoureuses, des projets, accompagnent les envois des premiers textes sortis de leur plume. Intérêt anecdotique pour le lecteur d’aujourd’hui mais aussi des surprises : tous deux manifestent une infatigable facilité à versifier, par milliers des vers de mirliton parmi des morceaux poétiques inspirés par leur commune admiration pour Musset. Imagine-t-on Zola poète, et Cézanne aussi ? Déjà, une confiance jamais démentie dans le talent et l’avenir de l’autre, des encouragements à persévérer, et tous les deux en auront grand besoin ! Cézanne est sensible à la littérature et formule des critiques pertinentes sur les livres de Zola, et n’oublions pas que ce dernier aura une longue et tumultueuse expérience de la critique d’art quand il dénoncera la peinture académique de Bouguereau, Meissonier et autres Cabanel qui font la loi et qu’il prendra fait et cause pour Manet tant décrié (Zola est un des seuls avec Baudelaire à défendre Olympia en 1863 contre le torrent d’insultes déversé sur l’œuvre), pour Monet, Renoir, Pissaro et bien sûr son ami, l’éternel refusé des salons.
Nous lisons évidemment cette correspondance dans sa chronologie mais, aidés par les substantielles introductions et synthèses d’Henri Mitterand, grand connaisseur de Zola, nous sommes constamment induits à regarder vers le futur des deux amis. Comment leur œuvre prend forme, comment leur esthétique se constitue, dans un commun refus de l’effet séducteur et du plat réalisme. C’est là, bien au-delà du document biographique et du tout-venant factuel, l’intérêt de la correspondance de deux créateurs.
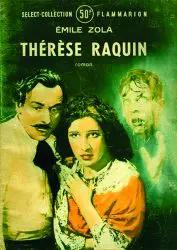 Les années passent, qui parfois apportent bien de l’amertume, les échecs, le découragement, une tenace nostalgie de la vie à Aix, de ses paysages et de sa lumière, les souvenirs des réunions, discussions, baignades et beuveries, mais peu à peu les compagnons se dispersent et se perdent. Depuis leur adolescence, tous deux ont cherché à retrouver l’amitié stimulante et joyeuse de petits groupes – même si le caractère ombrageux et difficile de Cézanne est bien connu. En 1870, le « groupe des Batignolles » se disperse lors de la mobilisation contre la Prusse. Cézanne, réfractaire, se cache. Zola va à Bordeaux. L’Empire de Napoléon III s’effondre dans la honte. L’insurrection de la Commune éclate, qui sera, comme on le sait, réprimée dans le sang par le gouvernement de l’ordre bourgeois reconstitué. Zola, très critique, est également suspect à la Commune et aux tenants de la IIIe République qui lui succède. Il poursuit une intense activité de journaliste à la fois artistique et politique. Infatigable travailleur, il met en forme dans Thérèse Raquin son premier véritable succès littéraire (1867), sa théorie du roman : montrer l’élémentaire chez les êtres humains, les pulsions refoulées, et horreur ! les composantes physiologiques et héréditaires, mais aussi un souci de construction rigoureuse, d’accord des couleurs, préoccupations proches de celles de Cézanne.
Les années passent, qui parfois apportent bien de l’amertume, les échecs, le découragement, une tenace nostalgie de la vie à Aix, de ses paysages et de sa lumière, les souvenirs des réunions, discussions, baignades et beuveries, mais peu à peu les compagnons se dispersent et se perdent. Depuis leur adolescence, tous deux ont cherché à retrouver l’amitié stimulante et joyeuse de petits groupes – même si le caractère ombrageux et difficile de Cézanne est bien connu. En 1870, le « groupe des Batignolles » se disperse lors de la mobilisation contre la Prusse. Cézanne, réfractaire, se cache. Zola va à Bordeaux. L’Empire de Napoléon III s’effondre dans la honte. L’insurrection de la Commune éclate, qui sera, comme on le sait, réprimée dans le sang par le gouvernement de l’ordre bourgeois reconstitué. Zola, très critique, est également suspect à la Commune et aux tenants de la IIIe République qui lui succède. Il poursuit une intense activité de journaliste à la fois artistique et politique. Infatigable travailleur, il met en forme dans Thérèse Raquin son premier véritable succès littéraire (1867), sa théorie du roman : montrer l’élémentaire chez les êtres humains, les pulsions refoulées, et horreur ! les composantes physiologiques et héréditaires, mais aussi un souci de construction rigoureuse, d’accord des couleurs, préoccupations proches de celles de Cézanne.
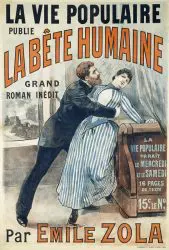
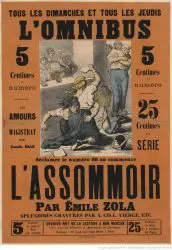 Le lecteur de la correspondance attend impatiemment d’être éclairé sur l’épisode de L’œuvre (roman publié en 1886). Zola aurait pris Cézanne pour modèle de son peintre Claude Lantier dont la vie se solde par un échec et un suicide. Cézanne se serait reconnu et aurait rompu avec Zola. Mitterand montre que cette hypothèse repose sur un contresens. Claude et son prétendu modèle n’ont ni le même âge ni la même esthétique. Des témoignages contradictoires existent sur les critiques que se seraient adressées les deux créateurs et qui auraient conduit à leur rupture. Une lettre de 1887 récemment retrouvée montre qu’il n’en fut rien. Certes tous deux ont évolué dans des directions différentes. Cézanne a besoin de solitude et de silence, alors que Zola s’engagera dans l’affaire Dreyfus avec son célèbre « J’accuse…! » Zola, quand il a connu la célébrité et la fortune, a continué d’aider financièrement Cézanne, qui peine toujours à se faire reconnaître. Le succès de Zola a son envers, car il a été férocement pris à partie et insulté par la critique bien-pensante : il s’attaquait à des tabous bien enracinés, il dérangeait en dénonçant la corruption de la société française de l’époque, la toute-puissance de l’argent et la condition des classes populaires (en particulier dans L’assommoir, 1877). Quand en 1906 Zola est mort dans des circonstances obscures qui laissent croire à un meurtre, Cézanne a « éclaté en sanglots ». Certes le dialogue semble s’être réduit dans les dernières années mais, dit Mitterand, « qui peut assurer que l’essentiel n’a pas survécu jusqu’à la fin, muet mais intact, dans l’identité de la quête et l’accord des mémoires ? »
Le lecteur de la correspondance attend impatiemment d’être éclairé sur l’épisode de L’œuvre (roman publié en 1886). Zola aurait pris Cézanne pour modèle de son peintre Claude Lantier dont la vie se solde par un échec et un suicide. Cézanne se serait reconnu et aurait rompu avec Zola. Mitterand montre que cette hypothèse repose sur un contresens. Claude et son prétendu modèle n’ont ni le même âge ni la même esthétique. Des témoignages contradictoires existent sur les critiques que se seraient adressées les deux créateurs et qui auraient conduit à leur rupture. Une lettre de 1887 récemment retrouvée montre qu’il n’en fut rien. Certes tous deux ont évolué dans des directions différentes. Cézanne a besoin de solitude et de silence, alors que Zola s’engagera dans l’affaire Dreyfus avec son célèbre « J’accuse…! » Zola, quand il a connu la célébrité et la fortune, a continué d’aider financièrement Cézanne, qui peine toujours à se faire reconnaître. Le succès de Zola a son envers, car il a été férocement pris à partie et insulté par la critique bien-pensante : il s’attaquait à des tabous bien enracinés, il dérangeait en dénonçant la corruption de la société française de l’époque, la toute-puissance de l’argent et la condition des classes populaires (en particulier dans L’assommoir, 1877). Quand en 1906 Zola est mort dans des circonstances obscures qui laissent croire à un meurtre, Cézanne a « éclaté en sanglots ». Certes le dialogue semble s’être réduit dans les dernières années mais, dit Mitterand, « qui peut assurer que l’essentiel n’a pas survécu jusqu’à la fin, muet mais intact, dans l’identité de la quête et l’accord des mémoires ? »
Cette correspondance est riche et souvent émouvante, mais plus que cela. Elle éclaire l’histoire de deux vocations créatrices tôt pressenties, qui se réaliseront à force de travail, de volonté, d’exigence, d’obstacles surmontés et – il faut employer des mots aujourd’hui tombés en désuétude – portées par un rêve de beauté et de vérité.
* Paul Cézanne, Une lecture de Paul Alexis chez Zola (1869-1870) | Source : societe-cezanne.fr
1. Paul Cézanne et Émile Zola, Lettres croisées, 1858-1887, édition établie, présentée et annotée par Henri Mitterand, Gallimard, Paris, 2016, 435 p. ; 41,95 $.
EXTRAITS
Il y a dix ans que nous parlons arts et littérature […]. Nous vivions dans notre ombre, isolés, peu sociables, nous plaisant dans nos pensées. Nous nous sentions perdus au milieu de la foule complaisante et légère. Nous […] voulions dans chaque œuvre, tableau ou poème, trouver un accent personnel. Nous affirmions que les maîtres, les génies, sont des créateurs qui, chacun, ont créé un monde de toutes pièces. […] Sais-tu que nous étions des révolutionnaires sans le savoir ?
Zola, 20 mai 1866.
Mais vois-tu, tous les tableaux faits à l’intérieur, dans l’atelier, ne vaudront jamais les choses faites en plein air. En représentant des scènes du dehors, les oppositions des figures sur les terrains sont étonnantes, et le paysage est magnifique. Je vois des choses superbes, et il faut que je me résolve à ne faire que des choses en plein air.
Cézanne, 19 octobre 1866.
Mon cher Émile, je viens de recevoir L’œuvre que tu as bien voulu m’adresser. Je remercie l’auteur des Rougon Macquart de ce bon témoignage de souvenir, et je lui demande de me permettre de lui serrer la main en songeant aux anciennes années. Tout à toi sous l’impression des temps écoulés. .
Cézanne, 4 avril 1886.











