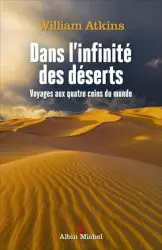William Atkins, journaliste et auteur britannique, décide d’entreprendre, après ce qui semble une rupture amoureuse, un périple qui le mènera aux quatre coins du monde, dans quelques-uns des grands déserts de la planète. Son essai, Dans l’infinité des déserts1, se lit comme le compte rendu de cette aventure.
On y trouve – comme il se doit – moult détails sur la nature de ces déserts, mais on y croise également de nombreuses figures qui ont hanté ces espaces au fil des siècles. L’auteur y parle aussi de ses rencontres avec les gens du cru et des conditions parfois difficiles de son voyage. Le tout parsemé de considérations philosophiques et de réflexions métaphysiques.
On croit comprendre, en lisant le premier chapitre consacré au désert du Quart Vide, que le périple d’Atkins est une quête spirituelle pour atteindre ce que les explorateurs polaires appellent le « pôle d’inaccessibilité maximale ». Il décrit ainsi « le but ultime de tout voyageur du désert : le point où convergent absolu et infini ». Plus loin, il ajoute : « [C]’est un lieu de dévotion et de contemplation […] qui s’appréhende à travers […] le filtre biblique ». Dans les chapitres suivants, cette apparente recherche mystique sera mise en sourdine avant de réapparaître au dernier chapitre consacré au désert Arabique, situé en Égypte.
Seconde étape de son voyage : le grand désert de Victoria, en Australie. Ici, l’attention de l’auteur glisse du désert vers les peuples aborigènes qui l’ont habité pendant 50 000 ans. Au XXe siècle, ce fut à cet endroit que la Grande-Bretagne procéda à ses premiers essais nucléaires sans tenir compte, bien sûr, des conséquences sur les populations locales. Ces essais ont rendu ce désert inhabitable à jamais avec d’énormes répercussions sur le mode de vie des aborigènes réduits à l’exil sur leur propre terre, sans compter les terribles effets des radiations sur la santé de ces populations. Ici, un désert atomique créé par l’homme s’est superposé au désert façonné par la nature.
Les deux chapitres suivants sont consacrés aux trois grands déserts d’Asie centrale : le Gobi, le Taklamakan, l’Aralkum, au Kazakhstan. Ici, plus fréquemment que dans les autres chapitres, Watkins évoque la figure de ceux et celles qui sont venus, avant lui, affronter ces infinis désertiques. Il rappelle en particulier celle de Mildred Cable et de ses deux compagnes, missionnaires débarquées en Chine en 1901 pour apporter la parole de Dieu sur la terre d’exil que constituait (et que constitue toujours) l’extrême ouest chinois. Son territoire de mission couvrait un espace grand comme la France, l’Allemagne et l’Italie réunies que traversait la mythique route de la soie et où se trouvent les déserts de Gobi et le Taklamakan, dont elle arpenta les pistes pendant des décennies. Ses nombreux écrits, dans lesquels Atkins a abondamment puisé, enrichissent considérablement la trame de son récit et le plaisir qu’en tire le lecteur.
Un désert fait main
L’Aralkum, comme son nom le suggère, est situé dans la région de ce qui reste de la mer d’Aral. C’est un désert de sable et de sel fait entièrement de main d’homme. En effet, contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’assèchement de la mer d’Aral n’est pas dû aux conditions climatiques, mais au fait que, depuis des décennies, on détourne les eaux qui la nourrissent pour irriguer les champs de coton situés en amont. Or, comme la mer d’Aral est une mer endoréique, c’est-à-dire régulée uniquement par l’évaporation, elle s’épuise et se tarit faute d’être alimentée. Dans ce chapitre, Watkins évoque aussi longuement la destinée tragique de Taras Chevtchenko, une grande figure de l’histoire ukrainienne, relégué au Kazakhstan au milieu du XIXesiècle pour des raisons politiques et dont subsistent aujourd’hui des aquarelles et des poèmes qui illustrent la beauté et la rudesse des lieux. Quelques-uns d’entre eux sont reproduits dans le livre.
Avant-dernière étape de son périple : les États-Unis. Installé temporairement dans une casita à Tucson, en Arizona, Atkins choisit d’arpenter deux déserts, celui de Sonora, situé littéralement sur le pas de sa porte, et celui de Black Rock, au Nevada. Après les données d’usage sur la géomorphologie de ces déserts, il évoquera le premier comme le lieu de passage des migrants venus d’Amérique centrale pour rejoindre l’Eldorado que représentent pour eux les États-Unis. L’auteur raconte s’être joint à un groupe de citoyens déterminés à venir en aide à ces migrants en leur fournissant eau et vêtements pour qu’ils puissent traverser le désert sans y trouver la mort. En parallèle, il évoque également les miliciens qui, pour leur part, se donnent pour mission de protéger leur pays de ces étrangers. En cela, son témoignage, si admirable soit-il, n’apporte pas d’éclairage neuf sur les conflits sociaux qui déchirent l’Amérique actuelle et dont la question de l’immigration est l’une des illustrations.
Entre le carnaval et la prière
Le désert de Black Rock au Nevada, lui, est le théâtre d’événements d’un tout autre genre. C’est là que se tient chaque année le Burning Man, rassemblement festif où se réunissent des milliers de fêtards anarcho-utopistes, moitié créateurs, moitié défoncés, pour faire un joyeux pied de nez aux conventions sociales. Atkins ne cache pas s’être ennuyé pendant les neuf jours qu’il a passés dans ce cadre carnavalesque qui ne correspondait pas à son tempérament.
Enfin, notre auteur itinérant termine son périple en Égypte, dans le désert Arabique où est né le monachisme dont la tradition s’est répandue, au fil des siècles, dans tout l’Occident. Calquant la vie ascétique pratiquée par les pères du désert des IIIe et IVe siècles, des moines y honorent aujourd’hui leur mémoire par la prière et la méditation. Dans ce chapitre, il n’est pratiquement plus question du désert réel, mais d’un désert intérieur marqué par le rejet des vanités et des passions du monde. Cette vie monacale faite de rituels religieux, William Atkins s’y soumet de bonne grâce et nous en fait le récit détaillé. Ainsi, cette quête d’absolu et d’infini dont il parlait au début de son voyage exploratoire se termine-t-elle par une sorte de pèlerinage.
D’inégal intérêt, Dans l’infinité des déserts n’est pas pour autant une lecture superflue. Sur les pistes arides où il nous sert de guide, William Atkins nous apprend mille et un détails sur la morphologie très variable des déserts, sur la végétation et la vie animale qu’ils abritent en dépit de leur apparente stérilité, sur ceux qui les ont arpentés au cours des siècles passés, sur ceux qui en ont fait leur milieu de vie comme aussi sur les populations qui habitent aujourd’hui leurs lisières.
En soulignant l’inexorable avancée de la désertification, il nous rappelle surtout que le désert est la finalité de la Terre, et partant, de tout ce qui y vit : « Ainsi les montagnes deviennent-elles des blocs, les blocs des rochers, les rochers des cailloux, puis vient le gravier, les gravillons, le sable – et enfin la poussière ». Il y a là de quoi méditer !
William Atkins, Dans l’infinité des déserts. Voyages aux quatre coins du monde, de l’anglais par Nathalie Cunnington, Albin Michel, Paris, 2021, 478 p. ; 36,95 $.
EXTRAITS
Percevoir le silence requiert un effort […] C’est plus facile la nuit quand le vent se tait […] Alors, allongé sur mon duvet, je retiens mon souffle et guette le « silence » : un bourdonnement aigu accompagné en sourdine d’un bruit liquide, comme s’il y avait de l’eau qui courait dans un pipeline enfoui plusieurs mètres sous terre.
p. 69
Un jour, un anthropologue demande à un Indien Hopi pourquoi les chants de son peuple parlent si souvent de l’eau […] C’est simple, répond l’Indien. C’est parce que l’eau est si rare… Et pourquoi, demande-t-il alors à l’anthropologue, vos chansons à vous parlent-elles si souvent d’amour ?
p. 382
L’état auquel le paysage […] aspire, son état ultime, c’est précisément cette absence totale de relief, cette pureté spatiale : les montagnes sont des aberrations qui deviennent poussière, et les espaces qui les séparent se retrouvent comblés par cette poussière. Ainsi, un paysage autrefois plat redevient plat. L’eau épure le monde.
p. 392
Impossible de savoir où commence un désert donné et où finit un autre, où le Gobi devient le Gobi noir, où le Gashum Gobi se transforme en désert de Kumtag et en marais salants du Lob Nor où se situe le seuil entre le Lob Nor – ancien lac séché au siècle dernier – et le Taklamakan.
p. 160