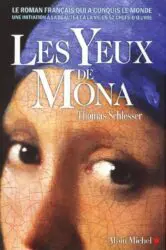L’ouvrage s’annonce comme « le roman qui a conquis le monde ». La justification de cet engouement – s’il est réel – ne paraît pas aller de soi.
Le roman1 conte l’histoire d’une petite fille qui devient soudain aveugle pour une heure, mais le risque qu’elle retombe dans le noir n’est pas exclu (ce qui constitue le nécessaire élément de suspense). Et pendant qu’elle voit, elle semble dotée d’une vue d’une acuité exceptionnelle. Son grand-père Henry veut lui montrer les beautés de la peinture pendant qu’il en est temps. Ainsi, les visites au musée alternent avec celles du neuropsychiatre. Pendant 52 semaines ils vont se rendre au Louvre, puis à Beaubourg, puis au musée d’Orsay.
Enseigner la beauté
L’ambition du livre vise toutefois plus loin et plus large : il s’agit d’une initiation à la beauté et à la vie grâce à 52 chefs-d’œuvre de la peinture occidentale. Louable projet que de répandre et de cultiver dans notre monde la beauté ! Mais on ne soupçonnait pas autant de soif esthétique chez nos contemporains, qui attendraient satisfaction comme les Juifs attendaient la manne céleste dans le désert… Face à cet impressionnant consensus planétaire, le lecteur serait mal avisé d’émettre réserves ou critiques. Et cependant !
Si l’ambition est présente, encore faut-il la mettre en œuvre. Une évidence s’impose dès l’abord. L’ouvrage a demandé à son auteur un travail considérable de documentation et de réflexion. Il semble en ce domaine un expert, si on consulte sa bibliographie, non seulement en histoire de la peinture – depuis Botticelli jusqu’aux concepteurs de notre temps – mais aussi en histoire en général, en philosophie, voire en psychanalyse, et bien sûr dans la pratique de l’écriture, dans des genres divers. Ne cachons pas la réalité : l’ouvrage demande un effort analogue au lecteur pour arriver au terme de ses presque 500 pages.
Littérature et peinture
La conjugaison de la littérature et de la peinture n’est pas chose neuve. Elle a produit depuis au moins le XIXe siècle nombre de romans, nouvelles, essais et poèmes. Parmi les repères les plus célèbres : L’œuvrede Zola, Le portrait ovale d’Edgar Poe, Le portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde, Le dernier été de Klingsor de Hermann Hesse, jusqu’au récent Chardonneret de Donna Tartt. Le livre de Thomas Schlesser s’inscrit dans cette lignée romanesque tout en la transformant complètement et avec d’autres visées. Chez lui pas de personnages en proie aux affres de la création, de tableau doué de propriétés magiques ou d’enjeu d’aventures débridées. Au premier degré, Les yeux de Mona se veut un ouvrage didactique…
Le programme
Pour atteindre cet objectif, Thomas Schlesser a mis au point une forme, ou plutôt une formule qui va se répéter de façon quasi mécanique et avec rigueur au cours de l’ouvrage : récit à épisodes ; description, puis analyse d’un tableau ; répercussion sur les protagonistes. Le point central est évidemment Mona, la petite fille d’une exceptionnelle intelligence et d’une non moins exceptionnelle compréhension des êtres. L’auteur fait preuve d’un métier évident dans la conduite de la narration car il faut animer les apparitions de Mona, qui sont autant de récits en miniature. D’abord lui inventer un milieu, des amies de son âge avec leurs secrets, leurs brouilles, leurs codes et leurs jeux. Et bien sûr une famille. Le père assez falot, pris dans des difficultés financières car son métier de brocanteur est de peu de rapport, et la mère, d’une personnalité plus affirmée avec qui Lola échange de l’affection non dénuée d’orages. Le personnage le plus aimant et influent est le grand-père Henry, homme de grande culture qui se consacre à l’éducation esthétique de Mona. C’est là, semble-t-il, le cœur du roman, mais il en est d’autres, successifs ou simultanés…
L’incertitude plane sur la vue de Mona : l’accès de cécité qu’elle a eu va-t-il se répéter ? Henry a donc décidé de la mettre en contact avec les tableaux parmi les plus célèbres. Certes le livre ne se présente pas comme une histoire traditionnelle de la peinture (l’envers de la jaquette du roman reproduit les tableaux) mais comme une série de rencontres avec les œuvres marquantes, à savoir 52 unités regardées à raison d’une par semaine. Elles sont choisies en fonction de l’usage méthodique et pédagogique que Henry en fait et qui débouche sur la connaissance des principaux artistes, depuis Botticelli jusqu’aux figures contemporaines.
Tâche difficile, et pas seulement pour le grand-père, mais l’auteur est ici chez lui : sa connaissance de la peinture est personnelle, précise et mûrie. Une difficulté se présente immédiatement : comment mettre à la portée de l’enfant les techniques, leur évolution, les choix esthétiques dans le contexte historique et la société où les œuvres furent réalisées ? Le grand-père est un puits de science capable de répondre à toutes les questions de Mona, qui se multiplient. Mais il faut d’abord longuement regarder l’œuvre, s’en imprégner, y entrer. Trouvaille de l’auteur : Mona exprime ses goûts avec justesse et sensibilité, pétulance parfois, alors que Henry explique et commente, même si ses propos semblent bien savants et inadaptés à l’enfant. Quand il rêve sur « l’incommensurable magnitude du monde » ou sur Rembrandt qui « signe une autopsie de lui-même », Mona le rappelle à plus de simplicité, mais deux niveaux sont ainsi introduits dans la connaissance des œuvres. Le choix des tableaux déconcerte souvent, et c’est fort bien car l’attention est attirée sur des œuvres peu connues. Sont évidemment convoqués Léonard, Rembrandt, Vermeer, comme Monet et Picasso, Pollock et Kandinsky. Cependant on s’étonne de ne pas voir au moins cités Caravage ou Dürer. Bosch et Chardin, Munch, Matisse ou Klee. D’autre part, est-il bien nécessaire que Mona soit informée des tendances les plus contemporaines, souvent déroutantes : les araignées de Louise Bourgeois, les insoutenables portraits de Basquiat ou les performances de Marina Abramović ?
Les ambitions du livre ne se limitent pas à nous initier à la peinture et à nous rendre familière la beauté picturale – ce qui est déjà complexe et ardu : le livre présente ce qu’on pourrait appeler un foisonnement thématique qui le fait littéralement éclater.
La jeune Mona est confiée à un neuropsychiatre qui emploie des méthodes nouvelles pour redonner à ses patients leur santé, en particulier l’hypnothérapie, c’est-à-dire l’hypnose, qui conduit Mona dans des profondeurs redoutables, le but étant d’empêcher le retour de la cécité. Nous voilà à sa suite engagés dans les méandres de la vie psychique, ce qui laisse le lecteur perplexe : était-il bien opportun et prudent d’entraîner la fillette dans cette exploration de son inconscient ?
Des ambiguïtés
Le récit semble parfois hésiter entre le prosaïque, le scientifique et le technique, avec des touches poétiques. Ce qui donne des perles comme « [p]iégé par cette dissociation horriblement désagréable, son cerveau fut cadenassé ». Ou « son mutisme grondait comme le tonnerre qui glissait sur la capitale » ou encore « la verticalité de son discours serait contreproductive ». En matière de style, Proust n’est pas le modèle ! Ce qui mène à se demander si parfois l’auteur n’est pas inexplicablement privé de tout regard critique sur ce qu’il écrit. Cependant, les longues, minutieuses et exhaustives descriptions de tableaux sont d’une autre eau : elles constituent des morceaux de bravoure plus convaincants.
Aux dernières pages du pesant volume, le lecteur est mis en présence de curieuses scènes où s’opère la transformation finale de Mona : elle parvient à un degré suprahumain, presque à une transfiguration, grâce à une sorte de rite magique assez confus où il est question d’un talisman qu’elle portait, fait d’un collier de très petits coquillages. S’ajoutent des considérations sur l’euthanasie autour d’un personnage presque mythique de grand-mère. Et surtout sont jetées des phrases visant à constituer une véritable sagesse. Le propos devient alors fâcheusement proche de préceptes de la psycho-pop, tels que « Grandir c’est perdre », « Va vers ton risque » ou encore « Garde sans cesse la lumière ». Les recommandations ne sont pas de première fraîcheur, mais libre au lecteur de prendre ses distances !
L’œuvre totale ?
On l’aura compris : l’œuvre déborde de partout et elle est visiblement mal maîtrisée. L’auteur a-t-il voulu réaliser une sorte de livre-somme, aux entrées multiples ? Il apparaît en fait dépassé par ses ambitions.
Heureusement il a créé le personnage attachant de la petite Mona. Face aux doctes propos du grand-père Henry (et du romancier !), elle est la spontanéité, parfois la drôlerie. Peu soucieuse de philosopher, elle dessine cependant une attitude devant la vie et, d’abord puisqu’elle est partie de là, en présence de l’œuvre d’art : elle sait spontanément que sa fréquentation demande beaucoup de temps, de patience, de silence. Au milieu de tout le fatras d’ambitions et d’intentions accumulé dans ce roman, Mona représente le naturel. Elle nous prend par la main et nous engage à la suivre.
1. Thomas Schlesser, Les yeux de Mona, Albin Michel, Paris, 2024, 485 p.
EXTRAITS
La grande pyramide de verre amusait Mona. Hissée insolemment au milieu des pavillons de pierre du palais du Louvre, sa forme éthérée, sa transparence, sa manière de capter le soleil froid de novembre l’enchantaient. Son grand-père ne parlait pas beaucoup. Elle voyait pourtant bien qu’il était d’excellente humeur car il serrait sa petite main dans la sienne avec la tendresse assurée qu’ont les gens heureux et balançait les bras avec souplesse. Sa jovialité, quoique muette, rayonnait d’une manière enfantine.
p. 29
Léonard disait de la peinture qu’elle suscitait un sentiment en miroir : l’image d’un homme qui bâille fait bâiller ; l’image d’un homme agressif rend agressif. Et l’image d’une femme qui sourit, qui sourit de ce sourire désarmant, est une invitation à sourire de même. C’est cela que sa peinture cherche à procurer : s’ouvrir à la vie, sourire à la vie, même au-devant ce qu’on discerne peu et mal, de ce qui est encore obscur et informe, d’un monde désert et confus, et c’est là le meilleur moyen d’y instiller un ordre heureux.
p. 44
Reprenant ses esprits, elle regarda droit devant elle. Comme c’était beau. Comme c’était beau le petit désert ambre sur lequel s’écrasait l’écume à l’infini… Comme c’était beau l’onde turquoise qui gonflait sous le vol des mouettes blanches… Comme c’était beau l’horizon clair là-bas, le merveilleux horizon clair…
Henry s’approcha. En pivotant elle lui fit l’impression de La jeune fille à la perle de Vermeer dont le corps semble soudain s’arracher à l’obscurité qui partout le cerne. Il percevait en Mona l’écho du long voyage dont elle était revenue. Il tendit vers sa jolie tête ronde ses bras immenses comme l’univers. Elle lui sourit, un peu sonnée, et l’étreignit.
— Oh, Dadé… Comme c’est beau, tout ça. Et comme c’est beau, tout au-delà.
p. 478