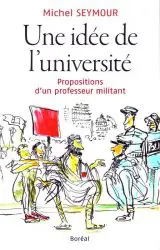Une coche mal taillée. Difficile de masquer le résultat de ce printemps érable qui aura fait couler beaucoup d’encre dans les médias, engorgé beaucoup de lignes ouvertes, fait résonner les casseroles dans les rues, rassemblé et divisé tant de gens autour d’une question pourtant simple qui n’a cessé de se complexifier au fur et à mesure que le conflit opposant les étudiants et le gouvernement se transformait en véritable crise sociale : doit-on ou non hausser les droits de scolarité pour la poursuite d’études universitaires ?
Les prises de position se sont multipliées et figées au rythme des manifestations, certaines joyeuses et réfléchies, d’autres se contentant d’être bruyantes, assourdissantes d’arguments et de chiffres qu’on se lançait des deux côtés de la barricade. Jusqu’à ce que la situation s’envenime et se judiciarise. Et dérape. On appela en vain à une trêve, pression sociale oblige. Mais de trêve il n’y eut point. Démocratie oblige, nous avons plutôt eu droit à une impasse électorale avec déplacement du problème autour de tables sectorielles avant de le hisser à un nouveau sommet… d’incompréhension de part et d’autre. Il y a eu des gains et des pertes des deux côtés. Il y a eu essoufflement de la mobilisation étudiante, repli stratégique du gouvernement et des institutions universitaires et collégiales, mais qu’en est-il de la question de fond qui a jailli au cœur de la crise : quelle valeur accorde-t-on à l’enseignement supérieur au Québec ? Quel rôle veut-on confier aux universités ? La question demeure, sinon entière, irrésolue.
C’est au cœur de ce tumulte que Michel Seymour, professeur de philosophie à l’Université de Montréal, a récemment fait paraître Une idée de l’université1 avec, en sous-titre, l’énoncé d’une prise de position : propositions d’un professeur militant. L’ouvrage se veut résolument engagé, voire partisan et pamphlétaire à certains moments. Dans le prologue, Michel Seymour énonce avoir voulu apporter un point de vue philosophique à la crise du printemps érable tout en prenant position en faveur de la gratuité scolaire et de la lutte menée par les étudiants pour y parvenir. Au nombre des raisons qui, à ses yeux, ont favorisé une forte mobilisation du mouvement étudiant, il cite : la forte hausse des droits de scolarité initialement envisagée sur cinq ans, la dérive fiscale et bancaire qui a entraîné une perte de légitimité des institutions publiques, la dérive clientéliste des universités et la marchandisation de l’enseignement supérieur, le traitement salarial consenti aux dirigeants d’université dans une période d’austérité budgétaire afin de l’aligner sur celui des grandes entreprises. La table était mise pour favoriser une éruption de colère.
Le point de vue de Michel Seymour s’appuie sur la démarche du philosophe politique américain John Rawls, avant tout connu pour ses travaux sur la justice sociale. Seymour s’attarde donc, dans un premier temps, à expliciter les fondements et la démarche de Rawls, en insistant sur les caractéristiques qui ont une incidence sur les propositions qu’il défendra par la suite dans le cadre du conflit opposant, d’un côté, les étudiants et, de l’autre, le gouvernement et les dirigeants d’université. Parmi ces caractéristiques, celles qui sont de nature à favoriser l’égalité des chances pour tous retiennent tout particulièrement son attention et seront à maintes reprises explicitées et rappelées dans le cadre de cet essai. Seymour souligne que pour Rawls, « le milieu de l’éducation n’est pas accessoirement lié au principe de l’égalité des chances. Il en forme la substance ». Pour Rawls, le système d’éducation doit incarner le principe d’égalité des chances et ce principe devrait favoriser la plus grande accessibilité aux études supérieures, accessibilité qui repose notamment sur la gratuité scolaire. La démonstration a le mérite d’être claire et s’inscrit dans la poursuite des objectifs du rapport Parent. Doit-on ici rappeler qu’au début des années 1960, à peine trois pour cent des jeunes Canadiens français, comme on disait alors, fréquentaient l’une des trois universités francophones (Laval, de Montréal et de Sherbrooke) ?
Quant au rôle que l’on souhaite voir jouer par les universités, Seymour souligne que deux visions diamétralement opposées, qui ont chacune des répercussions idéologiques et financières différentes, se dessinent et s’opposent. « D’un côté, on peut concevoir l’université comme une institution au service du bien commun en ce qu’elle incarne l’égalité des chances, transmet la culture, est au service de la collectivité par le développement d’expertises diverses et joue un rôle crucial dans le développement de l’économie nationale. De l’autre côté, on peut la concevoir comme une entreprise qui offre un produit à une ‘clientèle étudiante’, produit qui est fourni par des ‘employés’ professeurs, ce qui nous force à entrer dans la logique de l’utilisateur-payeur ou, encore pire, dans la logique de l’étudiant-entrepreneur. » Vision certes dichotomique, mais qui a le mérite de cerner un malaise qu’on s’est jusqu’ici efforcé d’ignorer.
Cette dernière question a fortement teinté les débats qui ont eu cours, et qui continuent d’avoir cours au regard des frais de scolarité. Dès lors que l’on conçoit l’université comme une institution éducative devant desservir le bien commun et incarner le principe d’égalité des chances ou, au contraire, comme une entreprise clé de l’économie du savoir qui voit dans l’éducation un produit dans lequel l’étudiant investit pour s’assurer d’un meilleur avenir, la question des droits de scolarité n’est ni abordée ni traitée de la même manière. Et il faut bien avouer que ce débat n’a pas vraiment eu lieu, à tout le moins il n’a pas été sereinement mené, encore moins conclu. Michel Seymour souligne que le glissement de la gestion universitaire vers un mode davantage entrepreneurial n’est pas le propre des universités québécoises, que ces dernières sont plutôt à la remorque du phénomène mondial et de l’importance accrue de l’université dans ce qu’il est convenu d’appeler l’économie du savoir, ce qui expliquerait et justifierait la hausse souhaitée des frais de scolarité pour demeurer concurrentiel dans un marché qui fait aujourd’hui fi des frontières. Michel Seymour plaide quant à lui pour un retour aux orientations inscrites dans le rapport Parent, pour leur poursuite et leur parachèvement. Au nombre des grandes orientations inscrites dans le rapport, l’éducation ne devait plus être considérée comme un luxe, mais comme un droit, et ses auteurs voulaient que tous aient les mêmes chances d’y accéder. Dans cette optique, le gouvernement allait mettre l’accent sur la gratuité scolaire et le déploiement du réseau collégial.
Le financement des universités n’en demeure pas moins une question dont il faut se préoccuper. Michel Seymour souligne à juste titre certains besoins criants : le ratio étudiants-professeurs qui n’a cessé de croître, le financement intégré des études supérieures, les coûts indirects de la recherche, la rénovation des bâtiments, les espaces manquants. Ici Seymour délaisse la position de l’essayiste pour adopter celle du polémiste. Les étudiants ne doivent pas être les seuls à faire les frais du désengagement du gouvernement fédéral, qui a réduit progressivement ses transferts aux provinces en éducation postsecondaire au milieu des années 1990. Seymour dépeint ce qui a toutes les apparences d’un complot fédéral pour, d’une part, empiéter sur un champ de compétences provinciales et, d’autre part, promouvoir l’idéal fédéral canadien à la suite du second échec référendaire par le moyen de généreux programmes de soutien à la recherche et de bourses du millénaire. Seymour démontre que les coupes dans les transferts de fonds destinés aux établissements d’enseignement (non apparents, donc non profitables sur le plan de la visibilité politique), d’abord décriées par les recteurs, ont par la suite servi à alimenter généreusement les programmes de subventions destinés aux chercheurs qui reconnaissent ainsi mieux la main qui les nourrit. Seymour va même jusqu’à accuser les recteurs d’avoir avalisé muettement cette façon de faire.
Les attaques sont ici frontales, du moins dans le cas de l’Université de Montréal. Contrairement aux chapitres qui précèdent où l’on s’attarde davantage à tracer une voie qui favoriserait le plein épanouissement des universités dans un projet de société où la recherche du bien commun l’emporte sur celui immédiat de la seule réussite individuelle d’étudiants qui détiennent un diplôme dont la valeur se monnaye à l’échelle mondiale, les chapitres consacrés plus spécifiquement au financement des universités et à leur gestion épousent davantage le ton de la salve en riposte, on peut le comprendre, à la judiciarisation du conflit. Mais tout ici ne peut être aussi monochrome que tend à le dépeindre Michel Seymour. Ce sont là, il faut croire, les limites qui s’imposent au militant et qui lui font perdre la position stratégique du philosophe qui cherche à réfléchir aux façons de comprendre et de dénouer une crise majeure.
La poussière n’est pas totalement retombée, mais lorsqu’elle le sera, la coche apparente demeurera mal taillée et ne demandera qu’à s’ouvrir à nouveau lorsque les conditions d’un nouveau printemps érable seront réunies. À moins que l’on ne prenne véritablement acte des leçons à tirer et que l’on ne s’affaire, cette fois, à entailler pour produire autre chose qu’une crise sociale.
1. Michel Seymour, Une idée de l’université, Propositions d’un professeur militant, Boréal, Montréal, 2013, 204 p. ; 24,95 $.
EXTRAITS
En plus de l’éducation et de la culture, Rawls incorpore l’idée d’un droit égal d’accès à l’emploi dans la juste égalité des chances. Or, certains emplois requièrent des études universitaires. Et puisqu’un nombre croissant d’emplois –en fait, la majorité des emplois – impose désormais un passage par des études universitaires, l’université doit faire partie intégrante de l’institutionnalisation du principe d’égalité des chances.
p. 51
[L]’université peut jouer un rôle économique important. Elle est de plus en plus un rouage essentiel dans ce qu’il est convenu d’appeler l’« économie du savoir ». L’erreur est de la réduire à n’être rien d’autre que cela. C’est aussi et surtout une erreur d’oublier que l’infrastructure économique dont il est question doit d’abord et avant tout être celle de la société dans laquelle on se trouve. L’université doit jouer un rôle économique dans la structure de base de la communauté nationale à laquelle on appartient.
p. 53-54
À n’importe quelle autre époque de notre histoire, un premier ministre aux prises avec une contestation populaire de grande envergure comme celle que nous avons connue, rassemblant des carrés rouges et des « casseroleurs » aux quatre coins de la province, aurait admis l’existence d’un malaise profond et aurait accepté de lâcher du lest, voire de mettre de l’eau dans son vin. Au lieu de cela, trahissant une mentalité de fin de régime, le premier ministre s’est réfugié dans le déni de la réalité et s’est employé à décrire les centaines de milliers de manifestants en disant que c’était « la rue ». Quant aux centaines de milliers de carrés rouges, ils symbolisaient « la violence et l’intimidation ». On ne saurait mieux dire !
p. 185