Ils étaient unis dans l’intime et dans la représentation. Ils nous ont fait voir autrement les commencements de l’Amérique. Ils nous ont donné à réfléchir sur notre rapport aux êtres et aux choses.
Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque nous avaient habitués à une présence dont on mesure encore mieux la valeur aujourd’hui, par l’effet de manque. Marie-Christine Lévesque est décédée en 2020 et son amoureux nous a quittés à son tour moins d’un an plus tard, en mai 2021. Heureusement pour nous, La prière de l’épinette noire1 et De remarquables oubliés, T. 3, Ils étaient l’Amérique2, publiés à titre posthume, s’ajoutent à un corpus incomparable.
Homme de parole et femme d’images
Pendant plus de vingt ans, Marie-Christine Lévesque et Serge Bouchard ont vécu et travaillé en couple. Au cours de ces années, si Serge Bouchard a aussi publié en solo, ses textes devaient en quelque sorte obtenir l’imprimatur de sa compagne. Leur étroite collaboration remonte au tout début de leur relation, en 1997, alors qu’ils contribuaient de part et d’autre à leurs productions respectives, elle dans le domaine publicitaire et lui entre autres comme collaborateur au journal Le Devoir.
Dans l’avant-propos d’Elles ont fait l’Amérique3, leur première œuvre signée en tandem, Marie-Christine Lévesque avait déjà éventé le secret de leur mode de collaboration : « Serge écrit à la hache, laissant de gros copeaux traîner dans des textes qu’il oublie aussitôt brouillonnés. Il écrit comme un ours, renversant tout et ne ramassant rien. Moi, je suis un peu son contraire, nous sommes un couple dépareillé. Je suis littéraire, minimaliste ».
Les deux auteurs prenaient plaisir à déclarer à la ronde le bonheur de leur connivence dans le travail. Lui, l’auteur établi et célébré, n’hésitait pas à dire sa chance de voir ses textes soumis à l’œil affûté de sa compagne. Elle ne se gênait pas pour élaguer les textes de son compagnon lorsqu’elle le jugeait bon. Ces réflexes ont fait en sorte que des ouvrages, commandés au départ à l’illustre anthropologue, ont pris leur envol et sont devenus des œuvres collectives sous la houlette de la partie minutieuse du couple. C’est le cas de l’ouvrage Le peuple rieur4, une proposition des Innus d’Essipit. À la lecture d’une première version, Marie-Christine Lévesque aurait convaincu son partenaire de tout reprendre dans un style plus personnel et plus engagé. C’est aussi le cas pour Les images que nous sommes5, une commande du projet Éléphant sur le cinéma québécois. Serge Bouchard visionnait des films, prenait beaucoup de notes, mais le projet faisait du surplace. Et ce n’était pas là une dérive passagère du personnage, mais bien la fidélité à une manière d’être, telle qu’affirmée notamment dans Le moineau domestique6, sa première œuvre littéraire publiée : « Je m’arrange pour ne jamais m’organiser afin d’échapper à l’empire de l’agenda, régime sous lequel je suis mort trop de fois ». Le livre allait prendre forme à partir du moment où l’ex-directrice artistique entreprendrait de structurer le contenu et de planifier les travaux.
L’épinette noire au bout de la route
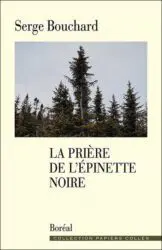 C’est entendu, Serge Bouchard n’était pas l’homme des longs développements discursifs. Il excellait dans l’art du texte bref et sans détour, qui va droit au but et droit au cœur. La plupart de ses livres sont des compilations de courts essais, parfois publiés antérieurement et souvent écrits pour être lus à la radio. Chacun de ces ouvrages éblouit par les multiples facettes d’un questionnement où s’amalgament la naïveté, la douce ironie et la profondeur philosophique. Le dernier en date, La prière de l’épinette noire, complète la publication de la majorité des éditoriaux lus en ondes par l’auteur, dans le cadre de l’émission C’est fou…7, coanimée de 2010 à 2021 avec Jean-Philippe Pleau, sur ICI Radio-Canada Première.
C’est entendu, Serge Bouchard n’était pas l’homme des longs développements discursifs. Il excellait dans l’art du texte bref et sans détour, qui va droit au but et droit au cœur. La plupart de ses livres sont des compilations de courts essais, parfois publiés antérieurement et souvent écrits pour être lus à la radio. Chacun de ces ouvrages éblouit par les multiples facettes d’un questionnement où s’amalgament la naïveté, la douce ironie et la profondeur philosophique. Le dernier en date, La prière de l’épinette noire, complète la publication de la majorité des éditoriaux lus en ondes par l’auteur, dans le cadre de l’émission C’est fou…7, coanimée de 2010 à 2021 avec Jean-Philippe Pleau, sur ICI Radio-Canada Première.
Dans ce dernier opus, comme à son habitude, l’anthropologue tire dans toutes les directions. Cette fois, il se met lui-même en scène un peu plus qu’à l’accoutumée, verse un peu dans la nostalgie, toujours de façon aussi pertinente que séduisante. Qu’on ne dise pas à Serge Bouchard qu’il est encore jeune ; il se sent vieux et l’assume. Il réclame néanmoins indulgence et respect pour la vieillesse. Dans un texte intitulé « Le boutte du boutte », il raconte comment, lors d’une conférence où il prenait soin de faire l’histoire du lexique désignant ceux qui nous ont précédés sur le territoire américain, un étudiant l’avait sommé de cesser de prononcer le mot indien. Il en profite pour faire le lien avec les mots vieux et nègre, eux aussi frappés d’anathème, et pour dénoncer vertement cette tendance à vouloir gommer les problèmes en cachant ces mots qu’on ne saurait voir.
Le sens de la vie est une préoccupation omniprésente dans les propos de l’homme de radio. « Nous écrivons la pièce de nos vies », dit-il. Et s’il en est ainsi, mieux vaut se donner le beau rôle et s’entourer de beaux personnages. Notre seule présence aux autres nous oblige à la représentation. Celui qui l’affirme en sait quelque chose, lui qui prenait grand soin de son profil d’ours bourru et de « mammouth laineux ». Aussi, il commet de vénielles provocations, par exemple en révélant avec un malin plaisir son goût pour le Coke ou le pâté chinois. Et il étonne encore son lecteur lorsque, assis sur une roche au bord du Grand lac des Esclaves, pris de vertige devant la magnificente vastitude, il fume une cigarette, « une vraie bonne ». Façon, peut-être, de se prémunir contre l’auréole de sainteté dont certains aimeraient le coiffer.
Si les textes du recueil comportent leur part d’humour et d’hommage à la beauté, le ton de l’ensemble est plutôt grave ; il s’en dégage au bout du compte un appel à s’élever contre toutes les laideurs, les turpitudes et les fausses routes. Parmi celles-ci, le saccage éhonté de la nature, car « détruire la nature revient à nous détruire nous-mêmes ». On ne peut qu’être d’accord avec Jean-Philippe Pleau lorsque celui-ci, dans sa préface, affirme que son collègue, en parlant aux épinettes, « mais aussi parfois aux animaux, aux camions et aux lacs », adresse en réalité sa prière aux humains.
Le contrepied de la tradition historienne
Une autre boucle se referme avec Ils étaient l’Amérique, dernier-né de la trilogie De remarquables oubliés8. Les livres, progéniture de la série radiophonique du même titre, assurent une pérennité méritée au riche contenu de ces émissions. Tant la version parlée que la version écrite nous ouvrent les yeux sur des figures historiques trop longtemps restées dans l’ombre. Bien plus, le nouvel éclairage apporté par Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque sur l’histoire des premiers temps de l’Amérique conteste avec aplomb, et même ici et là avec une touche poétique, une version trop longtemps dominante de cette histoire.
Ce qu’on a appelé la découverte de l’Amérique était en réalité un acte d’appropriation illégitime. Cette idée fait lentement son chemin depuis un certain temps. Mais on peine toujours à imaginer comment il aurait pu en être autrement, tant ont la vie dure les préjugés sur la supériorité de la civilisation européenne par rapport à des peuples primitifs. Ils étaient l’Amérique contribue à redresser les torts sur ce plan, en agissant sur deux fronts. D’une part, la cote des grands découvreurs européens et de leurs commanditaires est sérieusement revue à la baisse. D’autre part, les sociétés établies en sol américain avant le contact sont revalorisées, entre autres par la mise au jour du génie, de l’éloquence et de la droiture de leurs porte-parole. Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque s’emploient à ce recadrage en rappelant des faits généralement ignorés et, surtout, en inversant la logique de fabulation dont souffre l’histoire officielle.
L’approche des deux auteurs est davantage littéraire qu’historique. Leur propos n’est pas encombré d’un appareil de références, bien que les sources citées s’accumulent tout au long de la trilogie. Entre autres, il est dit au premier tome que Bouchard a compulsé en long et en large les milliers de pages du Handbook of American Indians, sans qu’il soit nécessaire de le répéter aux tomes suivants. De plus, les écrits cités avec parcimonie sont aussi bien le fait de littéraires que celui d’anthropologues, d’historiens ou de missionnaires. Ainsi, les auteurs font appel à quelques faits bien établis, mais l’aspect le plus intéressant de leur démarche est de montrer que le récit convenu de notre relation avec les Autochtones est en partie une construction, ouvrant ainsi la porte à une tout autre interprétation.
Des voyageurs au long cours et à courte vue
 Tout en préparant le terrain pour les éloges à de remarquables représentants des nations amérindiennes, Bouchard et Lévesque reviennent sur les bévues et les aveuglements de ces voyageurs qu’on a appelés les découvreurs de l’Amérique. Parmi eux, Christophe Colomb en prend pour son rhume : « On dit qu’il est mauvais marin, mauvais compagnon, méchant, mesquin, fourbe, fabulateur, peut-être même fou ». Notoirement coupable de nombreuses traîtrises et exactions, Colomb sera venu quatre fois en Amérique sans savoir où il se trouvait. Dans sa grandiloquente étourderie, il ira jusqu’à nommer Indiens les habitants autochtones de l’Amérique.
Tout en préparant le terrain pour les éloges à de remarquables représentants des nations amérindiennes, Bouchard et Lévesque reviennent sur les bévues et les aveuglements de ces voyageurs qu’on a appelés les découvreurs de l’Amérique. Parmi eux, Christophe Colomb en prend pour son rhume : « On dit qu’il est mauvais marin, mauvais compagnon, méchant, mesquin, fourbe, fabulateur, peut-être même fou ». Notoirement coupable de nombreuses traîtrises et exactions, Colomb sera venu quatre fois en Amérique sans savoir où il se trouvait. Dans sa grandiloquente étourderie, il ira jusqu’à nommer Indiens les habitants autochtones de l’Amérique.
Une section du livre particulièrement passionnante et révélatrice est celle où sont évoqués les voyages de Jacques Cartier. On peut y voir un franc démenti des inepties historiques dues à la plume du chanoine Lionel Groulx, lequel a pris à la lettre les écrits de Cartier et en a rajouté pour faire de Cartier un héros, face à des Indiens louvoyants. Contrairement à ce qui a généralement été implanté dans les esprits, les Amérindiens des premiers contacts ne sont pas des naïfs à qui on fait croire n’importe quoi. À la baie de Gaspé, en 1534, lorsque Cartier érige une croix, devant laquelle il déclare prendre possession du territoire au nom du roi de France, les Iroquoiens de Stadaconé ne sont pas dupes. L’un d’entre eux, Donnacona, élève même la voix pour dénoncer l’outrecuidance du navigateur. En repartant pour la France, Cartier s’autorise le rapt de deux jeunes autochtones, un enlèvement qui ne sera pas dénoncé dans notre histoire du Canada. L’année suivante, Cartier revient avec les deux jeunes hommes, Domagaya et Taignoagny, et se rend jusqu’à Stadaconé. Il rencontre à nouveau Donnacona, qu’il considère comme le chef des Iroquoiens, alors qu’on ne sait rien du rang et de la fonction du personnage parmi son peuple. Cartier dit à Donnacona que les jeunes Indiens ont été bien traités et qu’ils ont admiré tout ce qu’ils ont vu en France. Domagaya et Taignoagny traduisent les propos de Cartier pour Donnacona, mais personne ne sait en réalité s’ils ne mettent pas en garde leurs semblables contre les manigances des Français. Après un hiver où Cartier perd le quart de son équipage avant d’être secouru par le remède offert par les Stadaconéens, le capitaine enlève Donnacona lui-même et le ramène en France, où il mourra trois ou quatre ans plus tard. Une fois de plus, l’enlèvement est généralement vu comme un fait anodin.
Une richesse invisible pour qui ne voulait pas la voir
Il était dans l’intérêt des conquérants d’infléchir les faits en leur faveur. Il est grand temps maintenant de revoir ce discours en inversant le point de vue, ce à quoi s’emploient avec bonheur les auteurs d’Ils étaient l’Amérique.
Parmi les moments mettant en scène la noblesse de sentiment des Amérindiens confrontée à la convoitise des Européens, l’un renvoie à 1603, quelques années avant la fondation de Québec. Le grand éclaireur innu Anadabijou, l’un des principaux instigateurs de la première alliance de plusieurs nations avec les Français, croit en la possibilité d’une relation égalitaire : « Anadabijou aurait dit aux Français : nous, les humains d’ici, et vous, les humains de là-bas, nous allons nous mêler, nous embrasser, et faire un nouveau monde ». Les Autochtones découvriront toutefois que les Européens ne considèrent aucunement cette offre de partage. Ils se battent entre eux pour le contrôle du territoire, tenant les habitants du lieu pour des instruments.
Ils étaient l’Amérique nous convie aussi à la rencontre de Membertou, éminent chef et shaman d’un groupe de Micmacs d’Acadie, de Tessouat, dit le Borgne de l’Île, chef algonquin de la vallée d’une rivière appelée aujourd’hui rivière des Outaouais, du Huron-Ouendat Ochastéguin, venu de la baie Georgienne à la rencontre de Champlain en 1611, du diplomate et guerrier iroquois onontagué Otreouti, et de Kondiaronk, tribun iroquoien de la nation des Tionontatés. Le livre, inachevé en raison du décès impromptu de ses auteurs, se termine avec la guerre d’indépendance de Pontiac. Cette révolte de grande ampleur, que d’aucuns veulent toujours voir comme un incident à peine digne de mention, faillit faire échec à l’armée britannique lors de la Conquête.
Enfin, une donnée à laquelle il est généralement accordé trop peu d’importance et qui ressort de ce livre : l’image favorable des peuples autochtones consignée, de manière consciente ou non, dans les comptes rendus des missionnaires. En effet, plusieurs de ces prêtres étaient des érudits au sens de l’observation développé et certains d’entre eux ont livré des descriptions objectives, et même admiratives, des cultures autochtones. Ces témoignages, notamment les Relations des jésuites, étaient lus en Europe par des penseurs éclairés qui en tiraient des conclusions critiques à l’endroit de leurs sociétés inégalitaires. Malgré cela, on a continué de tromper et de déposséder les premiers habitants du Nouveau Monde.
1. Serge Bouchard, La prière de l’épinette noire, Boréal, Montréal, 2022.
2. Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque, De remarquables oubliés, T. 3, Ils étaient l’Amérique,Lux, Montréal, 2022.
3. Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque, De remarquables oubliés, T. 1, Elles ont fait l’Amérique, Lux, Montréal, 2011.
4. Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque, Le peuple rieur. Hommage à mes amis innus, Lux, Montréal, 2017.
5. Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque, Les images que nous sommes. 60 ans de cinéma québécois, L’Homme, Montréal, 2013.
6. Serge Bouchard, Le moineau domestique. Histoire de vivre, Boréal, Montréal, 2021 [Boréal, 2000 ; Guérin, 1991].
7. Deux recueils des textes lus par Serge Bouchard dans le cadre de l’émission C’est fou… ont été précédemment publiés chez Boréal : L’Allume-cigarette de la Chrysler noire, en 2019, et Un café avec Marie, en 2021.
8. À la suite d’Elles ont fait l’Amérique, paraissait De remarquables oubliés, T. 2, Ils ont couru l’Amérique, de Serge Bouchard et Marie-Christine Lévesque, Lux, Montréal, 2014.
EXTRAITS
Aujourd’hui, assis à longueur de journée dans mon fauteuil, immobile, regardant par la fenêtre, fixant la rue devant chez moi, je passe des heures enfermé en moi-même. On pourrait croire que je prie ou que je médite. On pourrait croire même que je pense. Mais non, j’ai simplement dans la tête une balle bleu-blanc-rouge en caoutchouc.
La prière de l’épinette noire, p. 17.
Après un long détour, le temps d’une vie encombrée, pleine d’images, pleine de peines, de souvenirs empilés jusqu’à ras bord dans le grenier de ma mémoire, pour avoir trop aimé, trop voulu, trop perdu, voilà que je me retrouve seul, comme dans une cellule monastique.
La prière de l’épinette noire, p. 42.
L’épinette noire, gloire de la préhistoire, est une antenne qui nous relie à l’éternité. Elle nous insuffle une sagesse morose, une mélancolie du long cours. C’est l’arbre sur lequel je m’appuie, là où je repose mon esprit, mon dos brisé, mes jambes mortes. L’arbre sous lequel je bois ma tasse de thé, résolu, fatigué, heureux devant le petit feu qui sent si bon.
La prière de l’épinette noire, p. 215.
Dans l’esprit de Cartier, ces Autochtones méritent-ils qu’on leur prête la moindre attention ? Tout au plus saura-t-on que l’un des Indiens, vêtu d’une vieille peau d’ours noir, se lance dans une harangue selon les usages de son peuple. L’homme s’élève contre l’érection de cette croix. Il parle haut et fort, signalant aux Français que lui-même et tous ceux présents ont compris la signification du petit laïus du capitaine au pied du monument. Cartier a la croix sinistre, écrira un jour Jacques Ferron.
Ils étaient l’Amérique, p. 73-74.
Donnacona est un personnage tragique, dans le sens classique du terme. […] On l’a enlevé à sa femme, à ses enfants, à son clan, à sa parenté, à son village, pour le mener dans une France agitée, bondée de pauvres et de mendiants, au milieu de violences religieuses, au cœur d’une ville malpropre, insalubre, un Paris au ciel cotonneux, aux horizons bouchés, qui a dû, jour après jour, assombrir Donnacona, prisonnier d’un destin impitoyable.
Ils étaient l’Amérique, p. 104.
Lorsque Kondiaronk parle, tous se taisent et assistent au spectacle de son verbe. Il s’exprime si bien qu’on provoque des joutes verbales entre lui et les autres chefs pour le simple plaisir d’être ébloui par ses réparties. Il détient le secret des mots qui dévoilent le sens caché des choses, il sait exprimer la beauté de l’arbre et la douceur du chant de l’oiseau, il parle le langage des esprits et des cœurs. Il sait conjurer la peur.
Ils étaient l’Amérique, p. 201.











