Les éditions du Boréal viennent de publier en enfilade trois ouvrages qui jettent une lumière des plus fascinantes sur un personnage marquant des années de l’entre-deux-guerres au Québec, époque d’autant plus obscure dans nos mémoires qu’elle est même antérieure à la fameuse « grande noirceur » de Duplessis.
 L’affirmation selon laquelle un des plus grands scientifiques du Québec d’il y a cent ans fut un frère des écoles chrétiennes risque aujourd’hui de se heurter à un mur de scepticisme. Il n’empêche que la Flore laurentienne (1935), la grande œuvre de Marie-Victorin (1885-1944), est reconnue comme un modèle en la matière. La lecture des écrits et discours du même frère1 ne peut que renforcer ce constat.
L’affirmation selon laquelle un des plus grands scientifiques du Québec d’il y a cent ans fut un frère des écoles chrétiennes risque aujourd’hui de se heurter à un mur de scepticisme. Il n’empêche que la Flore laurentienne (1935), la grande œuvre de Marie-Victorin (1885-1944), est reconnue comme un modèle en la matière. La lecture des écrits et discours du même frère1 ne peut que renforcer ce constat.
Ils n’ont pas tort, toutefois, les anciens d’aujourd’hui, de dénoncer l’état de fermeture de la société canadienne du premier XXe siècle. Marie-Victorin le reconnaît lui-même, tout en sonnant le glas de cette époque de repli : « […] en raison de certaines conditions historiques de la formation du peuple canadien-français, notre clergé, après la conquête, a sauvé notre groupe, aux points de vue langue et foi, en l’isolant suffisamment de l’ambiance brutale qui l’aurait anéanti. […] Mais les temps ont changé, et le même instrument, l’isolement, qui avait sauvé la race, peut la perdre aujourd’hui. […] Dans le domaine culturel, l’isolement, c’est l’auto-intoxication, c’est la mort prochaine dans le gâtisme de l’esprit ». La suite de ce discours de 1937 montre que le frère voit loin : « Que les éléments ultraconservateurs du clergé, et les laïques qui gravitent autour d’eux – et qui sont souvent, comme on dit, plus catholiques que le Pape ! – abandonnent l’idée de dresser un mur de Chine autour de la province de Québec […] ».
La science, un domaine que les Canadiens français doivent s’approprier
En 1839, Lord Durham avait traité les Canadiens de peuple « sans histoire et sans littérature ». C’est en réponse à ce coup de fouet – pas complètement faux – que certaines œuvres littéraires et historiques canadiennes-françaises ont vu le jour dans les décennies qui ont suivi, la plus notable à cet égard étant sans doute l’Histoire du Canada de François-Xavier Garneau. Au tournant du XXesiècle, les mouvements pour mieux asseoir et étendre l’activité du Canada français au-delà des seuls domaines de la terre et de la religion se multiplieront, comme en témoignent notamment la fondation de l’École des hautes études commerciales en 1907, ou celle du Devoir en 1910 (on peut encore mentionner l’École polytechnique de Montréal, qui prendra un certain essor durant cette période après des débuts embryonnaires en 1873). C’est dans la foulée de ce mouvement que Marie-Victorin, dès les années 1910, déplore l’absence des Canadiens français dans le monde de la science (lui-même est autodidacte). À cette époque, la géologie et la botanique de diverses régions du Québec sont certes connues et étudiées, mais par des Américains, ce qui dépasse l’entendement du frère : « Cette terre d’antique noblesse cosmique – la Laurentie, l’un des socles du monde ! – n’[est] pas à nous puisque des étrangers surtout [détiennent] ses plus intimes secrets biologiques et géologiques. N’appartenons-nous pas à qui possède nos secrets ? » C’est pourquoi il militera notamment pour la fondation d’un institut de géologie, lequel verra le jour à l’Université Laval en 1938.
C’est d’ailleurs la méconnaissance des sols et des sciences agricoles qui explique de nombreux fiascos de colonisation de l’époque, notamment en Abitibi et, un peu avant, au pays du curé Labelle. Dans un long et impressionnant discours de 1938, Marie-Victorin explique que notre tradition agricole repose sur des prémisses – et des prémices – nées sous les tropiques eurasiennes qu’il y aurait lieu de revisiter en Laurentie. « Si le monde tempéré tout entier cultive le blé, c’est tout simplement parce que les Néolithiques qui inventèrent l’agriculture s’emparèrent d’une graminée calcicole de leur milieu particulier, le Triticum dicoccum […]. » Or, « une vaste portion de notre domaine national repose sur le socle laurentidien, sur la roche archéenne, et sur les sols acides qui en dérivent. Ces sols acides, sablonneux ou tourbeux, rocheux ou humides, sont hostiles aux plantes-vedettes de l’agriculture traditionnelle ». Il faut donc se « débarrasser » du « mythe du blé » pour trouver comment tirer profit de nos propres terres. Comment y parvenir sans la recherche ? Ou alors, on pourrait se tourner vers l’industrie forestière, ou encore minière. Mais encore et toujours, comment aménager ces activités sans la science ? Et le frère de rappeler que nos ancêtres, pendant des siècles, ont trimé dur à chasser les fourrures et à abattre les arbres en foulant un territoire où l’or affleurait quasiment sous leurs yeux, à leur insu. « Si nous avions eu une géologie il y a un demi-siècle, si nous avions ‘frappé’ à temps l’or en Abitibi, nous n’aurions pas eu la saignée mortelle de l’émigration aux États-Unis.
Il en va de même pour le développement de l’industrie : sans la science, nous sommes à la merci des « mains étrangères ».
Le sexe, un domaine à explorer pour tout scientifique, si prêtre soit-il
Si les propos qui précèdent risquent de surprendre le lecteur ayant tendance à essentialiser le clergé de l’époque ultramontaine, les suivants pourraient carrément le laisser incrédule.
De 1933 à 1944, le frère Marie-Victorin a entretenu avec une collaboratrice, de formation scientifique elle aussi, une riche correspondance sur la sexualité humaine. Non pas pour condamner et culpabiliser, mais pour savoir et comprendre. De fait, qu’y a-t-il de plus pertinent que la sexualité pour unir les deux sujets d’intérêt du prêtre, qui s’intéresse aux tréfonds de l’âme, et du scientifique, qui envisage la biologie comme un trésor de questions à élucider ?
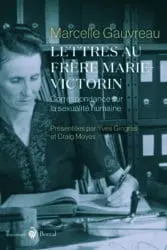 Ayant évidemment fait vœu de chasteté, Marie-Victorin ne connaît pas les plaisirs de la chair. Sa collaboratrice, Marcelle Gauvreau (1907-1968), célibataire, n’a pas plus d’expérience que lui sur le sujet. Mais chacun connaît les ondulations de son propre sexe. Le premier se met donc à questionner la seconde sur les particularités de son anatomie, sur les phénomènes érogènes, etc., tout en se confiant à elle sur les mêmes sujets.
Ayant évidemment fait vœu de chasteté, Marie-Victorin ne connaît pas les plaisirs de la chair. Sa collaboratrice, Marcelle Gauvreau (1907-1968), célibataire, n’a pas plus d’expérience que lui sur le sujet. Mais chacun connaît les ondulations de son propre sexe. Le premier se met donc à questionner la seconde sur les particularités de son anatomie, sur les phénomènes érogènes, etc., tout en se confiant à elle sur les mêmes sujets.
Notre époque perverse et pudibonde aura eu tôt fait de tirer des conclusions hâtives sur ces investigations, et pourtant, les lettres de la sérieuse scientifique2 sont criantes de probité et désarmantes de sincérité. Soyons clair : les lettres de Marcelle Gauvreau trahissent à l’évidence une amitié passionnelle à l’égard de son « petit père », amitié qui semble généreusement partagée. Mais les deux protagonistes, contrairement à leurs lointains et malheureux prédécesseurs Abélard et Héloïse, savent se tenir, autant par conviction morale que pour éviter le scandale. En fait, Gauvreau travaille au quotidien au Jardin botanique que dirige son confident, mais tout est mis en place pour que leur amitié non seulement reste pure, mais garde en outre apparence de pureté. Ainsi lui écrit-elle, en prévision de son retour après une longue absence : « Cependant, je sais qu’elle sera bien simple, la réception que je devrai vous faire. Un pauvre petit regard contenu, une poignée de main presque froide, sans un mot, sans la moindre parole d’affection. Mais mon cœur battra à tout rompre, et vous devinerez mes sentiments ».
Toutefois, au-delà de ces effusions émotives, c’est bel et bien l’exploration du sexe par les biais biologique et psychologique qui constitue l’essentiel de cette correspondance qu’ils qualifient de « lettres biologiques ». « Vous dites à la page 18 que vous comprenez que si je ne touche pas au clitoris, il ne s’y passe rien. Oui, en général. Mais je viens de constater que la veille des menstruations et le jour où l’on se sent davantage surexcité, le clitoris bouge de lui-même et tressaute soudainement, sans cause psychologique apparente. »
Gauvreau fera aussi l’éducation du frère, notamment, sur la terrible épreuve mensuelle que peuvent représenter les « indispositions » chez certaines femmes qui doivent pourtant ne rien laisser paraître ; la lettre où elle raconte par ailleurs comment se sont passées ses premières règles et comment plusieurs de ses camarades ont vécu la chose à une époque où il n’était pas question d’informer d’avance les jeunes filles de leur physiologie est particulièrement éloquente. Et 75 ans avant #MoiAussi, après avoir décrit en détail comment les mamelons, excités par « un chatouillement du doigt », « se soulèvent et pointent comme de petits effrontés », elle précise, évoquant une expérience personnelle malheureuse : « En tout cas, je puis affirmer pour ma part que c’est bien désagréable d’être touchée aux seins sans consentement ».
Microscope sur un microcosme
Ces deux ouvrages n’ont certes pas de quoi renverser l’essentiel des idées reçues d’aujourd’hui sur cette époque reculée ; car en fait, les nombreux discours et articles du frère Marie-Victorin montrent à quel point il se heurtait constamment à la force d’inertie non seulement d’une Église, mais de tout un peuple, y compris ses élites politiques, qui n’avait pas l’habitude de se voir à l’avant-garde des développements humains et scientifiques. Quant à la correspondance entre les deux complices unis par de chastes et puissants sentiments, elle trahit aussi les progrès qu’il restait à faire par notre société quant à « cette gêne ridicule et mystérieuse entourant les phénomènes sexuels ». Mais elle contient aussi et surtout des propos touchants, instructifs, parfois naïfs, et toujours d’une droiture et d’une sincérité qui forcent le respect.
1. Frère Marie-Victorin, Science, culture et nation, textes choisis et présentés par Yves Gingras, Boréal, Montréal, 2019, 182 p. ; 14,95 $.
2. Marcelle Gauvreau, Lettres au frère Marie-Victorin. Correspondance sur la sexualité humaine, présentées par Yves Gingras et Craig Moyes, Boréal, Montréal, 2019, 278 p. ; 20,95 $. En 2018 sont parues les lettres de Marie-Victorin appartenant à la même correspondance, sous le titre Lettres biologiques. Recherches sur la sexualité humaine. Les lettres de Marcelle Gauvreau étaient encore sous scellé au moment de l’édition de ce dernier ouvrage.
EXTRAITS
Les naturalistes des États-Unis, voire même de simples touristes, consacrent des mois d’étude à notre sol québécois, pendant que nous faisons de l’auto ou de la pêche à la ligne !
Marie-Victorin, « L’étude des sciences naturelles. Son développement chez les Canadiens français », 1917, dans Science, culture et nation, p. 36.
Notre classe instruite, nos intellectuels, nos hommes de science, nos financiers ne peuvent plus s’enfermer dans le cercle étroit du Québec.
Marie-Victorin, « Les sciences naturelles dans l’enseignement supérieur », 1930, dans Science, culture et nation, p. 89.
Ceux qui, comme l’auteur de ces réflexions, ont parcouru le Québec en tous sens, ceux qui connaissent de connaissance personnelle et l’inouïe richesse du sol laurentien et l’incroyable exil des Laurentiens dans leur propre patrie, ceux-là se demandent comment l’on pourra jamais reconquérir ce qui fut perdu, soit à cause d’un déterminisme historique sur lequel nous n’avions pas plus de prise que sur les nuages du ciel, soit à cause d’une naïveté et d’une ignorance qui nous livrèrent sans défense à la domination économique de nos conquérants et de nos puissants voisins.
Marie-Victorin, « Après la bataille, les œuvres de la paix », 1936, dans Science, culture et nation, p. 120-121.
Qui pourrait me conseiller mieux que vous, mon frère, puisque vous êtes le seul à connaître mes tourments passés et présents, tout mon amour pour l’Institut botanique, et le vaste rêve d’une vie pleine et utile !
Marcelle Gauvreau, lettre du 31 décembre 1934, dans Lettres au frère Marie-Victorin, p. 47.
Beaucoup de femmes se contenteraient peut-être d’être aimées de mille autres façons moins violentes. Avant le mariage – chez la plupart de mes amies, du moins – se manifeste une certaine crainte du coït, à peine atténuée par l’amour.
Marcelle Gauvreau, lettre du 12 novembre 1939, dans Lettres au frère Marie-Victorin, p. 172.
Pour plus de clarté, je vous donne quelques détails sur la venue des « règles », car d’après une conversation récente, je crois saisir que vous n’aviez peut-être pas pensé que nous pouvions nous faire surprendre très désagréablement.
Marcelle Gauvreau, lettre du 24 mai 1940, dans Lettres au frère Marie-Victorin, p. 199.









