Voici un livre de nature à marquer le débat public sur la laïcité et le vivre-ensemble au Québec. Les auteurs, experts des relations interethniques et des aspects politiques reliés à l’islam, remettent en question quelques idées convenues sur les liens entre islam et islamisme, de même que sur les rapports entre la population d’origine arabo-musulmane et le reste de la société québécoise.
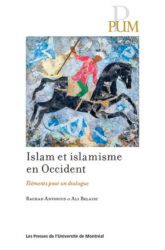 Islam et islamisme en Occident1 est un essai important, d’abord par son propos, mais aussi parce que les auteurs, comme ils le précisent eux-mêmes, critiquent « de l’intérieur » l’influence de l’islam politique dans l’ensemble des sociétés où vivent des communautés de culture musulmane. Rachad Antonius, sociologue et professeur associé à l’Université du Québec à Montréal, est d’origine égyptienne. Ali Belaidi enseigne en sociologie du travail à l’École nationale supérieure de management, en Algérie. Mettant en commun leurs expertises et leurs expériences, les auteurs apportent un nouvel éclairage sur la question sensible de l’islam au sein de la société québécoise.
Islam et islamisme en Occident1 est un essai important, d’abord par son propos, mais aussi parce que les auteurs, comme ils le précisent eux-mêmes, critiquent « de l’intérieur » l’influence de l’islam politique dans l’ensemble des sociétés où vivent des communautés de culture musulmane. Rachad Antonius, sociologue et professeur associé à l’Université du Québec à Montréal, est d’origine égyptienne. Ali Belaidi enseigne en sociologie du travail à l’École nationale supérieure de management, en Algérie. Mettant en commun leurs expertises et leurs expériences, les auteurs apportent un nouvel éclairage sur la question sensible de l’islam au sein de la société québécoise.
Au cœur de l’essai, un constat : généralement, les adeptes de la religion musulmane, de même qu’une certaine gauche dite inclusive, demandent unilatéralement à la société majoritaire d’accommoder les pratiques rituelles islamiques dans l’espace public. Ainsi, les tensions entre les musulmans et le reste de la société sont généralement expliquées par « une seule catégorie de variables, se rapportant toutes à la société d’accueil : racisme, islamophobie, héritage colonial, orientalisme, suprématie blanche, ‘catho-laïcité’, position minoritaire dans le Canada anglais, mouvements nationalistes, etc. ». Partant de ce constat, les auteurs avancent que le vivre-ensemble au Québec serait davantage favorisé par des efforts de rapprochement plus symétriques.
Il est vrai que, pour une large portion de la mouvance progressiste, faire porter une partie du blâme sur la communauté arabo-musulmane est passible de condamnation sans appel. Mais il n’est pas question pour Antonius et Belaidi de blâmer les uns ou les autres. Leur projet consiste à enrichir notre compréhension des enjeux et à promouvoir le dialogue entre les parties. Dans cette optique, ils font valoir que l’on ne saurait progresser dans la résolution des tensions sans explorer les « variables renvoyant à l’autre pôle : les groupes musulmans eux-mêmes, avec leurs histoires, leurs cultures diverses, et surtout les tendances idéologiques qui ont émergé au courant des dernières décennies dans la mouvance de l’islam politique, et qui ont acquis une importance et un poids inattendus ».
Les sociologues développent leur thèse en trois parties. Dans un premier temps, ils procèdent à un retour sur les origines et l’évolution de l’islam, afin de montrer que les courants islamistes d’aujourd’hui sont inspirés par l’histoire de la religion musulmane. Ils décrivent ensuite certains courants islamistes contemporains, pour enfin examiner quelques aspects propres à l’islamisme au Québec.
Politique et violence dès les origines
Antonius et Belaidi ne nient pas que les luttes de pouvoir, les intrigues politiques et les violences au nom d’une supériorité morale sont typiques de toutes les religions. Ils notent cependant que les origines de l’islam sont particulièrement marquées par le lien entre religion et politique, et que cette particularité inspire les courants islamistes contemporains. Se référant à des sources historiques reconnues, les sociologues rappellent notamment que le fondateur Mohamed, après avoir mis en place un État musulman, mène systématiquement des attaques de caravanes, justifiées en tant que représailles contre un pouvoir tyrannique mais néanmoins assimilables à une guérilla. Après Mohamed, les califes régnants se succèdent en s’imposant généralement par la violence armée. Enfin, la période dite « du califat », qui s’étend sur près de treize siècles, est marquée par la volonté, souvent couronnée de succès, d’étendre son pouvoir par les guerres de conquête.
Toujours en s’appuyant sur des travaux d’historiens, Antonius et Belaidi soutiennent que les sociétés musulmanes du début du XXe siècle avaient, à des degrés divers, amorcé une sécularisation. Ces avancées demeuraient toutefois fragiles et la période des conquêtes califales prenait racine dans l’imaginaire : « [L]e calife s’imposait au peuple par la force, puis renforçait sa légitimité en emportant des victoires militaires. Sa disparition n’a pas empêché son existence comme trace, comme souvenir glorieux, dans la conscience collective des peuples arabes et arabisés ». L’expansion coloniale et ses nombreuses conséquences vexatoires auraient alors favorisé, dans une partie des populations du monde arabe, un désir de retour à une période dont on ne retenait que la face glorieuse. Les courants islamistes seraient nés dans ce terreau.
L’islamisme dans les sociétés modernes
Le regard analytique porté par Islam et islamisme en Occident permet entre autres d’opérer les distinctions qui s’imposent entre divers mouvements politiques se réclamant des origines de la religion musulmane. Les auteurs de l’essai voient dans le terme islamisme une notion générique, exprimant essentiellement le recours à la religion dans un dessein politique : « L’islamisme est un courant politique qui veut mettre le dogme de l’islam au cœur du projet politique et du système de gouvernement ». Selon cette acception, l’islamisme se décline lui-même en diverses tendances, dont le salafisme et le wahhabisme, caractérisées par une lecture rigoriste des textes du Coran et l’apologie d’un retour à l’Islam des premiers temps. Le wahhabisme se définirait par ailleurs comme une variante du salafisme, diffusée par la monarchie d’Arabie saoudite.
Antonius et Belaidi insistent sur le fait que ces versions rigoristes de l’islam proposent non seulement une manière de pratiquer sa religion, mais aussi une forme d’ordre social estimé supérieur. En effet, les auteurs mentionnent que les tenants du salafisme cherchent à remplacer les usages et les acquis de la société moderne par les conceptions de l’autorité et des rapports sociaux qui prévalaient à l’époque du Prophète et des quatre premiers califes. Ils précisent que l’influence du salafisme dans les sociétés arabes est devenue plus visible à partir des années 1970, alors que se multipliaient les manifestations d’un nouveau rapport au religieux, faisant fi des traditions locales. Entre autres exemples, ils mentionnent que le hijab n’était auparavant pas jugé obligatoire par les autorités de la religion musulmane. Ce serait sous la pression exercée par l’Arabie saoudite que les institutions du pouvoir religieux auraient publié des fatwas décrétant l’obligation du port du voile. Pour les sociologues, cette volonté d’imposer des pouvoirs dictatoriaux fondés sur la religion est qualifiable de « mouvement identitaire suprémaciste ».
Cela dit, le propos d’Islam et islamisme en Occident est toujours nuancé. Ses auteurs prennent soin de mettre en garde contre l’attitude discriminatoire qui consiste à considérer en bloc les personnes d’origine arabo-musulmane comme des islamistes. En même temps, ils mettent en lumière l’impossibilité d’une division nette entre, d’une part, des extrémistes violents et, d’autre part, une majorité de bons pratiquants de l’islam, en accord avec les valeurs universelles promues dans les démocraties libérales. Leur perspective ouvre les yeux sur une diversité de rapports à l’idéologie islamiste dans les populations de culture musulmane, selon un continuum qui va de l’adhésion au rejet, en passant par certains degrés d’influence insidieuse. De plus, ils font valoir que l’on observe aujourd’hui une évolution à l’échelle des communautés et des populations. L’influence de l’islamisme connaîtrait un déclin depuis le Printemps arabe, en 2011, sachant que cette éclosion de contestations fut en partie une révolte contre les diktats islamistes et les exactions commises par leurs adeptes.
Communauté arabo-musulmane et vivre-ensemble au Québec
Les rapports avec la religion et avec les nouveaux arrivants prennent un tour particulier au Québec où, comme le notent Antonius et Belaidi, la société francophone est sous pression, à la marge d’un continent à dominante culturelle anglophone. Le conflit entre visions opposées concernant la laïcité de l’État, et qui a donné lieu à des débats souvent acrimonieux ces dernières années, est en partie lié à ce contexte. Néanmoins, les auteurs soulignent qu’il est possible de surmonter certaines difficultés du vivre-ensemble par une meilleure connaissance des histoires et des cultures respectives de la société d’accueil et des communautés issues de l’immigration. Cela sans mettre de côté l’analyse et l’esprit critique.
Le débat entourant l’adoption de la Loi sur la laïcité de l’État, en 2019, est l’un des principaux points d’ancrage de la dernière partie de l’essai. Les auteurs y affirment que cette loi n’a rien de raciste ou de xénophobe, puisque l’objectif d’assurer la neutralité religieuse de l’État est garant du respect des différences. Selon eux, « [l]es arguments contre la loi relèvent principalement d’une conception de la diversité selon laquelle les institutions publiques doivent s’ouvrir à la normativité religieuse, et non seulement à la diversité religieuse ». Or, si ces arguments devaient prévaloir contre la Loi, cela signifierait que des personnes représentant l’État pourraient manifester par des signes extérieurs leur désaccord avec les normes de l’institution qu’elles représentent. Mais plaider en faveur de cette loi n’empêche pas les auteurs d’exprimer des réserves quant à sa portée. Notamment, s’ils considèrent que le personnel enseignant ne devrait pas porter de signes religieux, l’interdiction de le faire n’est pas selon eux la meilleure manière d’atteindre l’objectif.
Pour les sociologues, l’opposition d’une partie de la gauche québécoise à la Loi sur la laïcité de l’État est en rupture avec la posture progressiste traditionnelle en faveur de la laïcité. Une politique véritablement inclusive ne peut à leurs yeux négliger de critiquer l’idéologie religieuse, car celle-ci est fondamentalement incompatible avec la laïcité. En négligeant de prendre en compte à la fois l’influence salafiste et la croissance d’un sentiment anti-islamiste dans la communauté d’origine arabo-musulmane, le discours des groupes dits inclusifs « renforce et reproduit la polarisation qu’il dénonce ». L’essai se termine par un appel des auteurs à la communauté musulmane pour un renouveau de l’islam, lequel serait susceptible de faciliter le dialogue avec la société occidentale.
1. Rachad Antonius et Ali Belaidi, Islam et islamisme en Occident. Éléments pour un dialogue, Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 2023, 210 p.
EXTRAITS
Mohamed reprend, dès l’an 2 de l’hégire ([soit en l’an] 624), la coutume bédouine des razzias. Les premiers raids sont lancés contre les caravanes des riches Mecquois qui l’avaient chassé de sa ville. L’objectif de ces raids n’est nullement la conquête, mais bien plutôt le butin.
p. 34
En posant un regard objectif sur l’enchaînement du pouvoir califal, on ne peut que constater la mise en place d’une tradition de gouvernement fondé sur le despotisme et l’usurpation de l’autorité califale, c’est-à-dire une tradition de tyrannie doublée d’une usurpation de l’autorité divine. Cela n’est pas très différent de ce qui se passe dans d’autres cultures, mais la sacralisation de cet état de fait par la religion, dans l’imaginaire collectif, est plus marquée dans le monde islamique qu’ailleurs.
p. 53
Pour les sociétés musulmanes, la religion joue un rôle structurant, surtout depuis la propagation des versions rigoristes de l’islam à partir des années 1970, aidée par la montée en puissance de l’Arabie saoudite qui a propagé une version spécifique de ce rigorisme, le wahhabisme.
p. 52
Une considération transversale dans cet ouvrage pose que les conceptions du monde et de l’ordre social idéal portées par les courants de l’islam politique sont en fait beaucoup plus préoccupantes que la question de la violence.
p. 25
La citoyenneté commune ne peut s’épanouir dans le contexte d’une guerre symbolique entre des groupes déterminés par des identités crispées, que ce soient celles de la majorité ou celles des minorités.
p. 185










