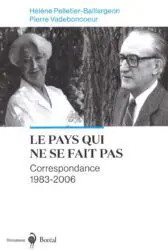Pierre Vadeboncœur aura été un des derniers à pratiquer un art épistolaire inspiré et généreux que l’usage généralisé du courrier électronique a condamné à une disparition radicale. Sa correspondante l’engage avec insistance à réunir ses lettres (qui se comptent par milliers), car elles font partie de sa création littéraire. Vadeboncœur, qui résiste, était porté à minimiser l’importance de ses écrits dans leur ensemble, en quoi il ne voulait pas voir une œuvre. Néanmoins il a suivi le conseil puisque, après les correspondances si riches avec André Major et Paul-Émile Roy, voici celle qu’il a entretenue avec Hélène Pelletier-Baillargeon à partir de 1983 jusqu’en 20061. La teneur en est plus circonscrite que dans les correspondances précédentes, comme le titre l’indique sans ambiguïté.
Intervalle névralgique et, on le sait, crucial pour la « problématique souverainiste ». Tel est le thème central, quasi exclusif, de ces lettres. D’un côté l’aîné jouissant d’un prestige acquis d’abord dans ses luttes syndicales et par déjà une quinzaine de livres dont beaucoup ont fait date, qui l’ont établi comme un brillant essayiste et une des têtes pensantes du Québec. De l’autre une journaliste connue, féministe et souverainiste convaincue et militante, qui rêve d’écrire ses propres livres alors que les circonstances lui feront souvent obstacle. Entre les deux donc, un écart dans l’expérience et dans la création littéraire mais jamais Vadeboncœur n’endosse le rôle du mentor. Un profond respect mutuel les rapproche, une amitié confiante et chaleureuse nuancée de complicité que rien ne vient perturber et une admiration réciproque. Tous les deux la méritent ! Et d’un commun accord ils diront dans leurs lettres ce qui ne pourrait se dire en public : ils se vident le cœur.
« Creuser la problématique nationale »
La première lettre donne le ton de ce qui va suivre par dizaines et définit sa position : « Je pense profondément que nous sommes vaincus, et plus superficiellement, qu’il nous faut en tout état de cause agir comme vaincus, c’est-à-dire, tout de même, exister le plus possible ». À l’encontre de sa correspondante encore prête à la lutte par son tempérament et son énergie, il se dit et ne cessera de se dire pessimiste. Mais, Vadeboncœur en son style incisif coutumier, Pelletier-Baillargeon à sa manière vive, spontanée, souvent colorée, ils s’encouragent mutuellement à « ne pas lâcher ».
Double témoignage donc sur ces vingt années où la situation politique du Québec aurait pu basculer. Si les deux correspondants disent leur déception, leur lassitude, voire leur découragement lors des deux échecs référendaires, ils en cherchent les causes profondes. Adoptant une perspective historique élargie, ils voient en ces échecs des moments significatifs dans le destin du peuple québécois paralysé par le « complexe du vaincu », stigmatisé par son « sommeil à l’histoire » et une impuissance devenue congénitale.
Les commentaires se multiplient au fil de l’actualité qui, ils le reconnaissent et le déplorent, ramène à un ressassement inéluctable. Les hommes politiques qui ont fait l’histoire du Québec paraissent en ces pages avec un relief étonnant – et c’est là aussi un des intérêts majeurs de cette correspondance. René Lévesque, bien sûr, le père fondateur admiré pour ce qu’il a fait et pour ce qu’il a été. On ne peut en dire autant de tous ceux qui lui succèdent… Chez Parizeau – que Vadeboncœur a connu enfant – est souligné un écart surprenant entre le chef de l’opposition d’une intelligence hors du commun mais raide et fébrile parce que mal à l’aise face au monde des émotions, et le premier ministre qui parle en maître. Un Bourassa flottant et fluctuant, un Lucien Bouchard pour lequel Vadeboncœur marque une sympathie et une reconnaissance dont il n’a pas toujours été gratifié. Remarques sur le suicide d’Aquin, sur Bourgault ou Chartrand, coups de griffes à l’endroit de Charest, de Dumont, inévitablement de Trudeau dont Pelletier-Baillargeon trace un portrait qui est un véritable morceau d’anthologie, mais ne conduisant jamais à des accusations ad hominem.
Les Québécois, répètent les deux correspondants, font leur malheur, voire provoquent leur désastre (le mot est prononcé) par leur irrésolution et leur soumission trop facile. Par une sclérose, aussi, dans un contexte social en pleine mutation, ce qui rend les militants souverainistes aveugles à la nouvelle réalité, c’est-à-dire entre autres à l’influence du puissant voisin qui gagne tous les secteurs. À cet égard, alors qu’il est devenu de bon ton de souligner « l’américanité » du Québec, Vadeboncœur réaffirme sa fidélité à la France, dont il se dit « épris » (par exemple dans sa Lettre à la France) et qu’il prend pour référence, dans son histoire et dans sa culture (il nomme Georges Bernanos, Emmanuel Mounier ou Simone Weil), rappelant qu’elle a donné au peuple québécois ses racines. Position « ringarde » aux yeux de beaucoup (il constate l’apparition du mot dans le vocabulaire contemporain). Que lui importe : il persiste et signe.
Renoncer ou tenir le coup ?
Dans sa dernière lettre à Pelletier-Baillargeon, quatre ans avant sa mort, ses convictions n’ont pas changé, même s’il a pris du recul, et il réaffirme sa volonté de parler et de se déclarer, sa souffrance aussi de constater que le Québec demeure englué dans ses vieilles ornières. Il ne renie pas son espoir de le voir plus affirmé et maître de son destin mais il comprend bien la nécessité et l’urgence de regarder l’ensemble du monde, les grands enjeux comme l’hégémonie néolibérale des États-Unis et le sort de la planète, qui tendent à reléguer à l’arrière-plan la question nationale. Il en vient même à envisager la disparition possible du Québec. Ce serait alors plus qu’un « génocide en douce », un effacement en douce…
Vadeboncœur « survit » en continuant d’écrire beaucoup – comme Pelletier-Baillargeon qui achèvera enfin sa grande biographie d’Olivar Asselin –, par exemple des commentaires mordants sur l’actualité (pour Le couac très anticonformiste). Mais, poussant plus loin sa réflexion amorcée dans Les deux royaumes (1993), il s’oriente de plus en plus vers la recherche spirituelle. Il se dit « pour moitié croyant, pour moitié agnostique », comme il l’explique dans ses Essais sur la croyanceet l’incroyance (2005) et La clef de voûte (2008). Mouvement perceptible depuis longtemps dans son œuvre (mais souvent négligé par ses commentateurs) qui prend dans les dernières années un élan décisif. Il déclare dans une lettre de 2000 « ne pas être l’homme d’une seule vie » alors qu’il est octogénaire : « Je me sens toujours nouveau devant ce qui sera ».
1. Hélène Pelletier-Baillargeon et Pierre Vadeboncœur, Le pays qui ne se fait pas.Correspondance 1983-2006, Boréal, Montréal, 2018, 302 p. ; 29,95 $.
EXTRAITS
Notre histoire pourrait être lue comme les différentes phases d’un déclin vers la décomposition finale. Même le 15 novembre 1976 s’inscrirait dans cette histoire, comme sursaut. Les poissons qui vont crever sursautent. Mais tout cela n’est peut-être que réponse adéquate à des conditions objectives. On ne peut pas blâmer les peuples. Ils agissent avec une espèce de sagesse pratique. Nous ne sommes pas désespérés, donc nous ne sommes pas révolutionnaires […]. Je n’ai pas le spleen. J’ai encore le goût d’écrire, de casser quelques pipes de plâtre.
Pierre Vadeboncœur, 29 avril 1993.
Comment ne pas voir, quand on travaille en histoire, la résurgence, à chaque génération, de ces campagnes de dénigrement de la France, pour mieux nous détacher de notre racine identitaire. Les conquérants l’ont fait à satiété, se glorifiant de nous avoir donné le parlementarisme. Pourtant, sans la Conquête, la France nous eût bien donné la République […]. Mais personne ne le dit et nos histoires continuent de colporter la lecture historique de l’Autre : une Angleterre démocratique, une France autocratique.
Hélène Pelletier-Baillargeon, 7 février 1999.