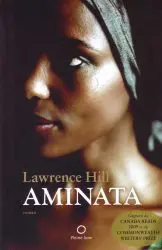Aminata1 est un vaste roman qui décrit la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe. Son chemin de croix laisse une traînée sanglante en Afrique de l’Ouest, aux États-Unis, en Nouvelle-Écosse, en Sierra Leone et en Angleterre. Au cœur du récit, une fillette, Aminata, capturée par des vendeurs d’esclaves et monnayée au gré de propriétaires partageant, à défaut d’une même nationalité, une commune inhumanité.
Dès le départ, Lawrence Hill veille à bien équiper Aminata. La fillette maîtrise le bambara et le peul, elle apprend de sa mère l’art des accoucheuses et la connaissance des herbes, elle sait les vertus de la lecture. Là-dessus se greffent la fierté et la détermination que donne le culte de la liberté. Le bagage, qui comblerait une vie normale, suffira pourtant à peine, tout à l’heure, à préserver en Aminata un souffle de vie. Ses talents de sage-femme précoce et d’interprète la rendent utile dès l’horrible traversée de l’Atlantique. Cette utilité lui vaut un sursis et une certaine plus-value, mais ne la soustrait pas aux vexations, à la brutalité, au droit de cuissage d’un maître banalement cruel. Seule consolation, la présence occasionnelle de Chekura, un jeune homme croisé au cours de la traversée et qui la fécondera lors d’une de ses apparitions clandestines. La grossesse et la maternité déclencheront chez le propriétaire un surcroît de sadisme. On dérobera l’enfant d’Aminata pour le vendre, on la vendra elle-même à un autre maître. Le jour viendra où elle courra le risque de s’enfuir. Elle volettera d’espoir en rêve, prenant contact avec des abolitionnistes, mettant ses compétences à leur service, préparant d’autres Noirs au voyage vers une Nouvelle-Écosse présentée comme une terre plus égalitaire. Elle-même séduite par ce projet, Aminata émigrera en sol canadien et vivra, comme des centaines d’autres « loyalistes noirs », le plus cruel désenchantement. Le racisme règne là aussi, l’emploi est le fief des possédants blancs, le lynchage se banalise. L’espoir, jamais éteint, s’incarne dans un nouveau projet : celui des abolitionnistes qui prétendent créer en Sierra Leone une démocratie et la peupler d’anciens esclaves. Aminata y voit l’occasion de retrouver son village. Une fois encore, la déception est au poste. À Freeport, les négriers sont à l’œuvre et l’entreprise britannique pactise avec eux, au nom du réalisme. Une fois de plus, Aminata échappe à son carcan et gagne Londres : elle y intervient dans le débat politique sur l’abolition de la traite des esclaves.
Un récit troublant tant il décape les roueries grâce auxquelles l’être humain justifie aux yeux d’autrui et jusque devant sa propre conscience la commercialisation de ses semblables. En Caroline comme en Nouvelle-Écosse, en sol africain comme dans les palabres londoniens, le racisme réussit à mentir et à stériliser même les plus généreuses candeurs.
Sautons deux siècles et demandons-nous si le racisme a été éradiqué de nos pratiques et de nos réflexes. Micheline Labelle, dans  Racisme et antiracisme au Québec2, ne le croit pas. Preuves à l’appui, elle en débusque la sourde présence sous nos latitudes. « L’idéologie raciste, écrit-elle, se structure comme système perceptif essentialiste pour légitimer l’esclavage et le colonialisme ainsi que la domination dans les rapports sociaux. » Autrement dit, l’abolition du commerce esclavagiste ne supprime pas les généralisations méprisantes dont les groupes vulnérables font les frais. Le fouet claque plus rarement, mais la propension demeure de considérer comme inférieur tel ou tel groupe humain.
Racisme et antiracisme au Québec2, ne le croit pas. Preuves à l’appui, elle en débusque la sourde présence sous nos latitudes. « L’idéologie raciste, écrit-elle, se structure comme système perceptif essentialiste pour légitimer l’esclavage et le colonialisme ainsi que la domination dans les rapports sociaux. » Autrement dit, l’abolition du commerce esclavagiste ne supprime pas les généralisations méprisantes dont les groupes vulnérables font les frais. Le fouet claque plus rarement, mais la propension demeure de considérer comme inférieur tel ou tel groupe humain.
L’histoire, à certains égards, semble se répéter. Aujourd’hui comme hier, le sophisme masque les entêtements. Nos ancêtres furent assez astucieux pour distinguer savamment entre traite des esclaves et esclavage. Abolir l’esclavage par l’édiction d’une loi n’émancipait pas les esclaves : on ne les vendait plus, mais ils faisaient encore partie du cheptel. Hypocrisie qu’imite notre époque si elle dissimule son racisme sous des oripeaux trompeurs et chers à la bonne conscience. Micheline Labelle, méfiante et avertie, multiplie les mises en garde. Parler de minorités visibles expose au risque de généralisations politically correct, mais encore perverses. L’épithète même de raciste perpétue peut?être une équivoque malsaine : puisqu’il n’y a pas de races, comment dénoncer le racisme sans réussir la quadrature du cercle ? « Force est de constater, insiste Micheline Labelle, que le discours scientifique, juridique et politique visant à analyser et à contrer le racisme se réfère encore largement à la notion de ‘race’ (à titre de mythe social ou de signe) et contribue inéluctablement, selon nous, à maintenir vivante l’idée qu’il existe des ‘races’, tout en ayant pour objectif de combattre le racisme. » Peu à envier au XIXe siècle.
On progresse quand même, si j’interprète fidèlement l’auteure, si, le plus souvent possible, on substitue au terme de « race » l’expression « groupes racialisés » ou une analogue. On fait alors comprendre, en effet, que c’est l’œil du groupe dominant qui dévalorise les collectivités vulnérables. Il n’y a pas de race, mais des regards qui imputent des caractéristiques infamantes aux groupes fragiles.
Le message de Micheline Labelle est celui de la vigilance. Même dans « les sociétés désireuses de reconnaître les rapports de domination issus du colonialisme », on peut se méprendre. « Le devoir de mémoire est d’ailleurs en forte tension avec les tentatives de réhabilitation des bienfaits de la mission civilisatrice de l’Occident. » Gare aussi aux pressions de la conjoncture. Ainsi, « les événements du 11 septembre 2001 sont perçus comme étant la principale cause de la recrudescence du racisme, particulièrement à l’égard des Arabes et des musulmans ».
Les siècles passent, mais quelque chose d’inquiétant survit dans le cœur humain.
1. Lawrence Hill, Aminata, trad. de l’anglais par Carole Noël, Pleine lune, Montréal, 2011, 568 p. ; 32,95 $.
2. Micheline Labelle, Racisme et antiracisme au Québec, Discours et déclinaisons, Presses de l’Université du Québec, Québec, 2010, 198 p. ; 29 $.
EXTRAITS
Je suis comme vous tous : arrivé en Nouvelle-Écosse il y a sept ans, j’attends toujours la terre qu’on m’a promise. Or, je suis fatigué d’attendre et je voudrais faire bouger les choses.
Aminata, p. 414.
À contre-courant de la tendance dominante, des chercheurs plaident en faveur de l’élimination du mot « race » et contestent le fait que l’on puisse attribuer à la « race » le statut de concept ou de catégorie analytique. Comme nous l’avons écrit ailleurs, nous nous situons dans cette perspective.
Racisme et antiracisme au Québec, p. 20.
Après le 11 septembre 2001, les infractions et les crimes haineux visant des musulmans et des personnes originaires du Moyen-Orient ou d’Asie du Sud se sont multipliés aux États-Unis
Racisme et antiracisme au Québec, p. 31.
La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance souligne à juste titre qu’aucune définition du racisme, de la xénophobie, de l’antisémitisme, de l’intolérance n’est universellement acceptée.
Racisme et antiracisme au Québec, p. 10.