L’écriture comme une arme pour rester debout fait contrepoids à la grande mélancolie qui parcourt les plus récents livres de poèmes de Sylvie Nicolas, tous deux parus au printemps dernier. Fragments de lecture d’une poésie aussi salvatrice qu’indomptée.
« Ta peau sur l’échiquier du réel »
Dans Aucun mot n’est tenu au miracle1, les poèmes se déploient comme à travers les pages éparses d’un carnet où se joue le récit d’une rencontre marquante. Nicolas s’applique à en garder les traces. Les titres des poèmes, par exemple « Page dix-neuf de ta vie », « Un chapitre entier », « Page manquante du livre de mai », « Page cinquante-neuf du livre qui tente de se refermer », se lisent comme des précisions sur des instants dont la poète se souvient, à sa manière. Ils accentuent la sensation de lire quelque chose de très intime. Aux prises avec les images, les souvenirs d’une proximité où l’émotif et l’organique se chevauchent, la narratrice évoque un passé dévorant et, même si tout semble derrière, rien n’est bouclé. Les secrets sont préservés, dans cet étrange carnet.
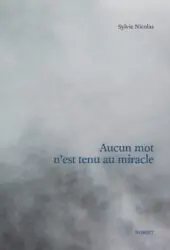 Il y a ce corps tombé, et on assiste à une collision entre le quotidien et le désir, à un accident retracé, consigné par la poésie. Il y a celle qui écrit, qui se met à distance d’elle-même, et puis il y a ce vous qui hante, dont l’histoire reste en suspens.
Il y a ce corps tombé, et on assiste à une collision entre le quotidien et le désir, à un accident retracé, consigné par la poésie. Il y a celle qui écrit, qui se met à distance d’elle-même, et puis il y a ce vous qui hante, dont l’histoire reste en suspens.
« Entre ta peau et la sienne / l’indompté et ses océans / suffisamment sauvages / pour faire de vous des espèces / en voie d’apparition ».
La folie, l’irrationalité du désir, sa puissance nourrissent la narratrice, la révèlent à elle-même. Si elle s’y abreuve, elle semble aussi les craindre, tout comme elle appelle et redoute les élans du corps. L’émotion est à fleur de peau. Elle oscille entre la banalité du quotidien et une certaine violence, créant des ambiances graves, trop lourdes pour un cœur. Entre liberté, asservissement et quête d’équilibre, « [l]e désordre court pieds nus dans une cage ».
Le réel est protéiforme, à la fois obstacle et source d’émerveillement, d’éblouissement, d’ennui. Il est aussi épreuve, et « jouons à ne pas mourir » (les derniers mots du livre) sonne un peu comme si c’était tout ce qu’elle avait fait dans le livre, jouer, vivre, être entièrement présente, envers et contre tout, contre tous.
Plusieurs textes comportent des passages en italique, souvent commençant par la même formulation : longtemps tu as cru. À présent, le réel la ramène sur terre. Elle croyait ceci, mais ses illusions, ses rêves se sont brisés ou envolés. Longtemps tu as cru, comme si à présent elle voyait clair, ne se racontait plus d’histoires.
Engagée autant que cryptée, la poésie de Sylvie Nicolas est absolue, corps, chair, tête, cœur, mots et silence. Tout devient arme pour vivre.
Aucun mot n’est tenu au miracle comme un constat, la tentative de refaire le fil, de comprendre : que s’est-il passé ? À quel moment, comment les cœurs se sont fracassés, les mots ont perdu leur pouvoir ? De Sylvie Nicolas, l’autrice Alix Paré-Vallerand, qui l’a côtoyée dans le cadre du programme de mentorat de Première Ovation, dit qu’elle revendique le droit à la tristesse. La tristesse dans un lac de colère. La tristesse des femmes. Des deux livres printaniers de la poète, le chagrin déborde. Il se porte comme une écharpe douce.
« Debout je suis »
« [J]’apprenais cicatrices et tatouages / poings refermés sur le silence / j’apprenais à lire la honte / accrochée aux épaules / à lire le désordre / dans ses commencements / j’apprenais ».
La voix qui tisse la trame de Nos yeux dans le bac bleu2 s’élève et se bat pour rester fidèle à l’indomptable en soi : « [S]ans la petite / sans le chien / mes veines affolées / se prennent pour des branches / et j’attends / la coupe à blanc ». Sans cette connexion à sa fibre profonde, sans ces présences du chien et de la petite qui l’accompagnent tout au long du livre, la narratrice pourrait se perdre. Dans la figure canine, indocile autant que sage, et dont le motif se répète presque jusqu’à l’obsession tout au long du livre, la poète a peut-être trouvé un miroir, un compagnon, un moteur. Dans celle de la petite, Sylvie Nicolas entretient la curiosité face à la vie, ouvre la porte à la parole pour modeler, pour transformer le morne en quelque chose d’éclatant. C’est un engagement entier de la poète que je retrouve d’un livre à l’autre, et qui passe par une proximité avec cette part ensauvagée, sensible et empathique d’elle-même.
« [L]e silence n’a pas capitulé / il porte la résistance / des amours en sursis ».
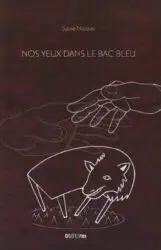 Critiques d’une société froide, fabriquée, prémâchée, loin de l’enchantement, les poèmes qui forment Nos yeux dans le bac bleu sont un cri de désespéré pour exister. La force du silence n’a d’égale que celle de l’amour, de la fureur de vivre. Des machinations qui nous transforment en produits de consommation à récupérer, du formatage de nos âmes restent la lumière, la poésie, notre part farouche, l’intraitable en nous pour « infiniment japper une sorte de je t’aime / destiné à rameuter ce qui nous reste de chien / en dedans du corps / continuer de japper / la parole / sans laisse / résolument / sans sa chienne de laisse ».
Critiques d’une société froide, fabriquée, prémâchée, loin de l’enchantement, les poèmes qui forment Nos yeux dans le bac bleu sont un cri de désespéré pour exister. La force du silence n’a d’égale que celle de l’amour, de la fureur de vivre. Des machinations qui nous transforment en produits de consommation à récupérer, du formatage de nos âmes restent la lumière, la poésie, notre part farouche, l’intraitable en nous pour « infiniment japper une sorte de je t’aime / destiné à rameuter ce qui nous reste de chien / en dedans du corps / continuer de japper / la parole / sans laisse / résolument / sans sa chienne de laisse ».
« Zone zéro », deuxième section de Nos yeux dans le bac bleu, qui tire son titre d’une chanson de Jean Leloup, sort les crocs. La critique de ce qui nous déshumanise, de ce qui nous récupère, est plus corrosive. La main tendue devient bras ouverts pour se lier à l’autre, qu’il soit intime ou anonyme. Se répète dans cette section, tissée de liens avec la première partie du livre, la formule toi comme moi, une façon de conjurer la solitude. L’ouvrage se termine sur une longue suite d’une rare intensité, un souffle comme une tempête qui vient tout ramasser, éclairer un peu la douleur, et qui fait résistance à ce qui écrase.
Dimension charnelle, force du corps, puissance du désir imprègnent les deux livres et, si la rédemption vient de la découverte du langage, elle arrive aussi, par le contact indéfectible avec l’autre, comme un baume sur le chagrin : « [S]onger que la peau nue / a ses chapitres de mémoire / accostés au pied du lit ». La bouche et ses déclinaisons se multiplient à travers les deux livres ; un kaléidoscope où l’on embrasse, on lèche, on parle, on dit ou on se tait.
« [P]lus que toute autre chose / tu habites un poème incendié ».
C’est dans ce lieu sans repos que naît la poésie de Sylvie Nicolas. Est-ce la même narratrice qui voyage entre les livres, entre travail de mémoire et révolte, qui porte un hurlement pris dans la gorge sur le point d’éclater ? Je l’entends ainsi, une seule voix riche et escarpée, qui refuse de se taire devant l’adversité ; face à toute forme de conditionnement des cœurs, elle ne laisse rien aller, ne se résigne pas, mais étreint.
1. Sylvie Nicolas, Aucun mot n’est tenu au miracle, Le Noroît, Montréal, 2020, 73 p. ; 17 $.
2. Sylvie Nicolas, Nos yeux dans le bac bleu, Moult, Montréal, 2020, 67 p. ; 14,95 $.
EXTRAITS
Tes doigts se referment sur la queue de l’image disparue
la puissance vibrante de ses lèvres
cette enseigne au-dessus de vos têtes
prière de ne pas stationner
espace réservé au dernier de leurs cris
Aucun mot n’est tenu au miracle, p. 22.
Bien entendu les questions
ne sont que des questions
il suffit de quelques secondes
pour voir mourir des millions d’êtres humains
ou une seule et même personne
à répétition
Aucun mot n’est tenu au miracle, p. 39.
tu notes qu’un doigt posé sur ta bouche
est comme un fusil appuyé sur ta tempe
que le souffle ténu qui s’échappe de tes lèvres
mesure ce qui te sépare de toute chose vivante
Aucun mot n’est tenu au miracle, p. 64.
Petite déjà
le refus
de m’agenouiller dans le silence
de mettre les chiens au pas
de les tenir en laisse
Nos yeux dans le bac bleu, p. 13.
J’ignorais alors que je naîtrais
d’une main sur ma cuisse
d’un souffle sur ma nuque
que je m’accoutumerais à renaître
à coups de caresses
à flanc de falaise
comme un chien
défiant la mort
Nos yeux dans le bac bleu, p. 17.
je suis
de tous les instants
sacrifiés
femmes et hommes
prisonniers d’un temps assassin
hommes et femmes
dans la traverse des champs de mines
ramenés à la file dans leur corps
la raison du plus fort au-dessus de leur tête
Nos yeux dans le bac bleu, p. 59.










