En 2019, huit ans après la parution du recueil de poésie Amour, que veux-tu faire ?, Suzanne Jacob faisait paraître Feu le soleil1. Au même moment, Boréal rééditait son plus récent roman, Fugueuses2 (2005), dans la collection « Boréal compact ». D’un ouvrage à l’autre, le lecteur reconnaîtra de nombreuses lignes de convergence de l’œuvre jacobienne : la force et la complexité du monologue intérieur, l’importance accordée au poids des mots et l’intérêt de l’écrivaine pour les zones d’ombre de la psyché.
La lumière et les ombres
Les textes de Feu le soleil s’éloignent un peu plus de la structure de la nouvelle traditionnelle que ce à quoi Suzanne Jacob nous a habitués dans le passé. Nous y retrouvons un ton et des thèmes qui rappellent la Jacob chroniqueuse des dernières décennies qu’on a pu lire dans la revue Liberté. La plupart des nouvelles se concentrent davantage sur le monologue intérieur des protagonistes que sur une narration des événements, ce qui peut laisser certains lecteurs sur leur faim, mais qui m’apparaît plutôt comme une richesse.
Il y a toujours quelque chose de rond chez Jacob, comme si elle refusait d’aborder les idées et les personnages dans des dynamiques angulaires avec des arêtes très précises. Si parfois ça nous donne le sentiment que le texte fuit, que le sens (premier, volontaire, assumé) nous échappe, nous avons le plus souvent le sentiment d’une responsabilité, comme si nous étions appelés plus que jamais à prendre en charge la lecture dans une posture très active.
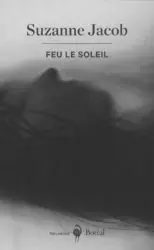 Dans la première nouvelle, « Grande réserve », on trouve d’ailleurs ce passage qui pourrait bien être une réflexion sur l’émergence du personnage hors de la glaise des mots : « Cet instant incroyablement bref où tu franchis le seuil qui sépare l’état de n’être personne pour personne à l’état d’être quelqu’un pour quelqu’un est vertigineux. Je m’en méfie comme de la naissance ». Ainsi, l’écriture de Jacob se fait sur le seuil et confie à ses lecteurs et lectrices le soin de tirer le personnage vers ce quelqu’un qu’il peut devenir. C’est un grand honneur qu’elle nous fait !
Dans la première nouvelle, « Grande réserve », on trouve d’ailleurs ce passage qui pourrait bien être une réflexion sur l’émergence du personnage hors de la glaise des mots : « Cet instant incroyablement bref où tu franchis le seuil qui sépare l’état de n’être personne pour personne à l’état d’être quelqu’un pour quelqu’un est vertigineux. Je m’en méfie comme de la naissance ». Ainsi, l’écriture de Jacob se fait sur le seuil et confie à ses lecteurs et lectrices le soin de tirer le personnage vers ce quelqu’un qu’il peut devenir. C’est un grand honneur qu’elle nous fait !
Qui sont donc ces protagonistes ? Une femme hantée par le souvenir d’une amie disparue, un garçon dérangé par la séparation de ses parents, une adolescente qui accompagne sa mère lors d’une manifestation et une jeune femme portant un lourd secret impliquant l’amoureux de sa mère. Ces personnages, il nous semblera peut-être les avoir croisés ailleurs dans l’œuvre de Jacob, entre autres dans Fugueuses, dont plusieurs des préoccupations sont communes à celles qui habitent les nouvelles plus récentes.
Le poids de la langue
L’une des préoccupations communes aux deux ouvrages, préoccupation que les habitués de Suzanne Jacob ont aussi explorée avec elle dans ses trois essais, concerne le langage. Presque chacune des narratrices de Feu le soleil achoppe sur des mots, des expressions figées ou des contresens qui colonisent nos habitudes langagières et contribuent à bâtir la réalité dans laquelle nous évoluons. La plupart des personnages de l’auteure semblent d’ailleurs atteints de cette maladie des mots qui provoque des carambolages d’associations : « C’était parce que les mots dérapaient et devenaient d’autres mots dans la tête de sa mère. Lui, Nico, il connaissait cette maladie qui entendait les mots se disputer les places assises dans la tête ». Ce travail incessant sur la langue transparaît à la fois dans les monologues intérieurs et dans certains dialogues.
À ce chapitre, la nouvelle qui donne son titre au recueil va encore plus loin en mettant en scène une conférencière dont le monologue intérieur se déploie en parallèle avec sa parole publique, permettant ainsi un contrepoint, une réflexivité. C’est souvent une caractéristique des personnages de Jacob : ils font preuve d’une extrême lucidité face à leurs propres attitudes. C’est peut-être pour ça que les personnages de psychologues apparaissent généralement comme des êtres inutiles à la fois dans Feu le soleil et dans Fugueuses, les protagonistes semblant toujours suffisamment éclairés pour faire leur chemin vers leur vérité propre dans les dédales de mensonges et de non-dits qui caractérisent le vivre-ensemble.
La fugue
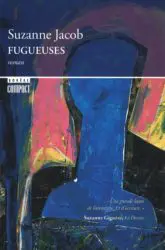 La réédition de Fugueuses dans la collection « Boréal compact » permet de renouer avec ce roman exceptionnel, sans doute un des meilleurs de Suzanne Jacob. Tenter d’en résumer ici la trame ne rendrait pas justice au contenu de ce livre fascinant : « l’arbre généalogique » de Fugueuses est bien emberlificoté et mis à plat, le lecteur pourrait craindre de se retrouver devant une intrigue téléromanesque dans laquelle les drames des uns et des autres sont des prétextes. En fait, Fugueuses est plutôt une tragédie, le récit d’une filiation tortueuse où la pédophilie (contrôlée, présumée ou décomplexée) revient comme un motif atavique et où les silences ne font que reproduire le lit de l’indicible. Il est très parlant à cet égard que, lorsque le personnage de Florence se permet de « rembobiner le film » de ses souvenirs, le mot tabou apparaisse d’abord écrit à l’envers : « Je suis parvenue à isoler le son ‘lifodép’ qui lui rentrait dans la bouche comme un crachat. ‘Lifodép’? […] Et enfin, ‘pédofil’ s’est inscrit. La naine ravalait le mot ‘pédophile’ ».
La réédition de Fugueuses dans la collection « Boréal compact » permet de renouer avec ce roman exceptionnel, sans doute un des meilleurs de Suzanne Jacob. Tenter d’en résumer ici la trame ne rendrait pas justice au contenu de ce livre fascinant : « l’arbre généalogique » de Fugueuses est bien emberlificoté et mis à plat, le lecteur pourrait craindre de se retrouver devant une intrigue téléromanesque dans laquelle les drames des uns et des autres sont des prétextes. En fait, Fugueuses est plutôt une tragédie, le récit d’une filiation tortueuse où la pédophilie (contrôlée, présumée ou décomplexée) revient comme un motif atavique et où les silences ne font que reproduire le lit de l’indicible. Il est très parlant à cet égard que, lorsque le personnage de Florence se permet de « rembobiner le film » de ses souvenirs, le mot tabou apparaisse d’abord écrit à l’envers : « Je suis parvenue à isoler le son ‘lifodép’ qui lui rentrait dans la bouche comme un crachat. ‘Lifodép’? […] Et enfin, ‘pédofil’ s’est inscrit. La naine ravalait le mot ‘pédophile’ ».
Roman choral, Fugueuses se présente d’abord comme l’histoire d’Alexa et de Nathe, deux sœurs rebelles chacune à leur façon. Vient ensuite l’histoire de leur mère, Émilie, et de sa fratrie formée de la grande sœur Stéphanie, morte quelques années plus tôt d’un cancer fulgurant, et d’Antoine, en quelque sorte le personnage refuge de ce roman. Il y a alors l’histoire des parents de ce trio, Xavier et Florence ; surtout Florence, mère énigmatique, privée de douceur, qui ne sera pas sans rappeler la Florence de L’obéissance.Et enfin, Blanche, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, qui s’apprête à mourir et qui tente en vain de prouver à ses descendantes que, malgré les épreuves, quelque chose comme l’amour existe encore.
Or si Fugueuses se présente comme un enchevêtrement d’intrigues et de mystères qui nous tiennent en haleine, sa plus grande force est surtout le déploiement de la pensée de ses narratrices ayant chacune leur voix propre, mais toujours blessée et entravée. Chaque narratrice dissèque sa propre psyché, mais est aussi témoin des tentatives des autres femmes de la famille pour trouver un chemin viable dans une forêt de blessures. Le résultat est un chœur puissant qui rend tous ces personnages pétris de contradictions profondément humains.
1. Suzanne Jacob, Feu le soleil, Boréal, Montréal, 2019, 128 p. ; 18,95 $.
2. Suzanne Jacob, Fugueuses, Boréal, Montréal, 2005, et « Boréal compact », Boréal, Montréal, 2019, 328 p. ; 15,95 $.
EXTRAITS
Elle avait prévu mourir bien plus tard, bien après la fête qu’elle aurait donnée, où elle aurait dansé avec les plus intimes une fois les connaissances reparties. Elle voulait secouer le lourd rideau de scène qui s’obstinait derrière son front. Dans son front, derrière la peau de son front, c’était l’os lui-même, l’os de son front, devenu un lourd rideau de scène – de béton, ma foi ! – qui refusait de se lever.
Feu le soleil, p. 61.
Julie interrompt Judith, elle lui dit que ce qu’elle n’apprécie pas chez elle, c’est sa manie de cacher un homme ou une femme derrière le mot personne, au coin de la rue, est-ce que Judith pourrait dire clairement si c’est un homme ou une femme, cette personne qui se met à désirer si fort que… ?
Feu le soleil, p. 54.
Si elle additionnait les milliers d’actes qu’elle avait accomplis pour assurer le bien-être quotidien de Thomas et des filles, verrait-elle apparaître la forme d’une œuvre qu’elle pourrait reconnaître comme la sienne ? Ou est-ce que cette œuvre-là, composée de milliers de gestes, avait pour destin inéluctable de disparaître nuit après nuit dans un gouffre d’invisibilité sourde, muette, sans poids, sans trace, sans preuve ?
Fugueuses, p. 191.
Quoi qu’il en soit, elle est partie sans nous prévenir, sans avoir trouvé de réponse à son éternelle question – « Maman ? » – et sans avoir compris que la réponse à cette question ne pouvait absolument pas venir de moi, pas plus que la réponse à la question « Mon Dieu ? » ne pourra jamais venir de Dieu.
Fugueuses, p. 210.










