Il y a cette chanson de Billie Holiday, dure, poignante, dans laquelle elle évoque de sa voix plaintive et si caractéristique les arbres du deep south américain. Au bout de leurs branches, raconte-t-elle, pendent des fruits lourds, doucement bercés par la brise chaude. Puis, tandis que résonnent les lamentations d’une trompette, on comprend que ces « étranges fruits » n’en sont pas vraiment, qu’ils représentent en réalité des corps noirs au visage tordu, pendus au bout d’une corde.
Subitement, le tableau idyllique de Lady Day tourne à la vision cauchemardesque ; soudain les fruits mûrs, promesses gorgées de vie, font violemment place aux fruits pourris du racisme.
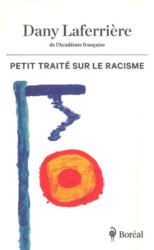 Le changement de registre est brutal. Il résume l’histoire des Amériques. Il en reprend, pour être plus juste, deux visions concurrentes. Pour les uns, une poignée d’individus « élus », le fantasme du jardin promis s’est bel et bien concrétisé ; pour les autres, chassés de ce jardin ou encore employés à le cultiver, les 400 dernières années se résument à une traversée du désert ponctuée de violences, d’injustices et de peines ravalées de travers.
Le changement de registre est brutal. Il résume l’histoire des Amériques. Il en reprend, pour être plus juste, deux visions concurrentes. Pour les uns, une poignée d’individus « élus », le fantasme du jardin promis s’est bel et bien concrétisé ; pour les autres, chassés de ce jardin ou encore employés à le cultiver, les 400 dernières années se résument à une traversée du désert ponctuée de violences, d’injustices et de peines ravalées de travers.
Du Sud au Nord, là où fleurissent les différences, les arbres du racisme ont porté partout leurs fruits corrompus. De Savannah à Saint-Marc-de-Figuery, un même vent d’intolérance a soufflé sur les plantations de coton et traversé les couloirs des écoles résidentielles. En ouverture de son Petit traité sur le racisme1, Dany Laferrière suggère quant à lui qu’il existe divers racismes dans le monde. Noires ou autochtones, les cibles changent, cela ne fait pas de doute. Dans la réédition de Kuei, je te salue. Conversation sur le racisme, Deni Ellis Béchard et Natasha Kanapé Fontaine laissent néanmoins entendre que, par-delà les différences attaquées, les mécanismes de l’exclusion présentent certaines constantes.
« Ces vies fugaces qui peuplent mes nuits »
On le sait au moins depuis la parution d’Autoportrait de Paris avec chat (2018), l’intarissable Laferrière s’adonne également au dessin. Sur la couverture de son dernier essai paru chez Boréal, il commet cette fois une interprétation picturale bien personnelle de « Strange fruit », la chanson de Holiday. Une belle façon d’annoncer ses couleurs : le racisme dont il traitera, confirme-t-il dès les premières lignes, touche prioritairement les Noirs américains.
L’académicien s’était auparavant prononcé dans la fameuse querelle sur le N-word, un euphémisme qu’il a qualifié de « plaisanterie d’une hypocrisie insondable ». Il a de plus réfléchi publiquement à la question du racisme dans les presses française et québécoise. Qu’il publie donc ce tout nouveau Petit traité sur le racisme n’a rien pour surprendre. Il arrive comme arrive le temps doux avec l’été.
Longtemps, confie le Parisien d’adoption, il a colligé les notes, noté les événements, mémorisé les anecdotes, les conversations et les réflexions pour les réunir ici en une collection d’aphorismes, de dialogues, de courts récits et, surtout, de portraits de grands artistes ou penseurs noirs. C’est aussi quand il traite de Langston Hugues, de Ralph Ellison, de Toni Morrison, de Cheikh Anta Diop, de Nina Simone ou de Spike Lee, de ces vies fugaces qui habitent ses pensées et l’accompagnent au quotidien, que Laferrière se montre le plus intéressant.
Le panthéon personnel qu’il dresse tient ainsi de l’anthologie, une anthologie établie sur la base de la diversité. L’homme est cultivé. Il a lu et relu ses classiques, mais ce n’est pas tout. Il sait et reconnaît le rôle crucial des femmes dans l’histoire et la culture afro-américaines. À cette présence féminine déterminante, il ajoute encore plusieurs références à la culture populaire pour garantir à son ouvrage une juste représentativité.
Le racisme, conséquemment, est souvent traité par références interposées. L’approche choisie le commande ; plutôt que d’aborder frontalement le problème de la race, l’écrivain établit une revue de personnages artistiques marquants qui eux, ont ausculté, soit par la chanson, la poésie, le roman, l’essai ou le cinéma, la douleur d’être Noir. Le racisme se situe donc à l’arrière-plan de plusieurs portraits, dont l’intérêt principal est de servir de guides vers une meilleure connaissance de la culture noire de la résistance et de la contestation aux États-Unis, de Frederick Douglass à Tupac Shakur.
Cette préséance offerte à la culture dans le Petit traité sur le racisme dévoile la position du littéraire devant les enjeux contemporains de la race et de l’exclusion. Pour Laferrière, la culture, et plus encore l’écriture et la lecture, édifie un rempart contre le racisme : « Depuis le début, l’alphabet renverse les puissances ou écrase les petits », avance-t-il. « On écrit pour construire comme pour détruire. Il nous faut intervenir de manière durable et en profondeur. Il faut écrire des livres qui intéressent les jeunes gens. » On peut critiquer l’idéalisme d’une telle profession de foi envers le livre, et relativiser le pouvoir réel de l’alphabet quand il n’est pas précédé ou accompagné d’un pouvoir politique ou militaire. Un fait demeure. Si la lecture permet une meilleure connaissance de l’Autre, elle participe à bâtir une plus grande considération envers lui.
Cet art presque perdu du dialogue
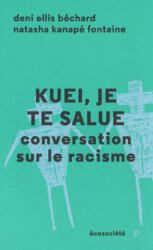 Parce qu’il suppose un élan vers l’Autre, le dialogue est un autre moyen de percer la superficialité des représentations stéréotypées pour atteindre à une certaine vérité inscrite au cœur de l’altérité. Bien sûr, l’ouverture est la condition minimale d’un tel échange ; il faut, pour dialoguer efficacement, être disponible et curieux. Une fois rassemblées ces conditions gagnantes, une fois dépassées les impressions premières, il y a fort à parier que cette altérité traduirait davantage de ressemblances que de différences entre les interlocuteurs.
Parce qu’il suppose un élan vers l’Autre, le dialogue est un autre moyen de percer la superficialité des représentations stéréotypées pour atteindre à une certaine vérité inscrite au cœur de l’altérité. Bien sûr, l’ouverture est la condition minimale d’un tel échange ; il faut, pour dialoguer efficacement, être disponible et curieux. Une fois rassemblées ces conditions gagnantes, une fois dépassées les impressions premières, il y a fort à parier que cette altérité traduirait davantage de ressemblances que de différences entre les interlocuteurs.
La peur de l’Autre, dont le racisme est une excroissance toxique, viendrait de ce que cet Autre n’a pas eu la chance de raconter son histoire ou de ce que personne n’a bien voulu l’entendre. C’est une semblable impasse qui donne naissance à Kuei, je te salue. Conversation sur le racisme2, paru pour la première fois en 2016 chez Écosociété.
D’abord, il y a eu ce billet incendiaire de Denise Bombardier, « La culture autochtone qui tue », dans le Journal de Montréal. La chroniqueuse y réagissait alors au décès d’une jeune Ojibwée de l’Ontario dont la famille avait suspendu les traitements de chimiothérapie afin, selon ses dires, de confier le sort de la préadolescente à la médecine traditionnelle autochtone. Bombardier voyait là le signe d’une culture mortifère et antiscientifique. On apprendra plus tard que les proches de Makayla Sault avaient plutôt accepté le traitement d’un institut de médecine alternative de la Floride. Le mal, lui, était fait.
Outrée par la grossièreté de ces affirmations, Natasha Kanapé Fontaine s’est rendue au Salon du livre de la Côte-Nord dans le but de verbaliser ses doléances à la polémiste. Or, au moment de lire sa lettre, la fougueuse poète innue est interrompue par Bombardier qui, armée de son micro, sert alors à sa défense un extrait contenu sous l’entrée « Indien » de son Dictionnaire amoureux du Québec. Le débat est aussitôt clos, on passe à un autre appel.
Parmi le public, Deni Ellis Béchard observait la scène. Il saisira au bond ce rendez-vous manqué pour entamer le dialogue avec Fontaine, lequel dialogue s’est par la suite matérialisé en projet d’échange épistolaire sur le racisme. Né d’une mère américaine et d’un père moitié gaspésien, moitié truand, Béchard a vécu au Canada et aux États-Unis. Il sait le racisme ordinaire des blagues qui courent en Nouvelle-Angleterre, sur la prétendue stupidité des Québécois francophones. Il a connu la subtile ségrégation divisant les habitants de la banlieue vancouvéroise des communautés autochtones environnantes. Tout au long de la correspondance, le journaliste et romancier se confie aussi sur son père, un homme violent maudissant l’ignorance, voire la débilité des Autochtones comme des Québécois. Cela ne l’empêchait pourtant pas de les fréquenter, les uns autant que les autres.
Fontaine, pour sa part, n’a pas à faire appel à ses expériences personnelles pour démontrer le racisme vécu par les Autochtones. Elle adopte la voix d’un « nous » collectif touché par des événements qui ont abondamment fait les manchettes au cours des derniers mois ou des dernières années. Dans la foulée de la mort de Joyce Echaquan, des barrages ferroviaires érigés par les Wet’suwet’en, du moratoire anishinaabe sur la chasse à l’orignal dans la réserve faunique La Vérendrye, des conflits entre les pêcheurs de homard allochtones et mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse, des ajouts substantiels enrichissent d’ailleurs cette seconde édition de Kuei, je te salue.
Malheureusement, ces événements et les réactions qu’ils ont suscitées ne montrent pas beaucoup de progrès dans les rapports interculturels. Intimidation de groupe, insultes racistes, impuissance de la police : les acteurs se relaient, le scénario reste assez semblable. Des attitudes-réflexes rejaillissent durant les périodes troubles, des biais tellement tenaces qu’ils semblent ancrés au cœur de l’anthropos. Parmi celles-là subsistent les tendances à culturaliser des comportements individuels et à démoniser la différence pour en arriver à ne plus voir chez l’Autre que ce qui confirme (biais de confirmation) nos croyances les plus dépréciatives.
Comment s’y prendre, dans ce cas, pour tranquillement rebâtir les ponts ? Le message, pour ainsi dire, se trouve dans la forme : « La différence entre nous est minuscule et riche. Si on s’écoute, on ne peut que vivre plus pleinement dans ce monde », énonce à un moment Béchard en forme de souhait. « Lire est une façon d’écouter », ajoutera-t-il du même souffle. Si l’écoute devait commencer avec Petit traité sur le racisme et Kuei, je te salue, ce serait faire là, à coup sûr, deux pas de plus vers la plénitude.
1. Dany Laferrière, Petit traité sur le racisme, Boréal, Montréal, 2021, 224 p. ; 24,95 $.
2. Deni Ellis Béchard et Natasha Kanapé Fontaine, Kuei, je te salue. Conversation sur le racisme, Écosociété, Montréal, 2020 [2016], 208 p. ; 22 $.
EXTRAITS
Ne pas mettre tout le monde dans le même panier, qui était la base de toute réflexion, est devenu une rareté qui confine à l’originalité.
Petit traité sur le racisme, p. 10.
Une telle logique est toujours émouvante / venant souvent d’une personne / exempte de tout cynisme, mais qui / malheureusement a tort. / Elle dit : « Le racisme n’existe pas / la preuve, je ne suis pas raciste / et d’ailleurs personne de / mon entourage non plus. » / C’est toujours la dernière / à apprendre que / sa petite-fille a un amant.
Petit traité sur le racisme, p. 157.
Les médias ont tendance à nous montrer surtout ce qui est négatif chez les autres et cela nous incite à les percevoir comme un groupe, pas comme des individus. Si un Blanc commet un vol, je ne dis pas spontanément : « Les Blancs sont comme ça. Ils sont des voleurs ». Mais quand une personne faisant partie d’un groupe marginalisé fait un vol, on réagit tout de suite en affirmant : « Ils sont comme ça. Ce sont des voleurs ! » On efface toute la richesse de leur individualité.
Kuei, je te salue, p. 19.
Quant au racisme du côté autochtone, il consiste surtout à faire porter le blâme sur le « Blanc ». Lorsqu’on parle du Blanc, c’est l’image de celui qui est venu nous apporter le déséquilibre, la maladie et la misère qui est convoquée, car c’est le souvenir intergénérationnel qu’il nous a laissé, et c’est aussi le plus vif.
Kuei, je te salue, p. 132.










