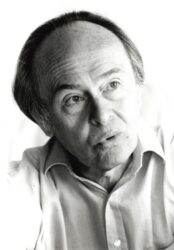Ce qu’il me faut dire immédiatement : Roland Bourneuf m’a enseigné, et tellement bien que je lui ai demandé, c’était en 1978, de diriger mes études de maîtrise, ce qu’il a accepté. Je le désigne volontiers comme mon maître, ainsi que les compagnons appelaient celui qui leur apprenait à travailler, de chantier en chantier. Si j’y tiens, en dépit de l’anachronisme, c’est qu’il favorisait l’expression de la sensibilité dans l’interprétation des œuvres, de préférence à l’application d’un cadre théorique (approche que je ne récuse pas et à laquelle je ne dédaigne pas d’emprunter, mais qui s’accordait moins à ma nature et à mes désirs). Aussi parce que l’image de ces artisans parcourant les routes convient à l’écrivain qui a si souvent traité de la route, du chemin, du parcours, ce dont témoignent les titres mêmes de certains de ses livres : Le chemin du retour, Venir en ce lieu, Le traversier, La route innombrable, Parcours, voyages, Sentiers, sources, Vieillir. Chemin de vérité. Rétrospectivement, j’ai l’impression que le pèlerin (étymologiquement lié au voyage) que je suis ne pouvait faire autrement que de croiser Roland Bourneuf en chemin. Les observations que voici, on l’aura compris, sont essentiellement tributaires de la subjectivité et de l’amitié, en écho à la critique partiale dont se réclamait Baudelaire dans Salon de 1846. Ce texte achevé, il restera tout à dire sur l’écrivain Bourneuf.
À ce stade-ci (trente livres, répartis sur une cinquantaine d’années), le commentateur se sent autorisé à suivre la… piste suggérée par les titres donnés plus tôt et à voir la réalisation du développement, de l’accomplissement lent, progressif, durable (ce qui ressortit à la vie intérieure) dans le motif du déplacement, rendu visible, concret par les lieux et les circonstances. Les images empruntées à l’espace aident à comprendre la ligne du temps. On traverse sa vie comme on déambule dans un paysage, sans toujours s’en apercevoir ; à l’inverse, on peut aussi devenir de plus en plus disponible au paysage, au point de le laisser s’immiscer et se dérouler en soi. N’est-ce pas l’une des formes que peut revêtir la conscience ?
Dans la fiction de Bourneuf, ce principe moteur se traduit par la présence de voyageurs et par des traversées de lieux, certes, mais aussi par l’usage abondant de la description, servie par un vocabulaire foisonnant. Les mots sont une fête ! L’auteur donne ainsi à voir. Il y a chez lui, j’en avais été frappé dans Reconnaissances, un attrait profond pour la matière, une attention fine aux formes matérielles. Peut-être est-ce dû au fait qu’il a beaucoup traité de l’art (son récent Le livre de Victor y revient) et, surtout, qu’il dessine et peint depuis longtemps. Considérons du moins qu’il y a chez lui convergence des deux modes d’expression : ses livres proposent une expérience de la lecture apparentée à l’arrêt que l’on s’autorise dans un musée devant une toile. Même invitation à la pause, aux antipodes d’une intrigue soutenue et de l’action menée tambour battant. D’un petit événement, par exemple la rencontre fortuite d’un vagabond dans Venir en ce lieu, il est possible de tirer une réflexion comme celle-ci, non loin d’être vertigineuse : « Sans doute médite-t-il sur la beauté du monde ». Précisons que la citation est extraite d’un essai et non d’une œuvre de fiction, ce qui induit habituellement une différence essentielle de registre. Frontière toutefois pour le moins ténue chez notre auteur. D’ailleurs, La route innombrable et L’ammonite sont chapeautés de la mention récit. L’invention des personnages s’opère dans ce à quoi ils pensent autant, sinon plus, que dans ce qu’ils font.
Les sentiers de la description
La description, revenons-y. On la cantonne souvent dans le statisme, comme si son emploi immobilisait le texte. Elle n’a pas ici un caractère décoratif. Elle participe activement à la composition (au sens pictural), à l’ordonnancement de la scène. J’ai fait état de personnages qui pensent et de leur réalisation (c’est-à-dire de la mise au réel de ce qui autrement resterait abstrait), de façon à ce que nous, lecteurs, les voyions. La description est la fusion d’un environnement (une rue, une impasse, l’horizon, un champ, une montagne, la mer, les pièces d’une maison, etc.) et de la perception que le narrateur en a. Le grand voyageur qu’a été Roland Bourneuf a sans doute rapporté beaucoup d’images de ses périples. J’ajouterais qu’il en a extrait tout autant de la rêverie et du rêve. Il en a tiré dans ses fictions brèves (Reconnaissances, Mémoires du demi-jour et Chronique des veilleurs) un caractère énigmatique, assez proche des mondes fragmentés de Marcel Béalu. Assez étrangement, pour peu que l’on ait rêvé, ce caractère déroutant est peut-être plus accessible qu’un tableau strictement réaliste. Autre paradoxe : si ces textes mènent parfois dans des endroits peu familiers à la plupart d’entre nous (avec une impression de confins suscitée par le désert ou la haute montagne, par exemple), même les plus casaniers sont en mesure de s’y retrouver, au nom justement de l’expérience intime de la trajectoire, tantôt progression, tantôt stagnation.
À cet égard, il importe de signaler que le chapitre consacré à l’espace, dans L’univers du roman (coécrit avec son collègue Réal Ouellet), a longtemps fait autorité en la matière, la plupart des ouvrages sur l’analyse du récit s’étant jusque-là orientés davantage vers l’étude du temps, des personnages, de l’intrigue et des mécanismes narratifs. Cette rencontre du théoricien (si peu ! dirait-il sans doute), du critique (Lectures à tous vents. Chroniques littéraires), de l’essayiste (j’ai un faible pour Venir en ce lieu), du nouvelliste (cinq recueils) et du romancier (Le chemin du retour, au premier chef) est éloquente en soi : quel que soit le genre retenu, Roland Bourneuf s’intéresse au monde sensible, si je peux désigner par cet adjectif ce qui stimule la sensation.
Enracinement et mouvement
Matière et déplacement : ces éléments peuvent paraître opposés, comme la masse et la vitesse. C’est ici qu’intervient la littérature, c’est-à-dire l’appropriation du réel et sa transformation par le langage. Encore faut-il considérer que le réel bourneuvien se situe en partie dans une sorte d’extension de ce qui est communément admis (si tant est que ceci puisse être circonscrit…), que ce soit dans une texture onirique ou par la souveraineté de la métaphore, la grande figure de l’ouverture, justement. Dans les fictions brèves, il n’est pas rare que l’on soit d’office plongé, en perte de repères, dans un monde inconnu et pourtant vaguement reconnaissable, en écho à un mythe (au sens fort, à titre de récit ancien et fondateur que la culture garde en latence). Ainsi, ce que je sais du désert ne relève pas de l’expérience, mais d’impressions accumulées au fil des lectures en vertu desquelles le sable n’en est pas le fin mot : il dissimule des strates de récits de soif, de purification, d’éblouissement, d’où des aventuriers avec ou sans scrupules, des ermites et des mystiques émaciés peuvent jaillir et occuper le centre du texte. Les auteurs proposent ; les lecteurs disposent. Quelques mots suffisent. Même chose en ce qui a trait à une cellule (mot qui renvoie aussi bien à l’incarcération pénale qu’au recueillement monastique). Que ces deux cas évoquent le Bildungsroman n’est pas fortuit. J’y reviendrai.
Ce principe de réitération vaut aussi, sur un mode allégé, dans Le livre de Victor : le protagoniste se retrouve avec un groupe de peintres comme dans une nouvelle de Maupassant, une toile de Renoir ou une scène qui se serait déroulée à Pont-Aven. Bourneuf n’est pas le fruit de la génération spontanée ; il se situe plutôt tout près du titre d’un essai de Julien Gracq, écrivain qu’il a en haute estime, En lisant en écrivant. L’auteur a d’abord été lecteur. Et l’est resté, comme en atteste Lectures à tous vents.
Que d’autres se vantent des pages qu’ils ont écrites ;
Moi je suis fier de celles que j’ai lues.
Jorge Luis Borges, L’or des tigres.
L’inversion des rôles
Après avoir été son étudiant, je suis devenu l’éditeur de Roland. Commençait alors un nouveau chapitre de notre connivence. De Mémoires du demi-jour à L’étranger dans la montagne, onze de ses livres, nouvelles, romans, essais ont paru à l’enseigne de L’instant même. Étrange et intimidant retournement de situation.
Je ne résiste pas au plaisir de raconter l’anecdote suivante : quand j’ai apporté à Monsieur Bourneuf (à l’époque, nous nous vouvoyions) ce qui allait devenir un chapitre de mon mémoire de maîtrise (sur les rapports entre peinture et littérature, inutile de le taire), il m’a d’abord signalé (ce n’était pas un reproche) l’abondance (il n’a pas parlé de surabondance) de gérondifs, de participes présents et d’adverbes, d’où la prolifération du son an. Il n’avait évidemment gardé aucun souvenir de l’incident et il s’est montré gêné quand je le lui ai rappelé. Vous aurez compris que je l’ai fait avec gratitude : qui d’autre que Roland (nous nous tutoyons depuis longtemps…) m’aurait appris à me soucier de l’écriture, de la prosodie, de la sonorité (et je ne dis rien de la syntaxe), même dans un exercice scolaire ?
C’est ainsi que pendant une quinzaine d’années, j’aurai lu les textes de Roland, fait des annotations, participé à la phase qui d’un manuscrit fait un livre. J’aurai été aux premières loges de ce que je ne saurais appeler autrement que son style naturel. Combien de fois, lors de nos séances de travail, ne me suis-je pas arrêté au-dessus d’une phrase limpide et belle ! L’orfèvre était tout surpris, car chez lui la phrase coule de source. Puisse cela justifier que je me glisse aujourd’hui partout dans ce texte sur lui : l’éloge vient de quelqu’un qui se bat constamment avec le français, sa seule langue pourtant, compliment que je lui ai fait avec envie, sans jalousie.
L’expérience esthétique peut amener le débordement de la sensation dans l’émotion. Cet énoncé s’applique dans son cas, pour peu que les lecteurs se placent en quelque sorte dans la position des personnages, eux-mêmes un peu en retrait, avec une certaine pudeur (la leur et celle de l’écrivain). On n’est pas dans le registre de l’effusion ou de l’épanchement. La patience plutôt que l’emportement ; la joie sereine plutôt que l’enthousiasme ; la tristesse plutôt que la mélancolie. Tout pourrait appeler à la nostalgie, mais une sorte de stoïcisme prévaut. Telle est la vertu de la description.
Un certain Victor
Arrive en 2024 un certain Victor dans un cadre initial, à savoir la Seconde Guerre, connu par l’Auvergnat Bourneuf qui, pendant son enfance, a vécu l’Occupation et les privations. L’on n’est pourtant pas tenté de voir en Victor un avatar, une projection autobiographique de l’auteur. (Tout le monde a maintenant compris que l’on est ici dans un ethos aux antipodes de ceux pour qui écrire exige que l’on mette ses tripes sur la table.) Un homme éteint s’allume en ne forçant rien, en laissant venir les choses. La forme (des sculptures pour lui, un récit pour nous) jaillit à partir de la matière même, de son propre aveu. L’impression que le propos convient à l’écrivain autant qu’à son personnage se confirme à la fin : l’épilogue exprime ce que l’on a ressenti, à savoir un récit qui rattrape l’homme Bourneuf, c’est-à-dire le créateur, à ce moment-ci de sa vie.
Peut-être Lectures à tous vents et Le livre de Victor constituent-ils une rétrospective ? Du moins ils sont certainement tributaires d’un vaste mouvement circulaire par lequel le lecteur Bourneuf a repris la parole. Comment ne pas évoquer ici la figure d’Hermann Hesse et le Bildungsroman austro-allemand (le roman d’éducation, de formation, d’apprentissage) d’il y a un siècle ? Le héros se lance dans la quête de soi, mais à petits pas, et s’il parvient peu à peu à la maturité, c’est sans battre la semelle ni courir le vaste monde.
Roland a beaucoup lu et beaucoup écrit. Il se dégage une forme d’apaisement à le lire aujourd’hui, à ajouter ses livres à un chapitre apocryphe de Lectures à tous vents dont nous serions les auteurs et qui pourrait s’intituler « Sans doute médite-t-il sur la beauté du monde ». C’est aussi remonter le chemin qui ramène aux écrivains qui l’ont accompagné çà et là dans sa vie, et dont il a fait des amis. C’est peut-être là, essentiellement, qu’est le chemin du retour.
Livres de Roland Bourneuf mentionnés dans l’article :
Reconnaissances. Récits, Parallèles, Sainte-Foy (Québec), 1981, 100 p.
Mémoires du demi-jour, L’instant même, Québec, 1990, 152 p.
Chronique des veilleurs, L’instant même, Québec, 1993, 108 p.
Le chemin du retour, L’instant même, Québec, 1996, 238 p.
Venir en ce lieu, L’instant même, Québec, 1997, 208 p.
Le traversier, L’instant même, Québec, 2000, 141 p.
La route innombrable, L’instant même, Québec, 2003, 168 p.
L’étranger dans la montagne, L’instant même, Québec, 2017, 152 p.
Sentiers, sources. Carnets 1999-2008, Nota bene, Montréal, 2019, 342 p.
Vieillir. Chemin de vérité, Médiaspaul, Montréal, 2020, 128 p.
Lectures à tous vents. Chroniques littéraires, Éditions 8, Québec, 2022, 396 p.
Le livre de Victor, Éditions 8, Québec, 2024, 129 p.
Avec Réal Ouellet : L’univers du roman, PUF, Paris, 1972, 232 p.
Avec Lyse Charuest : Parcours, voyages, hors commerce, 2014.
EXTRAITS
Sans brusquerie, avec douceur mais fermeté, le sentier appelle à un exercice de lenteur, d’attention, d’amour. Comme il devrait en être pour la lecture, pour l’écriture, pour le geste quotidien, pour la pensée. Pour l’existence tout entière.
Venir en ce lieu, p. 19.
Dès les premiers instants de notre vie, en même temps que des visages et des présences, nous reçoivent une chambre, une maison, d’autres maisons au long d’une rue ou d’une route, une ville peut-être, des arbres, un paysage. Nous y entrons peu à peu, pour en faire nos amis. Par le regard, par tous nos sens, nous parcourons un décor, nous en traverserons de nouveaux, innombrables.
Venir en ce lieu, p. 9.
Nous sentons, reconnaissons le sol sous nos pas, et c’est bon mais nous voudrions être ailleurs.
Venir en ce lieu, p. 9.
Bien entendu j’observais particulièrement les différentes essences d’arbres. Les troncs très droits et vigoureux ou gênés dans leur croissance par un obstacle qu’ils avaient réussi à surmonter, qui présentaient des nœuds, des embranchements complexes. Parfois des souches qui avaient été des arbres n’ayant pas résisté à un vent trop fort, renversés, culbutés, arrachés, qui enserraient encore des mottes de terre noire, ouvrant un sous-sol étrange, vaguement inquiétant.
Le livre de Victor, p. 39.
La jeune femme ne vint pas à la conférence suivante. Alors l’imagination de Kléber se mit à galoper. Il lui prêtait des noms, lui inventait un passé.
Chronique des veilleurs, p. 53.
[…] ces places entre ciel et terre qu’il affectionnait.
Chronique des veilleurs, p. 49.
Un été, la guerre est venue par cette route. Des soldats en kaki fuyant parmi des civils épuisés, affamés, traqués. Puis des soldats en gris. Quelque chose d’énorme, d’incompréhensible, d’effrayant, qui s’étendait sur nous et qui, pendant des années, nous étoufferait.
Venir en ce lieu, p. 13.
Je n’étais pas prêt à rencontrer l’ombre.
Venir en ce lieu, p. 15.
[Passage sur les romanos] : […] et j’entendais dans ce terme la méfiance, l’hostilité, le mépris et la peur des petites gens autour de moi répétant que « pierre qui roule n’amasse pas mousse », leur inattaquable règle d’or.
Venir en ce lieu, p. 15.
Peut-être pour moi, enfant, le rêve de faire de grandes choses se confondait-il avec celui de voir de l’extraordinaire qui ne pouvait provenir que d’ailleurs, au bout de la route.
Venir en ce lieu, p. 16.
[À propos de Jaccottet] : […] sinon comprendre, du moins interroger le monde.
Lectures à tous vents, p. 89.
[…] je sais bien que j’invente autant que je me remémore […].
Le chemin du retour, p. 75.
Ma vocation, je la vois volontiers comme celle du solitaire – mais les explorateurs n’en sont-ils pas ? Même si l’école, la caserne, la capitale, puis la guerre, le camp de prisonniers et bien d’autres circonstances de ma vie m’ont mis en contact avec une foule de gens, ce fut rarement un choix. Plutôt une fatalité.
Le chemin du retour, p. 82.
[…] je voulais parler de ces années-là. Raconter, ramener au jour, explorer, interroger, peut-être conjurer, me défaire, me dégager. Tout à la fois et indistinctement. C’est fait.
Le chemin du retour, p. 186.
Je crois être parvenu à ce que j’ai si longtemps souhaité, du moins à être allé dans cette direction. À me rapprocher de moi-même.
Le chemin du retour, p. 238.
Il m’a fallu beaucoup de temps pour en arriver là. J’ai dépensé beaucoup de forces pour établir ce jardin. Je me souviens à peine des années où j’ai entrepris le voyage qui m’y a conduit. Je sais qu’il y eut les villes pleines de brouillards et d’yeux qui s’allumaient la nuit.
Reconnaissances, p. 22.