Le canevas est aussi simple que souple : un homme – ou une femme – revient chez lui après un long détour. Il prend la mesure des changements survenus durant son absence. Le décalage entre passé et présent le remue, au point de parfois lui faire revivre une sorte de second exil.
Depuis son retour à Ithaque, Ulysse a engendré une généreuse descendance. À moins que ce ne soit le fils prodigue de la parabole biblique. Ou Césaire poursuivant, par-delà le bout du petit matin, son souvenir de la Martinique. Quelle que soit, en fait, l’influence revendiquée, l’engouement littéraire pour le retour au pays natal ne se dément toujours pas. À partir de ce topos, une infinité de trames, de thèmes, de lieux, de couleurs ont été brodés. Ses possibles sont d’ailleurs assez vastes pour rapprocher des œuvres que les ambitions stylistiques et les préoccupations sociopolitiques soustrairaient d’emblée à l’exercice comparatif.
Une maison faite d’aube1, de Navarre Scott Momaday, est le récit erratique d’un homme culturellement aliéné, happé par le désenchantement spirituel. En récoltant le Pulitzer en 1969, l’auteur kiowa annonce le mouvement de renaissance autochtone aux États-Unis, l’aube d’une parole forte et rayonnante. Ohio2, de Stephen Markley, a obtenu le Grand Prix de Littérature américaine 2020. Sous son titre lapidaire se cache l’ambitieuse fresque sociale d’un romancier virtuose, le portrait triste et sombre d’une jeunesse sacrifiée sur l’autel des années W. Bush. À première vue, tout les éloigne. Tout, hormis les tribulations du revenant.
Le retour de l’Autochtone
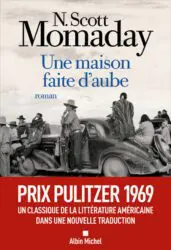 Dans The Truth about Stories (2003), le formidable écrivain et essayiste qu’est Thomas King proposait une brève lecture d’Une maison faite d’aube, œuvre inaugurant, selon lui, l’entrée dans la modernité de la littérature autochtone. Il y observait déjà une singulière préoccupation pour le motif narratif du « return of the native », un motif que lui-même a plus d’une fois exploité, et avec brio, dans sa foisonnante production romanesque.
Dans The Truth about Stories (2003), le formidable écrivain et essayiste qu’est Thomas King proposait une brève lecture d’Une maison faite d’aube, œuvre inaugurant, selon lui, l’entrée dans la modernité de la littérature autochtone. Il y observait déjà une singulière préoccupation pour le motif narratif du « return of the native », un motif que lui-même a plus d’une fois exploité, et avec brio, dans sa foisonnante production romanesque.
Au centre du classique de Momaday, immense peintre du territoire pueblo, de ses mesas desséchées par la chaleur crématoire du Sud, de ses cabanes d’adobe figées dans l’air brûlant, au milieu de ces descriptions photographiques donc, piétine, torpide, le personnage d’Abel, petit-fils de Francisco, tout juste revenu du front de la Deuxième Guerre où il a laissé sang, sueur et santé mentale.
Abel traîne avec lui le poids de ses origines bibliques. Le chantre des paysages brûlés qu’est Momaday bricole cependant la fable évangélique, de sorte que le vétéran est ici porteur de la violence et de la différenciation primordiales et non leur victime. Par une nuit saturée d’ivresse, celui-ci tue en effet de sang-froid, sans raisons apparentes, non plus que de regrets : « Il avait tué l’homme blanc. Ce n’était pas compliqué, après tout ; c’était même très simple. C’était la chose la plus naturelle du monde. Ils pouvaient certainement le comprendre, ces hommes qui se débarrassaient de lui avec leurs discours. Ils devaient bien se douter que, si c’était à refaire, il le tuerait encore sans la moindre hésitation ».
Débute alors pour lui une période de réclusion suivie d’errances, tandis que s’amorce en parallèle l’examen, comme l’avait fort justement relevé King, de la conception manichéenne du bien et du mal. Car du simple fait qu’Abel ait participé aux boucheries de la guerre, ce dont le roman rend compte de manière impressionniste, et qu’il soit condamné pour le meurtre d’un seul homme, les notions de bien et de mal se gondolent comme des vérités qui prennent l’eau. Elles seront remises en question par cet autre épisode, tiré du passé celui-là, dans lequel une horde de soldats massacrent les troupeaux des Kiowas en les évinçant de leurs terres.
Le bien, suggère le romancier à travers digressions et ellipses, se situe d’abord du côté de celui qui bénéficie de la parole, qui détient le pouvoir du Verbe et se trouve conséquemment en position de décréter ce qui est bien. Abel traverse d’ailleurs son quotidien en encaissant les revers sans mot dire, muré dans un mutisme impénétrable et étouffant. Sa souffrance, par une étrange alchimie du silence, en devient plus criante.
On chercherait en vain chez Momaday une progression dramatique linéaire, nettement définie. Entremêlant cérémonies liturgiques, récits mythiques et histoires familiales au présent de la narration, le romancier crée plutôt du sens par accumulations, associations ou oppositions d’images, de symboles et de personnages. Cela n’empêche pas Abel, après une longue dérive dans la cité des anges au terme de laquelle il se brûle les ailes, de revenir une fois de plus au pueblo afin de veiller son grand-père. Et de se rapprocher de cette maison faite d’aube tirée d’un chant de guérison navajo, qui évoque une sorte d’éveil au sacré, une volonté nouvelle de réinvestir la culture pueblo et d’« habiter » la parole des anciens. Une rédemption, moins mise en scène que suggérée, qui sera, pour les revenants d’Ohio, hors de portée.
Les promesses déçues de New Canaan
 « On est de son enfance comme on est d’un pays », écrivait Saint-Exupéry. De son adolescence également, pourrait-on renchérir. L’univers du lycée, avec tout ce qu’il comporte de systèmes de cliques complexes et de cruelles stratifications, est un trope dominant de l’imaginaire américain des dernières décennies. Des films comme Rebel Without a Cause, American Graffiti ou Dazed and Confused ont sans aucun doute contribué pour beaucoup à son façonnement et à sa popularisation. Bénie pour certains, honnie pour d’autres, cette époque n’en demeure pas moins une période formatrice. Elle édifie quelques-uns des totems de la mémoire sur lesquels se fondent les mythologies personnelles. Pour le meilleur et pour le pire.
« On est de son enfance comme on est d’un pays », écrivait Saint-Exupéry. De son adolescence également, pourrait-on renchérir. L’univers du lycée, avec tout ce qu’il comporte de systèmes de cliques complexes et de cruelles stratifications, est un trope dominant de l’imaginaire américain des dernières décennies. Des films comme Rebel Without a Cause, American Graffiti ou Dazed and Confused ont sans aucun doute contribué pour beaucoup à son façonnement et à sa popularisation. Bénie pour certains, honnie pour d’autres, cette époque n’en demeure pas moins une période formatrice. Elle édifie quelques-uns des totems de la mémoire sur lesquels se fondent les mythologies personnelles. Pour le meilleur et pour le pire.
Dans Ohio, un premier roman brillantissime, Stephen Markley soupèse ce qu’il reste de cette mythologie juvénile un coup passée la patine du temps, une fois encaissées les conséquences de mauvais coups de barre ou de tragédies qu’immanquablement la vie balance au visage de tous. Par l’intermédiaire d’une poignée de personnages rassemblés autour d’un agencement choral, le pays natal reprend ainsi vie dans toute la complexité des réalités intimes qu’il renferme en son sein, comme autant de secrets bien gardés.
Le pays natal, dans ce cas-ci, c’est New Canaan, une banlieue fictive nichée dans l’Ohio moyen. Si le toponyme brasse quelques réminiscences bibliques, celles-ci s’estompent aussitôt que Bill Aschraft, un toxicomane à ses heures recyclé en mule le temps d’une livraison, refranchit le seuil de son « berceau de rouille et de maïs » : « [Q]uand on entrait en titubant par la SR 229, la banlieue de New Canaan apparaissait comme un condensé de tout le mal-être du Midwest. Cette maigre zone commerciale avait perdu tous ses panneaux, on n’y voyait plus que les silhouettes spectrales d’activités disparues et les petites traces de rouille aux endroits où des vis plongeaient naguère dans le stuc. La suite du chemin était marquée par toutes les tumeurs habituelles. Maisons avec un panneau À VENDRE. Maisons avec un panneau SAISIE. Le reste à louer et manifestement pas loué ».
La crise des subprimes a passé ses griffes dans le paysage de l’Amérique périurbaine. En même temps qu’Ashcraft, le même jour que lui, reviendront pour le constater Stacey Moore, doctorante en littérature, Dan Eaton, un militaire éborgné lors d’une mission en Irak, et Tina Ross, une reine de beauté qu’un drame lointain a prématurément étiolée. Tous ces fils et filles de New Ca, en y revenant, replongent dans leurs anciennes amours, dans leurs souvenirs du lycée, revisitent les fantômes, bourgeois, gothiques ou sportifs, qui en hantent les couloirs. Ces allers-retours d’une nostalgie féconde entre présent et passé établissent progressivement la radioscopie d’une génération dont les rêves et les ambitions ont été fauchés en plein vol par les guerres d’Irak et d’Afghanistan, la crise des opioïdes et le krach financier de 2008.
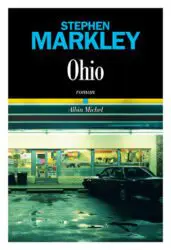 Markley pose en parallèle un regard aiguisé sur les profondes divisions qui opposent ses compatriotes, sur leurs contradictions internes et les hypocrisies pudibondes qui dictent certains de leurs comportements. Malgré la menace de l’enfer qui pèse sur eux, par exemple, des adolescents abonnés aux bondieuseries dominicales s’échangent des caresses animales sous la ligature électrique des étoiles ou le plafonnier du sous-sol familial. Bercées par les mêmes idées étroites, des personnes combattent toute leur vie les antagonismes déchirants de la double contrainte.
Markley pose en parallèle un regard aiguisé sur les profondes divisions qui opposent ses compatriotes, sur leurs contradictions internes et les hypocrisies pudibondes qui dictent certains de leurs comportements. Malgré la menace de l’enfer qui pèse sur eux, par exemple, des adolescents abonnés aux bondieuseries dominicales s’échangent des caresses animales sous la ligature électrique des étoiles ou le plafonnier du sous-sol familial. Bercées par les mêmes idées étroites, des personnes combattent toute leur vie les antagonismes déchirants de la double contrainte.
Cette nouvelle Canaan américaine, cette terre promise de la seconde chance, Markley en souligne donc allègrement les échecs et la faillite des idéaux. Ajoutez à sa critique sociale une intrigue inspirée de cette légende urbaine du « meurtre qui n’a jamais existé », une écriture électrisante et des passages ponctués d’envolées lysergiques, et vous obtenez une réussite retentissante. Ohio est fait de cette même étoffe que les meilleurs romans générationnels signés Bret Easton Ellis ou Douglas Coupland. C’est un morceau d’americana vermoulu, où le passé est une étoile morte qui éclaire de sa lumière blafarde un présent condamné.
Ni Momaday ni Markley ne débordent d’ailleurs d’optimisme. C’est que les histoires de revenants sont bien souvent le récit d’une désillusion par rapport à ce qui aurait pu être et d’une résignation face à ce qui est. Revenir de loin pour constater qu’on ne va nulle part, en somme. L’existence comme un abysse, mais un abysse sacré. Cela n’offre pas beaucoup d’espoir, mais cela donne des moments littéraires vibrants de beauté.
1. Navarre Scott Momaday, Une maison faite d’aube, trad. de l’américain par Joëlle Rostkowski, Albin Michel, « Terres d’Amérique », Paris, 2020, 280 p. ; 32,95 $.
2. Stephen Markley, Ohio, de l’américain par Charles Recoursé, Albin Michel, « Terres d’Amérique », Paris, 2020, 550 p. ; 34,95 $.
EXTRAITS
Il entendit le violent grincement des freins de l’autocar qui venait de s’immobiliser lourdement devant la station d’essence, et c’est seulement à ce moment-là qu’il prêta attention à son arrivée, comme s’il en était surpris. La portière s’ouvrit brusquement et Abel descendit d’un pas lourd et titubant. Il était ivre et s’effondra dans les bras de son grand-père sans le reconnaître.
Scott Momaday, Une maison faite d’aube, p. 28.
Il vit le canyon, les montagnes et le ciel. Il vit la pluie, la rivière et les champs au-delà. Il vit les collines sombres à l’aube. […] Nul son ne se faisait entendre et lui-même n’avait pas de voix. Seulement les paroles d’un chant. Et il continua de courir, porté par le chant. Une maison faite de pollen, une maison faite d’aube.Qtsedaba.
Scott Momaday, Une maison faite d’aube, p. 276.
Nous entretenons avec le ciel de l’endroit où nous avons vu le jour une intimité qui dépasse le mouvement des nuages ou le clignotement des étoiles. Le ciel au-dessus de chez nous s’apparente au moment où le parachutiste tire sur la corde et est aspiré vers l’éther. Nous aurons beau courir le monde et assister à des couchers de soleil, des aurores ou des tempêtes plus spectaculaires, lorsque nous apercevons ces champs, ces forêts, ces buttes et ces rivières ancrés dans notre mémoire, notre mâchoire se serre. La corde tirée nous arrache à la chute.
Stephen Markley, Ohio, p. 292.
Le néant, c’est visionner la totalité du temps dans un sens et dans l’autre, la voix piégée pour toujours dans toute cette poussière, cet effondrement, cette peine sans fond. Mais ce que vous ne saurez jamais, ce que vous n’auriez jamais pu croire ni espérer croire pendant le long voyage époustouflant qui vous ramène chez vous, c’est que cet abysse est malgré tout sacré. Vous comprenez que tout, même le vide, est éphémère, que le rien est instable et tend, galope presque, vers une création nouvelle sur des terres étrangères.
Stephen Markley, Ohio, p. 536.











