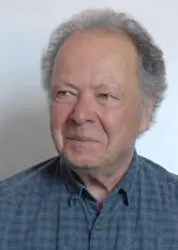Depuis 2008 et la parution en livre des chroniques qu’il tenait dans le journal l’Acadie nouvelle, David Lonergan multiplie les titres qui nous font connaître le milieu culturel acadien et la littérature acadienne.
Sont parus une anthologie de textes littéraires acadiens en 2010 sous le titre Paroles d’Acadie, puis en 2013, un ouvrage incontournable permettant de comprendre l’évolution de l’institution littéraire acadienne et dont le titre évoque l’année qui marqua son développement, Acadie 72. Naissance de la modernité acadienne, et, en 2015, une histoire du théâtre l’Escaouette de Moncton, simplement intitulé Théâtre l’Escaouette. 1977-2012. En 2018, une nouvelle brique s’est ajoutée à ce monument commérant la littérature et la culture acadiennes, Regard sur la littérature acadienne1. Cette histoire de la littérature acadienne de 1972 à 2012 fait suite à celle publiée par Marguerite Maillet en 1983. Trente-cinq ans séparent les deux ouvrages, mais l’esprit qui anime les auteurs est le même : rendre hommage et donner une plus grande visibilité aux œuvres de l’Acadie des Maritimes. La continuité est apparente dès le titre de l’ouvrage : « Regards sur la littérature acadienne depuis 1958 » était le titre de la courte partie que Marguerite Maillet a ajoutée à sa thèse de doctorat lors de sa publication en livre. Beaucoup moins étoffée que les autres parties, puisqu’elle ne comptait que vingt pages, cette section ouvrait une porte sur une période de la littérature acadienne mais sans vraiment entrer dans le vif du sujet. Lonergan poursuit donc l’œuvre de la célèbre critique, éditrice et professeure acadienne tout en y laissant la marque de son propre style de journaliste chroniqueur.
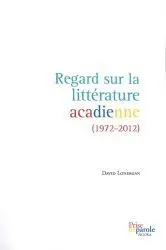 Le livre est divisé en quatre parties qui présentent chacune les ouvrages parus au cours de la période couverte en fonction des genres littéraires : la poésie, le roman (y compris la nouvelle et le conte), la littérature jeunesse et le théâtre. Les œuvres de chaque auteur sont regroupées en une notice. L’ordre privilégié est certes celui de la date de publication des livres, mais il est subordonné à une organisation par auteurs. Ainsi, les ouvrages d’Herménégilde Chiasson, pour prendre cet exemple, se retrouvent dans chacune des sections, son nom apparaissant à la date de parution de son premier livre durant la période couverte. Cette organisation est très efficace, car elle permet à l’amateur comme au chercheur d’avoir une vue globale de la production d’un écrivain ou d’une écrivaine à une époque donnée. Une lecture de l’ensemble des passages consacrés au même auteur donne elle une vision globale de l’œuvre.
Le livre est divisé en quatre parties qui présentent chacune les ouvrages parus au cours de la période couverte en fonction des genres littéraires : la poésie, le roman (y compris la nouvelle et le conte), la littérature jeunesse et le théâtre. Les œuvres de chaque auteur sont regroupées en une notice. L’ordre privilégié est certes celui de la date de publication des livres, mais il est subordonné à une organisation par auteurs. Ainsi, les ouvrages d’Herménégilde Chiasson, pour prendre cet exemple, se retrouvent dans chacune des sections, son nom apparaissant à la date de parution de son premier livre durant la période couverte. Cette organisation est très efficace, car elle permet à l’amateur comme au chercheur d’avoir une vue globale de la production d’un écrivain ou d’une écrivaine à une époque donnée. Une lecture de l’ensemble des passages consacrés au même auteur donne elle une vision globale de l’œuvre.
La périodisation choisie par Lonergan est efficace et rend bien compte des moments marquants de la littérature acadienne. La première couvre les débuts de 1972 à 1978, soit de la fondation des éditions d’Acadie à la parution de L’Acadie perdue de Michel Roy. Lonergan contextualise cependant la naissance de la littérature acadienne contemporaine en signalant les événements déterminants des années 1960 qui ont permis son avènement. Intitulée « Un cri de terre en Acadie », cette section met l’accent sur la prise de parole d’une nouvelle génération d’écrivains qui revendiquent pleinement leur identité acadienne. La deuxième période, « L’Acadie à l’heure de la parole », va de 1978 à 1991 et la troisième, « Diversification de la prise de parole », de 1991 à 2000. Toutes deux sont marquées par des événements politiques importants dont la création au début des années 1990 d’un parti politique anti-Acadiens, le Confederatrion of Regions Party (CoR), de sa disparition en 1995 et de l’élection des progressistes-conservateurs de Bernard Lord en 1999, premier ministre de père anglophone et de mère acadienne. L’année 2000, c’est surtout la fin des éditions d’Acadie, qui font faillite. Enfin, la dernière partie couvre la période qui s’étend de 2000 à 2012. Intitulée « Réorganisation et diffusion », elle rend compte de la diversité de la littérature acadienne depuis le début du millénaire.
Les introductions aux quatre sections sont très informatives et permettent de voir le lien qui unit le contexte social, le monde de la culture en général et le milieu littéraire. Les rubriques consacrées aux auteurs fournissent une courte notice biographique de l’auteur ou de l’autrice, un résumé de chacune des œuvres publiées et un jugement. C’est là que le style de journaliste culturel de Lonergan transparaît le plus. Il met judicieusement à profit sa capacité de rendre compte d’un livre en quelques mots bien sentis. C’est là aussi que l’on voit le mieux sa vaste connaissance de la littérature acadienne. Il est clair que Lonergan a tout lu et qu’il connaît de près les œuvres dont il parle, et souvent aussi les auteurs. Les jugements parfois durs et sans complaisance côtoient des éloges un peu trop dithyrambiques. Il n’en demeure pas moins que ces commentaires dressent un portrait le plus souvent objectif, et respectueux, de cette littérature qui mérite d’être mieux connue. Tous les auteurs majeurs et un bon nombre d’auteurs dont les œuvres sont moins importantes en nombre ou en qualité sont présentés.
La conclusion de l’ouvrage nous laisse un peu sur notre faim, car il n’y a pas là de véritable synthèse de l’histoire littéraire acadienne, ni d’ouverture sur l’avenir. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une étude tout à fait incontournable pour quiconque – lecteur ou chercheur – s’intéresse à la littérature acadienne. Les enseignants comme les professeurs universitaires y trouveront un outil d’une grande utilité pour choisir les œuvres à enseigner dans leurs cours. Espérons que David Lonergan poursuivra l’érection de son monument en hommage à la culture et à la littérature acadiennes, car chaque livre nous en apprend davantage sur l’Acadie et sa littérature.
1. David Lonergan, Regard sur la littérature acadienne (1972-2012), Prise de parole, Sudbury, 2018, 388 p. ; 34,95 $.
EXTRAITS
Regard sur la littérature acadienne (1972-2012) est le premier ouvrage à se pencher sur l’ensemble des œuvres littéraires acadiennes publiées dans les quarante ans qui ont suivi la fondation des Éditions d’Acadie en 1972.
Quatrième de couverture.
À la fin des années 1960, l’Acadie voit émerger des écrivains qui veulent faire œuvre en Acadie, mais qui n’ont alors d’autre choix que d’être publiés au Québec, comme le sont Ronald Després et Antonine Maillet. Ceux-ci serviront de points de repère à la génération des années 1970. Certains écrivains ont d’ailleurs publié en 1969 dans le numéro de Liberté – la plus importante revue littéraire québécoise de l’époque –, consacré à l’Acadie. Mais ils sont réticents à soumettre leurs manuscrits aux maisons d’édition québécoises.
p. 17
Créées en 1972 par des professeurs de l’Université de Moncton regroupés autour de Melvin Gallant, les Éditions d’Acadie deviennent le catalyseur d’une prise de parole qui avait débuté quelques années auparavant, mais qui ne bénéficiait pas de véritable diffusion, autre que dans des dossiers de revues (en particulier ceux de Liberté en 1969 et de la Revue de l’Université de Moncton en 1972) et lors de soirées de poésie. La première génération de poètes s’y retrouvera au complet.
p.19
Les quatre premiers recueils de poésie que publient les Éditions d’Acadie forment le quatuor fondamental de la poésie acadienne : Cri de terre (1972) de Raymond Guy LeBlanc, Saisons antérieures (1973) de Léonard Forest, Acadie Rock (1973) de Guy Arsenault et Mourir à Scoudouc (1974) d’Herménégilde Chiasson. C’est à travers eux qu’on regardera le passé, c’est à partir d’eux que l’on inventera l’avenir.
p.19
Gérald Leblanc publie son premier recueil, Comme un otage du quotidien, chez Perce-Neige en 1981, un choix logique pour lui qui siège au conseil d’administration de la jeune maison. Il est déjà connu comme étant le principal parolier du groupe de folk-rock 1755, alors au sommet de sa popularité. Il lit ses poèmes dans des soirées littéraires depuis plusieurs années et a fait paraître quelques textes incisifs et parfois vulgaires en 1976, dans le premier et unique numéro de la revue Emma, dirigée par les Éditions d’Acadie.
p. 60
Le milieu culturel s’organise : fondée en avril 1979, l’Association des écrivains acadiens, dont Melvin Gallant est l’un des principaux animateurs, crée en 1980 la revue littéraire de création Éloizes et fonde les Éditions Perce-Neige. Le conseil d’administration de Perce-Neige est formé d’écrivains impliqués dans l’Association ; Melvin Gallant en assume la présidence et Gérald Leblanc, la vice-présidence. En l’espace d’une décennie surgit un mouvement culturel structuré, novateur et bien appuyé par la population, à défaut de l’être par le gouvernement provincial.
p. 55
À la même époque, la publication de L’anti-livre aux éditions appelées, à juste titre, « l’Étoile magannée », est en soi symbolique de la situation de l’édition et du désir de publier des jeunes créateurs acadiens. Lancé le 11 septembre 1972 à l’Université de Moncton, « l’objet », réalisé par Herménégilde Chiasson (dessins, graphisme) et par les frères Jacques (poèmes) et Gilles Savoie (photos), est intrigant : une boîte en gros carton illustrée remplie de foin (constat dérisoire sur l’état de la « culture » en Acadie) et, emballés dans de la Cellophane, des textes, illustrations et photographies sur des feuilles mobiles, un mélange de photocopies, de gravures et de tirages argentiques.
p. 18