Nul ne contestera à Henry Kissinger l’ampleur de ses vues et la surabondance des confidences auxquelles il peut puiser. Quand s’ajoutent à ces atouts un sens aigu de la mise en scène et une compacte assurance de ton, on peut assumer un grand destin. Par conséquent, nombreux sont forcément les États et les conglomérats prêts à solliciter et à rémunérer ses conseils. Cette situation n’amplifiera cependant la crédibilité de Kissinger que si le spécialiste ne dissimule rien de ses activités. Cette condition ne fut jamais satisfaite et ce n’est pas à présent qu’il commencera à payer tribut à la transparence.
L’ordre du monde1, le plus récent des ouvrages de Kissinger, réduit quelque peu la zone d’équivoque, mais pas de la plus heureuse façon. L’auteur s’exprime, en effet, comme si strictement aucun contrat n’influait sur son jugement, mais c’est pour endosser les gestes et la politique des États-Unis plus massivement que jamais. Quand tout paraît digne de louanges dans l’interventionnisme étatsunien aux quatre coins du monde, il importe assez peu de savoir si, par ailleurs, l’ex-secrétaire d’État de Washington agit comme conseiller de l’Arabie saoudite ou de la Jordanie.
En raison de cette bénédiction urbi et orbi accordée ici par Kissinger à la politique internationale des États-Unis, le hiatus devient plus accusé que jamais entre l’encens que l’auteur fait monter vers les principes de l’ancienne diplomatie européenne et les règles que l’ancien secrétaire d’État observe et bénit dans « l’ordre du monde » de notre temps.
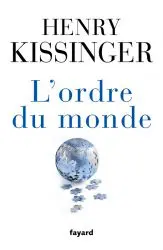 Dans la première tranche de son ouvrage, Kissinger se délecte et nous séduit. Il redevient l’analyste tôt marqué par la plus honorable diplomatie européenne, celle des deux traités de Westphalie (1648) et celle des accords de Vienne (1814). Enthousiaste, Kissinger estime que les principes respectés par ces deux moments historiques méritent respect et imitation. Lors de la paix de Westphalie, les belligérants, saignés à blanc par les guerres de religion, avaient convenu de laisser leurs voisins choisir librement leur confession religieuse. À chacun de choisir son culte et d’accorder la même latitude aux autres. Du coup, la religion cessait de faire couler le sang ; du coup, l’Europe s’apaisait jusqu’au volcan napoléonien.
Dans la première tranche de son ouvrage, Kissinger se délecte et nous séduit. Il redevient l’analyste tôt marqué par la plus honorable diplomatie européenne, celle des deux traités de Westphalie (1648) et celle des accords de Vienne (1814). Enthousiaste, Kissinger estime que les principes respectés par ces deux moments historiques méritent respect et imitation. Lors de la paix de Westphalie, les belligérants, saignés à blanc par les guerres de religion, avaient convenu de laisser leurs voisins choisir librement leur confession religieuse. À chacun de choisir son culte et d’accorder la même latitude aux autres. Du coup, la religion cessait de faire couler le sang ; du coup, l’Europe s’apaisait jusqu’au volcan napoléonien.
Vienne apporta quelque chose d’aussi significatif. Kissinger note à la fois la différence entre les deux moments et l’importance des deux : « Les hommes d’État réunis à Vienne en 1814 se trouvaient dans une situation radicalement différente de celle de leurs prédécesseurs qui avaient rédigé la paix de Westphalie ». Certes, le système alors mis en place par les catholiques à Münster et par les protestants à Osnabrück avait tenu pendant un siècle et demi, mais « les négociateurs présents au congrès de Vienne avaient les décombres de cet ordre sous les yeux ». Les vainqueurs de Waterloo eurent la sagesse de ne pas abuser de leur force : ils cherchèrent l’équilibre entre les États plus que l’humiliation d’un pays vaincu. Kissinger admire ceci : quand la France fut défaite à Waterloo, les vainqueurs surent ne pas rebâtir l’Europe sans elle. Sagement, ils admirent le pays vaincu à discuter reconstruction et lui rendirent la dignité et le statut d’un égal : « […] une conception intelligente de la paix permit une réintégration rapide de la France dans le concert des puissances initialement constitué pour contrecarrer ses ambitions. L’Autriche, la Prusse et la Russie, qui, en vertu de l’équilibre des forces, auraient dû être rivales, menèrent dans les faits une politique commune ».
Formé à cette école et nourri de cet esprit, l’auteur étonne donc en jugeant que les États-Unis modernes pratiquent la même modération et visent la même coexistence pacifique. « […] l’Amérique, écrit-il, a, au cours de son histoire, joué un rôle paradoxal dans l’ordre du monde : elle s’est étendue sur l’ensemble d’un continent au nom de sa ‘destinée manifeste’ tout en renonçant publiquement à tout dessein impérialiste. » Kissinger affirmera aussi, sans vérifier si la démocratie peut se greffer par la force, que « tous les présidents, quel qu’ait été leur parti, ont proclamé que les principes américains étaient valables pour l’ensemble du monde ». Au moment de conclure, il demandera de reconduire tel quel l’ordre du monde : « Les États-Unis – incarnation déterminante de la quête humaine de liberté dans le monde moderne et force géopolitique indispensable à la défense des valeurs humaines – doivent impérativement conserver leur sens de l’orientation ».
Les signataires des traités de la Westphalie et de Vienne se reconnaîtraient-ils dans ces propos ? Avec des nuances ?
* Golda Meir, Richard Nixon et Henry Kissinger en 1973. ©Marion S. Trikosko/Library of Congress, LC-DIG-ds-01480.
1.Henry Kissinger, L’ordre du monde, trad. de l’américain par Odile Demange, Fayard, Paris, 2016, 395 p. ; 42,95 $.
EXTRAITS
Conscient de l’immense pouvoir des États-Unis, Truman s’enorgueillissait avant tout de leurs valeurs humaines et démocratiques. Il aurait voulu rester dans les mémoires moins pour les victoires de l’Amérique que pour sa capacité de réconciliation.
Tous les successeurs de Truman ont adopté cette vision…
p. 9
Jusqu’à présent, l’histoire et la psychologie occidentales ont traité la vérité comme indépendante de la personnalité et des expériences antérieures de l’observateur. Mais notre époque est au seuil d’une autre conception de la nature de la vérité.
p. 331











