Depuis quelques décennies, l’ailleurs semble occuper une place de plus en plus importante dans les fictions québécoises. Certains critiques ont même parlé d’une tendance à l’ailleurisme, par opposition à une époque du passé où régnait un iciisme. Qu’en est-il vraiment ? Le projet de recherche Fictions de voyage : quand la littérature du Québec parcourt le monde (XXe-XXIe siècles) a justement entrepris de constituer une vaste compilation de romans exotopiques en vue de réexaminer cet attrait pour l’ailleurs et ce qui le caractérise.

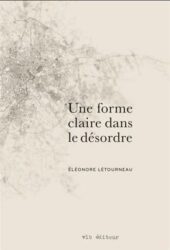
 En 1990, Lise Gauvin signalait une « frénésie de voyages qui anime plus particulièrement les héros des romans des années 801 ». En 2014, le chroniqueur du Devoir Louis Cornellier s’inquiétait de la prolifération de romans québécois puisant leur inspiration ailleurs que dans la réalité québécoise, y voyant un signe d’aliénation culturelle2. Pourtant, l’attrait pour l’ailleurs dans la production n’est pas aussi récent qu’on peut le croire et l’aliénation culturelle reste bien relative.
En 1990, Lise Gauvin signalait une « frénésie de voyages qui anime plus particulièrement les héros des romans des années 801 ». En 2014, le chroniqueur du Devoir Louis Cornellier s’inquiétait de la prolifération de romans québécois puisant leur inspiration ailleurs que dans la réalité québécoise, y voyant un signe d’aliénation culturelle2. Pourtant, l’attrait pour l’ailleurs dans la production n’est pas aussi récent qu’on peut le croire et l’aliénation culturelle reste bien relative.
La tentation de l’ailleurs au début du XXe siècle
L’opposition entre l’ici et l’ailleurs a longtemps servi de grille de lecture pour interpréter la fiction québécoise. Elle s’est tout particulièrement imposée au sujet des romans du terroir qui ont marqué le début du XXe siècle, des romans que l’on associe systématiquement à une propagande régionaliste et nationaliste qui prône l’enracinement sur le territoire québécois. Or, au-delà de la prescription interprétative convenue, peu d’attention semble avoir été accordée à « l’étonnante fréquence » dans les œuvres d’un « désir de sortir de son milieu ; d’un besoin d’aller ailleurs, d’une tentation de partir, temporairement ou définitivement, pour l’étranger3 », comme le notait pourtant déjà le sociologue Jean-Charles Falardeau en 1967. De fait, dans les premières décennies du XXe siècle, de nombreux romans mettent en scène des personnages pris « d’une rage de courir le monde41 », « convaincus de la nécessité de partir5 », atteints de « la fièvre des voyages6 » vers « la liberté et le vaste monde7 » par lesquels chacun espère s’extraire de « cette morne hébétude de la stagnation8» et vaincre « le dégoût d’une existence étriquée9 ». Ce désir de départ, qui constitue l’étape archétypale de l’appel de l’aventure, se révèle pourtant significatif en ce qu’il peut également traduire un besoin de se délester d’une vie de privations et de s’insurger contre un mode de vie traditionnel. Dans ce qu’il est convenu d’appeler l’une des plus programmatiques œuvres de notre littérature, soit le roman Restons chez nous ! (1908) de Damase Potvin, le protagoniste Paul Pelletier décide de partir pour les États-Unis. Pour justifier son départ auprès de sa fiancée, il se livre à un virulent réquisitoire contre la vie agraire : « [C]’est pour notre bonheur à tous que je pars ; nous sommes pauvres ; et cette pauvreté me pèse […] je n’aime pas les travaux des champs, je ne peux m’y faire […] c’est un métier que j’abhorre ; et, d’ailleurs, ce n’est pas un métier que celui dans lequel on ne peut réussir qu’à la condition de se priver de tout… » Ce dégoût du héros pour les travaux de la terre n’est pas chose si exceptionnelle dans la production du terroir. Rappelons notamment la fameuse diatribe de Lorenzo Surprenant dénonçant avec virulence la misère des habitants dans le roman Maria Chapdelaine (1916). Sur ce plan, Nord-Sud (1931) est également évocateur. Contrairement à bon nombre de romans de l’époque qui tranchent rapidement le dilemme, celui de Léo-Paul Desrosiers est entièrement consacré à la délibération du personnage entre partir et rester, et ce n’est qu’à la toute fin que ce dernier prend finalement la décision de partir, non sans avoir au préalable mis en balance la « monotonie sans nom » des travaux de la ferme et « la liberté » que lui offre « le vaste monde ».
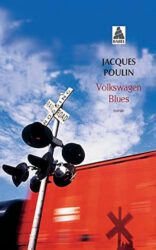
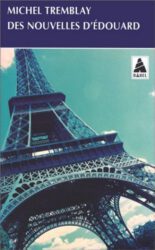 Non moins que le besoin de partir, la représentation de l’ailleurs est parfois plus nuancée qu’attendu dans la production de la première moitié du XXe siècle. Bien sûr, il ne manque pas de personnages qui vont connaître à l’étranger un malheur pire que celui qu’ils ont cherché à fuir. Mais certains héros voyageurs réussissent à s’enrichir et à s’accomplir, sinon à s’instruire au cours de leur voyage. Pendant ses séjours aux États-Unis et en France, Paul Pelletier, dans Restons chez nous !, tombe de Charybde en Scylla, mais non sans avoir vécu ce qu’il estime être malgré tout « un temps d’épreuves qui est utile, qui forge l’âme pour la vie… ! » Dans le roman L’Œil du phare (1923) d’Ernest Chouinard, le voyage du protagoniste Jean Pèlerin en Europe supplée à l’instruction qu’il n’a pas pu parfaire au collège. Plus encore, aux États-Unis, il s’adonne à l’étude des réactions électrothermiques, et connaît succès et richesse à la « Cincinnati Bridging and Steel Works ». En cela, il s’apparente au héros Jean Lozé qui a quitté le Québec pour les États-Unis, où il a fait fortune grâce à une invention dans le domaine forestier (Errol Bouchette, Robert Lozé, 1903). Quelque temps après, Lozé rentre triomphalement au pays et en moins de deux ans fonde une nouvelle et prospère ville industrielle. Il est pour le moins significatif de constater que l’ascension sociale de ces héros exige, contre toute attente, un détour par un pays étranger. Chez certaines autrices, le voyage comporte également une fonction significative. Selon Adrien Rannaud, il constitue un « moteur de l’introspection » dans les écrits au féminin des années 1930 : « [L]a mobilité spatiale, synonyme de mobilité identitaire, matérialise le désordre de la psyché féminine et, a fortiori, remet en question les fondements de la condition des femmes10 ». Dans le roman La chair décevante (1931) de Jovette Bernier, par exemple, l’héroïne Didi Lantagne trouve une forme de ressourcement salutaire dans un voyage en Europe. Bref, l’ailleurs n’offre pas que des malheurs aux personnages des fictions québécoises du début du XXe siècle.
Non moins que le besoin de partir, la représentation de l’ailleurs est parfois plus nuancée qu’attendu dans la production de la première moitié du XXe siècle. Bien sûr, il ne manque pas de personnages qui vont connaître à l’étranger un malheur pire que celui qu’ils ont cherché à fuir. Mais certains héros voyageurs réussissent à s’enrichir et à s’accomplir, sinon à s’instruire au cours de leur voyage. Pendant ses séjours aux États-Unis et en France, Paul Pelletier, dans Restons chez nous !, tombe de Charybde en Scylla, mais non sans avoir vécu ce qu’il estime être malgré tout « un temps d’épreuves qui est utile, qui forge l’âme pour la vie… ! » Dans le roman L’Œil du phare (1923) d’Ernest Chouinard, le voyage du protagoniste Jean Pèlerin en Europe supplée à l’instruction qu’il n’a pas pu parfaire au collège. Plus encore, aux États-Unis, il s’adonne à l’étude des réactions électrothermiques, et connaît succès et richesse à la « Cincinnati Bridging and Steel Works ». En cela, il s’apparente au héros Jean Lozé qui a quitté le Québec pour les États-Unis, où il a fait fortune grâce à une invention dans le domaine forestier (Errol Bouchette, Robert Lozé, 1903). Quelque temps après, Lozé rentre triomphalement au pays et en moins de deux ans fonde une nouvelle et prospère ville industrielle. Il est pour le moins significatif de constater que l’ascension sociale de ces héros exige, contre toute attente, un détour par un pays étranger. Chez certaines autrices, le voyage comporte également une fonction significative. Selon Adrien Rannaud, il constitue un « moteur de l’introspection » dans les écrits au féminin des années 1930 : « [L]a mobilité spatiale, synonyme de mobilité identitaire, matérialise le désordre de la psyché féminine et, a fortiori, remet en question les fondements de la condition des femmes10 ». Dans le roman La chair décevante (1931) de Jovette Bernier, par exemple, l’héroïne Didi Lantagne trouve une forme de ressourcement salutaire dans un voyage en Europe. Bref, l’ailleurs n’offre pas que des malheurs aux personnages des fictions québécoises du début du XXe siècle.
Même le retour au pays des protagonistes peut être nuancé. S’il fournit généralement l’occasion de célébrer le giron natal retrouvé, il peut également donner lieu à une perspective critique. À son retour après vingt fructueuses années en Afrique, le héros du roman Allie (1936) de Joseph Lallier prend note, en lisant le journal, du recul du français au Québec, pour le déplorer : « Remué jusqu’au fond de l’âme, je tournai la page, car je n’en pouvais plus, et je me mis à lire les annonces. Je me consolerai, me dis-je, en reprenant contact avec l’esprit si français du vieux Québec. Or, voici ce qui me tomba sous les yeux : ‘Rock City Preserving Co.’, ‘Quebec Tobacco Co.’, ‘Red Bird Café’. Les Anglais avaient-ils donc reconquis Québec une deuxième fois ? »
Il importe de rappeler qu’il ne s’agit pas ici de contester le fait incontournable que bon nombre de romans de l’époque soutiennent l’enracinement sur le territoire québécois. Mais on aurait tort de réduire, sans nuances, la production à cette seule finalité. À la relire, on constate qu’il en émane un attrait pour l’ailleurs, du reste reconnu à l’époque. On se rappellera la fameuse remarque du poète Alfred DesRochers commentant la poésie d’Eva Senécal : « À ce point de vue, les vers de Mlle Senécal, tendus vers le Rêve, vers l’espace, vers les pays exotiques, traduisent avec infiniment plus de fidélité la mentalité de notre peuple que ceux des régionalistes étroits. […] Au fond de chacun de nous sommeille un désir de tenter l’inconnu, de partir11 ».
Même dans des romans à thèse, on perçoit la propension à rêver l’ailleurs dont parle DesRochers. Certes, dans le contexte contraignant de l’époque, la portée de ce désir y est souvent atténuée ou récupérée, entre autres par une fin moralisatrice ou par la victimisation des personnages agentifs hors norme, mais non sans avoir permis au préalable à ces personnages d’exprimer un manque, un besoin d’émancipation ou d’affirmation. Or, à travers ceux-ci, n’est-ce pas la possibilité d’imaginer, voire d’espérer un monde différent qui est malgré tout esquissée ? Certains en effet n’incarnent-ils pas au début du XXe siècle une quête de « liberté individuelle », un « amour effréné de la liberté » (Restons chez nous !) qui, indirectement, annoncent prophétiquement un avenir ?
Partir pour de multiples motifs
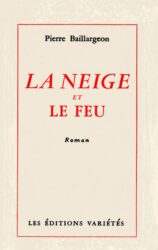
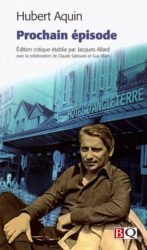 À partir des années 1950, le désir de changer de vie demeure un motif prégnant, mais il répond davantage à des besoins existentiels qu’à des contraintes matérielles. Il s’agit moins de s’exiler pour tenter sa chance ailleurs que de se donner de l’air, de prendre une distance à l’endroit du chez-soi et d’atteindre ainsi une « nouvelle forme de présence à soi12 », pour reprendre les termes d’Éric Landowski. Le rapport aux destinations recherchées en témoigne.
À partir des années 1950, le désir de changer de vie demeure un motif prégnant, mais il répond davantage à des besoins existentiels qu’à des contraintes matérielles. Il s’agit moins de s’exiler pour tenter sa chance ailleurs que de se donner de l’air, de prendre une distance à l’endroit du chez-soi et d’atteindre ainsi une « nouvelle forme de présence à soi12 », pour reprendre les termes d’Éric Landowski. Le rapport aux destinations recherchées en témoigne.
L’ailleurs s’est d’abord incarné dans les deux pays les plus proches du Québec, que ce soit par la culture ou la proximité géographique : la France et les États-Unis. Dans les deux cas, on observe une évolution. La France est d’abord une terre fraternelle : propice au rêve chez Jovette Bernier (La chair décevante, 1931), formatrice chez Pierre Baillargeon (La neige et le feu, 1948), enchantée chez Alain Grandbois (Avant le chaos, 1945). Ce rapport commence à se complexifier à partir des années 1960 où se fait jour une désillusion, comme dans La montagne secrète de Gabrielle Roy (1961). Tandis qu’Hubert Aquin l’évite sciemment en projetant son imaginaire tantôt en Suisse (Prochain épisode, 1965), tantôt en Italie et aux États-Unis (L’antiphonaire, 1969), enfin en Norvège (Neige noire, 1974), voici venu le temps des règlements de compte. À partir des années 1970, la force d’attraction que Paris continue malgré tout d’exercer bascule vers un rejet critique, souvent sur le mode de la satire sociale (Une liaison parisienne de Marie-Claire Blais, 1975 ; Le cercle des arènes de Roger Fournier, 1982 ; Des nouvelles d’Édouard de Michel Tremblay, 1984). Plus tardivement, Anne Hébert (L’enfant chargé de songes, 1992) et Jacques Godbout (La concierge du Panthéon, 2006) feront aussi état d’une déceptivité.
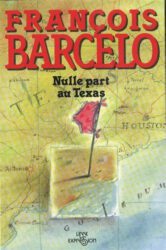
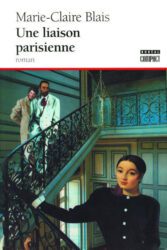 Ce mouvement de rejet (partiel, précisons-le) de la référence française fait place aussitôt à une claire volonté de déployer l’imaginaire québécois dans le contexte des Amériques. Voici les romanciers sillonnant les routes des États-Unis, à l’exemple de Kerouac, figure tutélaire de cette jonction entre les passés américains et canadiens-français. Gilles Archambault donne le ton avec Le voyageur distrait (1981), qui raconte justement l’histoire de deux amis lancés sur les traces de Kerouac, mais on doit à Jacques Poulin le titre le plus emblématique, devenu un classique, de ce type d’équipée trans-Amérique : Volkswagen blues(1984). Ce modèle connaîtra de nombreuses variations par la suite, certains y allant même de discrètes allusions au roman de Poulin, comme Guillaume Vigneault (Chercher le vent, 2001). Mais c’est véritablement à la fin des années 1980 et au début des années 1990 que la conquête des États-Unis se manifeste le plus massivement. Si le modèle du roman de la route est rejoué dans la tétralogie de François Barcelo, entreprise en 1989 avec Nulle part au Texas et conclue en 1992 avec Pas tout à fait en Californie, d’autres écrivains se proposent plutôt de couper court à la mythologie américaine afin de l’ausculter de manière critique, et de prendre la mesure de la violence qui y sévit et de la domination qu’elle exerce sur le monde. Ces romans nous présentent des personnages qui choisissent de s’installer dans une grande ville américaine (les deux pôles sont New York et San Francisco) pour y mener des recherches ou faire fortune. Retenons à cet égard trois contributions majeures : Petites violences (1982) de Madeleine Monette, Une histoire américaine (1986) de Jacques Godbout et Copies conformes (1989) de Monique LaRue. L’occasion est belle de souligner que cette approche critique du voisin américain était déjà présente dans L’été de la cigale (1968), roman d’Yvette Naubert malheureusement méconnu, qui nous fait le portrait d’une bourgeoisie bostonienne où règne encore la ségrégation raciale.
Ce mouvement de rejet (partiel, précisons-le) de la référence française fait place aussitôt à une claire volonté de déployer l’imaginaire québécois dans le contexte des Amériques. Voici les romanciers sillonnant les routes des États-Unis, à l’exemple de Kerouac, figure tutélaire de cette jonction entre les passés américains et canadiens-français. Gilles Archambault donne le ton avec Le voyageur distrait (1981), qui raconte justement l’histoire de deux amis lancés sur les traces de Kerouac, mais on doit à Jacques Poulin le titre le plus emblématique, devenu un classique, de ce type d’équipée trans-Amérique : Volkswagen blues(1984). Ce modèle connaîtra de nombreuses variations par la suite, certains y allant même de discrètes allusions au roman de Poulin, comme Guillaume Vigneault (Chercher le vent, 2001). Mais c’est véritablement à la fin des années 1980 et au début des années 1990 que la conquête des États-Unis se manifeste le plus massivement. Si le modèle du roman de la route est rejoué dans la tétralogie de François Barcelo, entreprise en 1989 avec Nulle part au Texas et conclue en 1992 avec Pas tout à fait en Californie, d’autres écrivains se proposent plutôt de couper court à la mythologie américaine afin de l’ausculter de manière critique, et de prendre la mesure de la violence qui y sévit et de la domination qu’elle exerce sur le monde. Ces romans nous présentent des personnages qui choisissent de s’installer dans une grande ville américaine (les deux pôles sont New York et San Francisco) pour y mener des recherches ou faire fortune. Retenons à cet égard trois contributions majeures : Petites violences (1982) de Madeleine Monette, Une histoire américaine (1986) de Jacques Godbout et Copies conformes (1989) de Monique LaRue. L’occasion est belle de souligner que cette approche critique du voisin américain était déjà présente dans L’été de la cigale (1968), roman d’Yvette Naubert malheureusement méconnu, qui nous fait le portrait d’une bourgeoisie bostonienne où règne encore la ségrégation raciale.
À la fin des années 1990, la découverte des Amériques cesse de se limiter aux États-Unis et on pousse l’exploration, qui au Mexique, qui au Brésil. Le Mexique est particulièrement prisé : quinze titres entre 1995 et 1999, dix-sept de 2000 à 2009, vingt-deux de 2010 à 2019. L’intérêt pour le Brésil se concentre surtout de 1995 à 2000 avec huit titres, production nourrie principalement par deux auteurs qui ont fait du Brésil leur terre de prédilection : Pierre Samson amorce une trilogie avec Le messie de Belém (1996), alors que Claire Varin entreprend la même année une fructueuse série avec Profession : Indien. Se dessine alors une volonté de définir l’américanité du Québec par-delà le modèle étatsunien et en solidarité avec les pays d’Amérique du Sud marqués aussi par le colonialisme.
Voyager : apprentissage de soi et du monde
Peut-on établir une corrélation entre l’affirmation des voix féminines et une expérience de la liberté qui passe par le voyage ? Certains textes tracent ce motif. Dans Amadou (1963), roman d’une intense poésie, Louise Maheux-Forcier énumère les amants qu’elle a eus au milieu d’épiphanies vécues à travers le monde : « J’ai rencontré l’ânier qui m’a prise en silence au bord de la mer Égée sous un échafaudage d’un vert indicible. Ma peau est devenue toute brune au soleil. J’ai coupé mes cheveux et je vivais pieds nus. […] À Naples, j’ai connu un petit Italien noir comme l’ébène et pétri de feu. Nous nous sommes caressés sur les marches des temples de Paestum striées de minuscules lézards qui font un bruit de cellophane ».
Une pareille soif de liberté, de New York au Népal, anime la protagoniste de Kathmandou (1968), de Louise Beaugrand-Champagne. La jeune narratrice de L’eau est profonde (Diane Giguère, 1965), à distance du regard parental, vit quant à elle sur l’île antillaise de Sainte-Croix un amour douloureux qui la transformera. Plus tard, nous voyons celle du premier roman de Danielle Dubé (Les olives noires, 1984) profiter d’un voyage en Espagne pour se libérer d’un mari devenu étouffant. Ce même motif d’arrachement de la vie de couple est lisible dans Les yeux grecs (Danielle Dussault, 1996) et La femme de Valence (Annie Perreault, 2018). Amour et dépaysement se conjuguent ainsi dans de nombreux romans féminins (mais aussi masculins, il faut le préciser), d’Un homme est une valse (1992) de Pauline Harvey à Chasse à l’homme (2020) de Sophie Létourneau à qui, dixit la quatrième de couverture, une cartomancienne « prédit que, grâce à un livre, elle rencontrera l’homme de sa vie », mais qu’« avant cela, il lui faudra déménager à Paris, s’amouracher d’un petit Français et se rendre en Asie ». Se tremper dans des espaces peu familiers s’avère un rite initiatique qui provoque des révolutions intérieures.
L’ailleurs est aussi une occasion d’élargir sa compréhension de la condition humaine. Les fictions de voyage seraient-elles une manière pour les romanciers du Québec, pays peu marqué par les guerres, les famines et les persécutions, de se mettre au diapason des souffrances, autres que morales, qui affectent l’humanité, ou encore des enjeux planétaires ? C’était déjà le cas chez Grandbois, qui fréquentait des réfugiés politiques et s’approchait de zones de turbulence en Afrique et en Asie. Par la suite, on verra un immense intérêt suscité par des romans comme Un dimanche à la piscine à Kigali (Gil Courtemanche, 2000) et Comment devenir un monstre (Jean Barbe, 2004). Le roman de genre (historique, fantastique, d’enquête, d’espionnage) est particulièrement riche en récits exotopiques. Certains auteurs se sont même spécialisés dans ces genres, comme Luc Chartrand (Le code Bezhentzi, 1998), Camille Bouchard (Les démons de Bangkok, 2005) et Jean-Jacques Pelletier (L’argent du monde, 2001).
Se penser à l’échelle de la planète
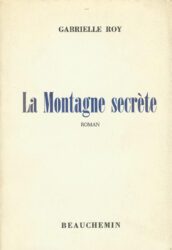
 Depuis le début du XXIe siècle, l’exotopie romanesque présente un visage éclaté, en raison non seulement de la diversification des ailleurs (l’Asie, en particulier, se fait de plus en plus présente), mais également de la manière de les parcourir. L’exotisation de l’ailleurs n’a à peu près plus cours et on s’emploie beaucoup moins à établir des comparaisons entre le Québec et les pays étrangers. L’immersion dans l’ailleurs (parfois l’autre langue) devient une fin en soi, sans que se manifeste l’horizon d’un retour au pays natal. Quelques romans vont même jusqu’à effacer toute référence au Québec, nous situant d’entrée de jeu en pays étranger, en compagnie de personnages non-Québécois : en Russie dans L’homme blanc (2010) de Perrine Leblanc, en France et au Japon dans Oshima (2019) de Serge Lamothe, en Tasmanie dans Bunyip(2014) de Louis Carmain, au Mexique dans Le nombril de la lune (2018) de Françoise Major (qui donne à lire, en plus, de longs passages en espagnol). Chez d’autres écrivains, les frontières nationales tendent à s’estomper ou à devenir poreuses, de manière à mettre en évidence comment le monde se trouve répercuté dans l’espace québécois. Alors qu’Éléonore Létourneau, dans Une forme claire dans le désordre (2021), tente de cerner une solidarité internationale qui ne céderait pas au cosmopolitisme consumériste (le monde comme un vaste marché), Hélène Rioux, dans une série de romans intitulés Fragments du monde (de 2007 à 2019), fait d’un petit restaurant montréalais (« Le Bout du monde » !) le lieu où s’entrecroisent de multiples destins vécus dans tous les horizons de la planète. Est également significative en cette matière la démarche de Bianca Joubert dans son dernier livre, Couleur chair (2022). Alors que son premier roman, Le bordeur (2012), présentait le cas plus conventionnel d’une coopérante en immersion au Burkina Faso, avec tout ce que cela suppose d’écart culturel observé, Couleur chair creuse l’altérité refoulée de l’histoire québécoise. Si le rapport à l’origine a été le plus souvent pensé en référence à la France, cette fois c’est sur l’île de Gorée (Sénégal) que se rend la protagoniste, avec l’intention de retraverser à l’envers le portail par où serait passé un ancêtre supposé parmi un contingent d’esclaves envoyés en Amérique. Fuyant les États-Unis, cet homme aurait trouvé refuge au Québec pour disparaître de nouveau. Une généalogie trouble, où se mélangent autochtones, réfugiés d’origine africaine et Canadiens français, se dégage de ce roman qui sonde une part d’héritage occultée par le récit national.
Depuis le début du XXIe siècle, l’exotopie romanesque présente un visage éclaté, en raison non seulement de la diversification des ailleurs (l’Asie, en particulier, se fait de plus en plus présente), mais également de la manière de les parcourir. L’exotisation de l’ailleurs n’a à peu près plus cours et on s’emploie beaucoup moins à établir des comparaisons entre le Québec et les pays étrangers. L’immersion dans l’ailleurs (parfois l’autre langue) devient une fin en soi, sans que se manifeste l’horizon d’un retour au pays natal. Quelques romans vont même jusqu’à effacer toute référence au Québec, nous situant d’entrée de jeu en pays étranger, en compagnie de personnages non-Québécois : en Russie dans L’homme blanc (2010) de Perrine Leblanc, en France et au Japon dans Oshima (2019) de Serge Lamothe, en Tasmanie dans Bunyip(2014) de Louis Carmain, au Mexique dans Le nombril de la lune (2018) de Françoise Major (qui donne à lire, en plus, de longs passages en espagnol). Chez d’autres écrivains, les frontières nationales tendent à s’estomper ou à devenir poreuses, de manière à mettre en évidence comment le monde se trouve répercuté dans l’espace québécois. Alors qu’Éléonore Létourneau, dans Une forme claire dans le désordre (2021), tente de cerner une solidarité internationale qui ne céderait pas au cosmopolitisme consumériste (le monde comme un vaste marché), Hélène Rioux, dans une série de romans intitulés Fragments du monde (de 2007 à 2019), fait d’un petit restaurant montréalais (« Le Bout du monde » !) le lieu où s’entrecroisent de multiples destins vécus dans tous les horizons de la planète. Est également significative en cette matière la démarche de Bianca Joubert dans son dernier livre, Couleur chair (2022). Alors que son premier roman, Le bordeur (2012), présentait le cas plus conventionnel d’une coopérante en immersion au Burkina Faso, avec tout ce que cela suppose d’écart culturel observé, Couleur chair creuse l’altérité refoulée de l’histoire québécoise. Si le rapport à l’origine a été le plus souvent pensé en référence à la France, cette fois c’est sur l’île de Gorée (Sénégal) que se rend la protagoniste, avec l’intention de retraverser à l’envers le portail par où serait passé un ancêtre supposé parmi un contingent d’esclaves envoyés en Amérique. Fuyant les États-Unis, cet homme aurait trouvé refuge au Québec pour disparaître de nouveau. Une généalogie trouble, où se mélangent autochtones, réfugiés d’origine africaine et Canadiens français, se dégage de ce roman qui sonde une part d’héritage occultée par le récit national.
Le monde fait donc son entrée dans le processus identitaire que met en scène le roman québécois. Fait à relever, l’enjeu de l’aventure exotopique est toujours la redéfinition du sujet québécois au contact de l’ailleurs. La primauté est accordée à l’ouverture et à la réceptivité, sans que soit envisagée la transitivité de la culture québécoise vers ces ailleurs, l’influence qu’elle pourrait exercer, ce qu’elle serait susceptible de donner au reste du monde. Certains verront dans ce besoin de se redéfinir au contact de l’ailleurs un signe d’aliénation, ou encore d’insécurité culturelle. Et si l’on renversait la perspective en posant que le legs de la littérature québécoise au reste du monde, son geste innovateur, réside précisément dans cette ouverture des frontières ?
1. Lise Gauvin, « L’en-deçà des voyages : exploration de quelques romans québécois », dans La deriva delle francofonie. Autour de l’univers souterrain dans la littérature québécoise, Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna, Bologne, 1990, p. 225-226.
2. Louis Cornellier, « Lettre sur la tentation exotique », en ligne :
ledevoir.com/documents/pdf/lettre_cornellier.pdf. La lettre est jointe à un article de Christian Desmeules, « Les nouveaux exotiques »,Le Devoir, 27 septembre 2014.
3. Jean-Charles Falardeau, Notre société et son roman, HMH, Montréal, 1967, p. 40.
4. Lucie Clément, En marge de la vie, Albert Lévesque, Montréal, 1934, p. 89.
5. Pierre Dupuy, André Laurence Canadien-Français, Plon, Paris, 1930, p. 239.
6. Hervé Biron, Poudre d’or, Fernand Pilon, Montréal, 1945, p. 10.
7. Léo-Paul Desrosiers, Nord-Sud, 2e édition, Les Éditions du Devoir, Montréal, 1943, p. 124.
8. Ibid., p. 106.
9. Ibid., p. 186.
10. Adrien Rannaud, De l’amour et de l’audace : Femmes et romans au Québec dans les années 1930, Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 2018, p. 73.
11. Alfred DesRochers, Paragraphes, Albert Lévesque/Librairie d’Action canadienne-française, Montréal, 1931, p. 156-157.
12. Éric Landowski, Présences de l’autre. Essais de socio-sémiotique II, PUF, Paris, 1997, p. 99.
EXTRAITS
Quand on veut oublier on part en voyage : d’autres terres surgissent, d’autres beautés émeuvent, d’autres visages sourient ou nous ennuient, mais parce que c’est ailleurs, un peu de tout se renouvelle.
Jovette Bernier, La chair décevante, Albert Lévesque, Montréal, 1931, p. 36.
Quel voyage plus merveilleux pouvait s’offrir à lui ? S’en aller dans un pays aussi éloigné, aussi différent, se déplacer pendant des semaines et des mois, voir la mer, les tropiques, une autre végétation, que pouvait-il imaginer de mieux ?
Léo-Paul Desrosiers, Nord-Sud, Les Éditions du Devoir, Montréal, 1943 [1931], p. 107.
Croupir dans un coin quand l’univers évolue, se renouvelle me semble un crime. Ne se soucier que d’accomplir avec régularité, modestie le même programme à l’infini ! Mais c’est assommant. Donc, je suis parti un soir de cafard ; je me suis embarqué et me voilà à Delhi.
Lucie Clément, En marge de la vie, Albert Lévesque, Montréal, 1934, p. 89.
D’où nous venait, mon amour, ce périodique besoin de partir ? Comme un manque, un appel d’air. […] j’avais cru, naïvement, que ce déplacement me révélerait le sens de ma vie. […] j’avais cru à la magie du lieu, au miracle du voyage.
Monique LaRue, Copies conformes, « Boréal compact », Boréal, Montréal, 1998, p. 62 et 65.
Ailleurs. Le mot magique, chargé de tous les fantasmes. Un meilleur monde existe. Ailleurs. Là où l’herbe est plus verte et plus tendre, le ciel plus bleu, là où l’or scintille dans le lit des rivières. Ailleurs, toujours plus loin, au-delà des frontières futiles.
Hélène Rioux, Le bout du monde existe ailleurs, Leméac, Montréal, 2019, p. 9.
À dix-neuf ans fuyant ma famille ma mère aimante mon pays à la recherche de moi-même […] courant vers la gare des autobus en partance pour Montréal d’où j’allais prendre l’avion vers la France l’Italie la Grèce rejoindre la Crète et l’ami amoureux qui ne m’y attendait pas.
Anne Élaine Cliche, Le danseur de La Macaza, Le Quartanier, Montréal, 2021, p. 150.











