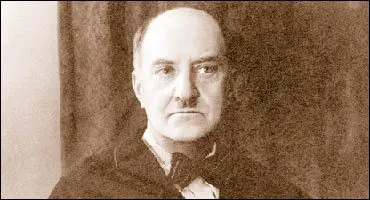Dès le premier de ses huit recueils, Psyché au cinéma (1916), Marcel Dugas a pratiqué un genre peu fréquenté à l’époque, au Québec : le poème en prose.
Ce livre, qui n’avait jamais été réédité, nous est tout à coup offert, 82 ans plus tard, par pas moins de 3 maisons d’édition, à quelques mois d’intervalle seulement. Cet inédit et surprenant concours de circonstances devrait permettre de réactiver la connaissance du romantico-symboliste poète-essayiste que fut Marcel Dugas.
La plus importante de ces trois rééditions est sans conteste celle de Marc Pelletier1, qui s’est donné comme objectif de publier non seulement Psyché au cinéma, mais encore tous les poèmes en prose de Marcel Dugas, dans le cadre du programme bien connu d’édition critique des Presses de l’Université de Montréal. Les Poèmes en prose réunis par Marc Pelletier nous donnent une image globale et complète de la diversité de l’écriture dugasienne, que presque tout le monde associe dans un premier temps, de façon pertinente, au symbolisme, et, par voie de conséquence, au modernisme d’alors. « Valeur musicale et suggestive des mots, expression du mystère, de l’ineffable, de l’inconnu, révélation de l’âme humaine, préséance de l’image et du symbole sur le réel », tels sont les traits particuliers que relève l’éditeur critique dans son abondante introduction. On pourrait ajouter, pour préciser davantage : préférence accordée non pas à la réalité, mais au rêve de cette réalité, prédominance de l’idée sur la matière ou le réel, recherche de l’impression créée par les objets plutôt que tendance à leur dénomination, volonté de renoncer au caractère discursif du langage pour explorer ses propriétés sensibles, recours à la métaphore, à la suggestion, à l’incantation, aux états d’âme Mais si « l’art poétique de Dugas » est en ce sens « proche de la doctrine symboliste », il l’est souvent aussi du romantisme, et plus particulièrement d’un romantisme pessimiste, en vertu du lyrisme, de la mélancolie, de la tristesse, du souvenir, de la nostalgie et de la désespérance qui sourdent régulièrement de ses poèmes : la chose, me souvient-il, est encore plus évidente dans ses essais, où, fréquemment, l’artiste le dispute au critique, tout comme, inversement et corollairement, dans ses poèmes, l’essayiste accompagne le poète.
Marc Pelletier a choisi de procéder à son édition en « [donnant] d’abord en entier le recueil Paroles en liberté [1944], où Marcel Dugas a repris, en les remaniant, quarante et un des poèmes parus antérieurement ». Il avait ainsi « la version la plus achevée de ces textes », dit-il à bon droit puisque Paroles en liberté fut son dernier livre. Les quelque 40 ou 50 autres écrits qui complètent l’œuvre poétique de Dugas ont ensuite été repris « sous le titre du recueil dans lequel ils ont été publiés pour la dernière fois et dans l’ordre où ils figuraient ». S’y trouvent donc successivement des textes de Psyché au cinéma (1916), de Confins (1921), de Flacons à la mer (1923), de Cordes anciennes (1933) et de Nocturnes (1937), à quoi Marc Pelletier ajoute les « deux proses lyriques qui ont été publiées sous la forme de plaquettes » : Salve Alma Parens (1941) et Notre nouvelle épopée (1941 également). Cette démarche était sans doute celle qui convenait le mieux pour reproduire l’œuvre d’un écrivain qui aimait beaucoup revoir et reprendre ses poèmes d’un recueil à l’autre, après en avoir donné, souvent, une première version dans quelque périodique montréalais : « La défaite du printemps », par exemple, a d’abord paru dans L’Action de Jules Fournier, le 29 mai 1915, puis a été publié l’année suivante dans Psyché au cinéma et reproduit ensuite dans deux journaux (en 1916 et 1938) et dans les recueils de 1923 et de 1944. Marc Pelletier donne d’ailleurs de ce poème six fois mis sous les yeux des lecteurs une liste assez éloquente de variantes.
La disposition adoptée par l’éditeur critique ne permet plus cependant de retrouver l’état original des livres, sauf bien sûr dans le cas de Paroles en liberté, qui a servi de texte de base. C’est là où la double réédition de Psyché au cinéma, par Sylvain Campeau2 chez Triptyque et par André Roy3 aux Herbes rouges, trouve son utilité puisqu’elle reproduit le seul texte de 1916. Force est de constater toutefois qu’en confrontant ces deux versions aux nombreuses notes de Marc Pelletier, il subsiste bien des divergences de présentation chez les trois éditeurs ; ce sont des questions de détail, en général, touchant par exemple un appel de note différé, un alinéa ajouté, des guillemets oubliés, des points de suspension en plus, un mot ou des italiques présents ici et absents là, ou encore un verbe accordé différemment. Il n’y a rien là qui enraye sérieusement la lecture et la compréhension du texte, mais un tel défaut d’uniformité demeure assez troublant. La réimpression à l’identique du recueil n’aurait-elle pas été souhaitable, comme la chose a été réalisée récemment pour la revue d’art Le Nigog4 ?
Sylvain Campeau et André Roy font précéder leur réédition d’une présentation où ils accordent beaucoup de place à l’auteur, d’une part, et au sens de l’œuvre, d’autre part. Ils suivent en cela une vieille tradition critique qui relègue dès lors un peu dans l’ombre les aspects formels de l’écriture. Est-il plus important d’essayer de convaincre le lecteur que Dugas est « le modèle schizophrénique du Québécois » (Roy, p. 10) et qu’il y a une « sorte de déchirement schizophrénique [qui] compose […] la part moderne de Psyché au cinéma » (Campeau, p. 21), que d’analyser « l’engagement esthétique » baudelairien et « le goût du phrasé musical » rimbaldien du recueil (Roy, p. 10), ou que d’y mettre en relief « un souffle et un rythme devant beaucoup au symbolisme dans sa syntaxe, jouxtant incise sur incise en une sorte de constante suture entre pensée centrale et réflexions annexes […] » (Campeau, p. 21-22) ?
Si, dans le titre du recueil, la mention du mythe grec de Psyché oriente naturellement l’esprit vers des préoccupations de type psy, tout comme l’évocation du cinéma, un art relativement nouveau à l’époque, nous fait tendre vers le dépistage d’effets d’optique (présents aussi dans le psyché-miroir), rien ne devrait contraindre l’analyste à privilégier le contenu aux dépens du contenant, d’autant que les références mythologique et cinématographique n’ont somme toute que peu d’écho dans le livre. Cela dit, Sylvain Campeau tient des propos fort intéressants sur ledit titre, notamment, et sur les « douches » qui suivent, de même que sur « l’antilyrisme » de Dugas. D’une façon générale, toutefois, en dépit de la cohérence et de la pertinence globales des commentaires de l’édition Triptyque, la vaste introduction de Marc Pelletier est plus satisfaisante.
Certes, cette introduction est fondamentalement une vaste biobibliographie, et l’éditeur critique y passe en revue, de façon détaillée, les événements les plus marquants de la vie de Marcel Dugas : depuis ses ancêtres lyonnais, au XVIIe siècle, jusqu’à sa mort, à 63 ans, le 7 janvier 1947, en passant par ses années de formation, son appartenance à différents groupes (tels les Cavaliers de l’Apocalypse, le Soc, l’Encéphale, Le Nigog…), ses séjours parisiens, ses activités professionnelles, sociales et littéraires, son utilisation fréquente de pseudonymes, ses amours, ses amitiés, ses problèmes de santé… Mais Marc Pelletier n’occulte pas les questions formelles, beaucoup s’en faut : il aborde au contraire de multiples pistes de lecture analytique en évoquant des écrivains à qui le poète est redevable (Baudelaire, Rimbaud, Paul Fort…), en mettant le doigt sur « la diversité des styles » de Psyché au cinéma, en commentant la disposition matérielle des poèmes sur la page, en soulignant l’usage occasionnel du verset biblique, en mettant de l’avant la « forme libre par excellence » qu’est le poème en prose, ou encore en faisant état de la « composition […] le plus souvent circulaire » de ce dernier : « Texte clos et bref, le poème en prose a constamment à lutter contre la linéarité naturelle de la prose, qui risque de lui faire quitter le champ de la poésie. Dès lors, il utilise abondamment les procédés liés à la figure de la répétition : structure circulaire, – composition enveloppante où la fin retourne à la pensée du début – [Monique Parent], parallélisme de construction, reprise des images, redondance, anaphore. » Marc Pelletier a su mettre ici à profit sa thèse de doctorat portant sur le poème en prose en littérature québécoise.
Dans l’ensemble, et chacun à sa façon, Marc Pelletier, Sylvain Campeau et André Roy ont donc le mérite peu banal de contribuer à la relance d’un poète incontournable dans l’histoire littéraire québécoise du début du XXe siècle. Certaines erreurs, que je veux ici souligner, doivent pourtant être corrigées et certaines affirmations, nuancées.
En ce qui concerne la revue montréalaise Le Nigog, par exemple, Sylvain Campeau la situe malencontreusement en 1919, au lieu de 1918, et André Roy inclut deux fois Marcel Dugas parmi ses fondateurs, alors que tous savent que seuls l’architecte Fernand Préfontaine, le pianiste Léo-Pol Morin et l’homme de lettres Robert de Roquebrune ont fondé la revue. Dans ce dernier cas, il est regrettable de constater que le mythe de l’attribution à Marcel Dugas de la fondation du Nigog circule encore : si l’erreur colportée par le Dictionnaire pratique des auteurs québécois pendant une bonne douzaine d’années5 a été heureusement corrigée en 1989 dans le Dictionnaire des auteurs de langue française en Amérique du Nord6 elle subsiste toujours dans le fort Dictionnaire des littératures française et étrangères de Jacques Demougin publié chez Larousse en 1985 et réédité en 19927.
On sait par ailleurs que Marcel Dugas, au Nigog, a manifesté ses sympathies universalistes (ou parisianistes, ou exotistes, comme on disait à l’époque), et combattu le régionalisme ambiant. Mais, dans la livraison d’août de cette revue d’avant-garde, le poète a-t-il vraiment « [lancé la] polémique à propos du régionalisme en répliquant d’une manière cinglante à un article du musicien Arthur Letondal sur l’âme canadienne », le mois précédent, comme l’avance Marc Pelletier ? Il est vrai qu’en 1918 Dugas était passablement plus connu que le trio fondateur du Nigog, ayant déjà à son crédit pas moins de quatre livres et nombre d’articles et de poèmes publiés dans les journaux, et ce, dès 1907. Il est dès lors permis de croire que ses propos ont frappé plus que ceux des autres le public (ou les historiens de la littérature…). Il n’empêche que dans le Nigog de mai et de juin, Léo-Pol Morin et Édouard Chauvin avaient tour à tour réprouvé, en le nommant, le régionalisme (musical dans le premier cas et poétique dans le second), et que le mot même de régionalisme, utilisé par Arthur Letondal en juillet et par Marcel Dugas en août, n’apparaissait pas sous la plume de ce dernier dans les « fragments » qu’il avait publiés en mai et qui prenaient parti pour l’universalisme de son ami René Chopin. Ajoutons à cela l’« Hommage à Nelligan » que Robert de Roquebrune a fait paraître dans la livraison de juillet de la même revue et qui, sans utiliser le mot régionalisme, attaquait directement et vertement Blanche Lamontagne, une figure de proue de la littérature nationalo-terroiriste d’alors. Robert de Roquebrune y dénonçait « la manière puérile » de la poétesse, « ce qui [consistait] surtout à idéaliser les jupons mal odorants d’une paysanne et à trouver respectables et sacrées les faces sournoises des plus indécrottables villageois8 » : vingt ans plus tard, Valdombre n’avait pas oublié cette « saloperie9 ».
Ailleurs, sur d’autres sujets, certains propos méritent d’être revus. André Roy, par exemple, affirme erronément à deux reprises que Psyché au cinéma est « le seul livre de l’écrivain qui n’a pas bénéficié d’une édition française » ; et Sylvain Campeau, de son côté, dit deux fois, à tort, que le recueil « [n’a récolté] en tout et pour tout qu’une seule critique », celle de Madeleine, dans La Patrie du 7 août 1916. Or, la bibliographie quasi exhaustive de Marc Pelletier suffit à redresser cette double erreur. Pour ce qui est de la réception du livre, cependant, l’éditeur critique donne la référence à quatre périodiques mais ignore, curieusement, le journal cité par Sylvain Campeau.
La chronologie de Marc Pelletier permet aussi de savoir que durant son second séjour parisien (1920-1940), Marcel Dugas a fait deux visites au Canada, en 1925 et 1931 en l’occurrence, contrairement à ce qu’affirment Sylvain Campeau, qui lui en crédite une seule, et André Roy, qui ne lui en reconnaît aucune. L’éditeur des Poèmes en prose, à son tour, ne règle pas définitivement toutes les questions abordées, on l’a vu, et certaines vétilles, comme celles de Campeau et de Roy, attirent l’attention du lecteur. « Paroles à une ombre» est-il «le premier poème en prose de Dugas», ou seulement «l’un de ses premiers» ? Pourquoi ne retrouve-t-on pas le poème « Belle de ténèbres », extrait du recueil Nocturnes, dont l’introduction fait état et qui, au dire de Marc Pelletier, « adopte une forme proche du calligramme » ? Comment Dugas a-t-il pu « [découvrir le] port thonier » de Saint-Jean-de-Luz en 1918 si la guerre l’a retenu à Montréal de 1914 à 1920 ? Et où est la note infrapaginale numéro 5, appelée en page 235 ?
Ces quelques détails gâtent un peu la pertinente édition de Marc Pelletier. Moins cependant que les ajouts dont il s’est pour ainsi dire rendu coupable dans son louable désir de retrouver et de publier tous les poèmes en prose de l’écrivain montréalais. En effet, la recherche d’exhaustivité a amené l’éditeur critique à insérer dans sa deuxième annexe des « textes attribués à Marcel Dugas » et publiés anonymement dans la chronique « Au fil de l’heure », dans La Presse, en 1920 et 1921. Or les trois premiers de ces 27 textes appartiennent à Albert Laberge, qui était par ailleurs l’ami de Dugas, et ils apparaissent sous le nom de l’auteur de La Scouine dans le recueil collectif Les soirées de l’École littéraire de Montréal, en 1925 : ce sont « Tourbillon de vie », « Marche funèbre » et « Sunt lacrimae rerum »10. Il est à parier que l’on découvrira la paternité réelle de certains autres de ces textes, d’allure souvent peu dugasienne, me semble-t-il : « Les Pèlerins », qui évoque la figure de Charles de Belle, ne pourrait-il pas provenir lui aussi du même Albert Laberge, qui a parlé neuf fois de ce « peintre-poète » dans sept de ses œuvres, si l’on en croit Jacques Brunet11 ?
En dépit de cette déplorable méprise, il faut souligner la qualité générale de l’édition des poèmes en prose de Marcel Dugas par Marc Pelletier. Les éditions de Sylvain Campeau et d’André Roy seront pour leur part utiles à ceux et celles qui voudront revoir à peu près tel quel le texte seul du premier recueil de l’écrivain québécois. Il était temps, en définitive, que l’on retrouve le poète de Paroles en liberté ; après Marcel Dugas, Guy Delahaye et Paul Morin, il ne reste plus maintenant qu’un quatrième et dernier « Cavalier de l’Apocalypse » à exhumer, soit René Chopin.
1. Poèmes en prose, édition critique par Marc Pelletier, « Bibliothèque du Nouveau Monde », Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 1998, 588 p.
2. Psyché au cinéma, poèmes en prose, présentation de Sylvain Campeau, Triptyque, Montréal, 1998, 118 p.
3. Psyché au cinéma, présentation d’André Roy, « Five o’clock », Les Herbes rouges, Montréal, 1998, 75 p.
4. Le Nigog, Réimpression à l’identique des 12 numéros ; janvier à décembre 1918, Comeau & Nadeau, Montréal, 1998, 408 p. On pourra consulter le compte rendu de cette édition, par Jean-Guy Hudon, dans l’édition Internet de Nuit blanche (www. nuitblanche. com), dans les commentaires de lecture, section « Essai ».
5. Dictionnaire pratique des auteurs québécois, par Réginald Hamel, John Hare et Paul Wyczynski, Fides, Montréal, 1976, p. 222 (entrée « Dugas, Marcel »).
6. Dictionnaire des auteurs de langue française en Amérique du Nord, par Réginald Hamel, John Hare et Paul Wyczynski, Fides, Montréal, 1989, p. 458 (entrée « Dugas, Joseph Euclide Marcel […]).
7. Dictionnaire des littératures française et étrangères, sous la direction de Jacques Demougin, Larousse, Paris, 1992 (2e édition), p. 475 (entrée « Dugas, Marcel »). En 11 lignes, l’article entasse erreur sur erreur, en présentant notamment Dugas comme seul « fondateur de la revue », et ce, « en 1916 ».
8. Le Nigog, op. cit., p 220.
9. Valdombre (pseudonyme de Claude-Henri Grignon), « Les ‘Trente arpents’ d’un Canayen ou le triomphe du régionalisme », dans Les Pamphlets de Valdombre, vol. III, no3, février 1939, p. 104.
10. Les soirées de l’École littéraire de Montréal, Proses et vers, Imprimerie L’Éclaireur limitée, Beauceville, 1925, p. 117 et suivantes, 124-126 et 119 et suivantes respectivement.
11. Albert Laberge, sa vie et son œuvre, par Jacques Brunet, Éditions de l’Université d’Ottawa, Ottawa, 1969, p. 167.