Dans un paradis perdu en pleine nature sauvage de la côte est du continent américain, deux « vieillards » dans la quarantaine nourrissent, élèvent et surtout aiment leur nourrisson nommé Varian, arrivé dans leur vie alors qu’ils avaient renoncé à une progéniture depuis longtemps. L’éden est modeste, les plaisirs sont simples et satisfaisants.
En parallèle, et quelque vingt ans plus tard, l’arrestation arbitraire de Varian nous conduit aux portes de l’enfer dans un lieu jamais précisé, cependant que le palimpseste de Nancy Huston laisse deviner le nom d’une province canadienne, et même celui d’une ville : Fort McMurray, au nord-est de l’Alberta. En créant Le club des miracles relatifs1 avant le feu dévastateur, Huston a eu la vision prémonitoire d’un désastre lors de sa visite de la zone monstrueuse en 2014. Sur un ton acide, teinté d’une violence à peine contenue, son pavé est lancé dans la mare de la divine ambroisie.
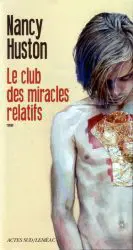 Si la poète transsubstantie en ambroisie – source d’immortalité des dieux – les sables bitumineux et l’extraction du pétrole plus sale encore que les autres, elle nous conduit presque de force dans cet endroit dit post-humain, néanmoins bel et bien réel. Un clic sur votre clavier suffit à vous convaincre de l’horreur des invasions barbares dans la chair terrestre pour y puiser cette ambroisie, jusqu’à épuisement du sous-sol et des hommes. Au bout du monde ? Non, au Canada, dans la province natale de la romancière qui martèle, l’indignation le disputant à la lucidité, que cette noire semence sacrée est vénérée en raison de « la cruauté illimitée de la cupidité humaine ».
Si la poète transsubstantie en ambroisie – source d’immortalité des dieux – les sables bitumineux et l’extraction du pétrole plus sale encore que les autres, elle nous conduit presque de force dans cet endroit dit post-humain, néanmoins bel et bien réel. Un clic sur votre clavier suffit à vous convaincre de l’horreur des invasions barbares dans la chair terrestre pour y puiser cette ambroisie, jusqu’à épuisement du sous-sol et des hommes. Au bout du monde ? Non, au Canada, dans la province natale de la romancière qui martèle, l’indignation le disputant à la lucidité, que cette noire semence sacrée est vénérée en raison de « la cruauté illimitée de la cupidité humaine ».
Ceux et celles qui s’approchent du trou du cul du monde – nom donné par le blogueur Jean-François Hotte dans un article remarqué sur la reconstruction de Fort McMurray – ne peuvent qu’y laisser leur âme, ou y trouver la mort. Il y a certes des poches de résistance, mais trop dispersées pour empêcher l’enfer de s’éteindre, ou seulement de s’étendre. Chacun est trop occupé à perdre sa vie à la gagner, car ici on ne travaille pas de neuf à cinq, mais de cinq à neuf.
La vision dantesque, tentaspectaculaire selon la romancière, des sables bitumineux se fusionne dans l’intérieur dissocié de Varian, pâle et frêle jeune homme qui parle de lui à la troisième personne. L’écriture cryptée, ses espaces silencieux plus ou moins longs tenant lieu de points ou de virgules et dont il n’est pas certain qu’on en découvre tout le sens, voire la richesse, traduit la pensée de Varian et de son univers ressemblant comme deux gouttes d’eau à celui d’un être enfermé dans un syndrome d’Asperger. À l’instar du personnage, l’écriture qui traque avec force et justesse sa psyché embrouillée garde son mystère à bien des égards.
Tête froide et volonté harnachée
Un deuxième regard sur le quatorzième roman de la prolifique écrivaine m’a convaincue qu’il ne logeait pas aux côtés des plus grands, Cantique des plaines et Instruments des ténèbres, ou L’empreinte de l’ange et Lignes de faille. Sans oublier le doux-amer Dolce agonia, dont chaque lecture fait découvrir une couche de sens, des détails suaves qui nous avaient échappé, l’affection de la romancière pour chacun de ses personnages qu’elle prend à bras-le-corps, par-delà ses faiblesses. S’il en a la complexité, il manque à ce dernier opus la fluidité qui rend celle-là quasi indécelable.
Ici, on perçoit la mise en chantier du roman et sa fabrication, ce qui en réduit la puissance. Mais n’est-ce pas là la volonté agissante de Huston, qui a voulu imprimer ce texte sur une solide base cartésienne ? La structure du roman, divisé en sept parties de quatre chapitres chacune, présente un ordre identique où 1) l’accusé Varian subit des tortures ignobles, 2) la narration effectue un retour à l’enfance et à la jeunesse de Varian, 3) l’on fait un détour par l’histoire d’une femme qui périra et 4) l’on s’immerge dans l’esprit à tendances psychotiques de Varian. Le cycle recommence six autres fois et chaque couche précise davantage la géographie noire de la libido de Varian, depuis ses vagissements d’enfant jusqu’à ses onze ans où s’entrechoquent les seins nus de Marie et une photo porno glissée dans son aube de communiant, événement qui signe l’amorce du rituel de l’auto-assistance (comprenez l’onanisme). Il sacrifiera sur l’autel de ses propres fluides jusqu’aux miettes de la dignité humaine pour atteindre des sommets de dopamine et d’endorphine. Cela ne lui suffira pas. L’empire des sens le mènera… au pire.
Dans les entrelacs de cette histoire de haine, haine de la Terre-Mère qui ne fait qu’une avec celle des femmes, s’écrit une amitié étrange qui ne survivra pas, étranglée par la noirceur des lieux et de celle de Varian. La poésie face à l’ambroisie, c’est David contre Goliath ; elle opérera un miracle bien relatif.
On remonte d’une plongée dans Le club des miracles relatifs comme de n’importe quelle œuvre de Huston, la tête remplie de questions, secouée par les liens tressés entre le quotidien et le politique. Encore ici, les recherches rigoureuses s’enorgueillissent d’une grande culture, et le travail ambitieux sur le texte, dont plusieurs percées dans une novlangue, requiert une attention scrupuleuse pour en saisir la densité et la portée.
1. Nancy Huston, Le club des miracles relatifs, Actes Sud, Arles/Leméac, Montréal, 2016, 294 p. ; 32,95 $.











