Le plongeur1 est ce roman qui a raflé au printemps 2017 un Prix des libraires amplement mérité. C’est aussi et surtout le récit brillant d’un épisode trouble dans la vie de Stéphane, un étudiant en graphisme au cégep du Vieux Montréal et dont l’homonyme, Larue celui-là, a confessé ailleurs le fond de vérité biographique.
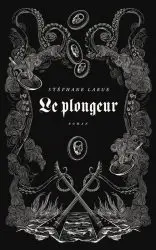 À première vue, le narrateur se présente pourtant comme un jeune homme sans histoire, avec ses incertitudes et ses errements, quelque peu démuni de repères, il est vrai, dans ce processus tâtonnant qui consiste à apprivoiser la vie adulte. Natif de Longueuil de parents tout aussi sans histoire, amateur de métal hurlant doublé d’un aficionado de bandes dessinées, il déménage à Montréal afin d’y poursuivre, tranquille, ses études collégiales.
À première vue, le narrateur se présente pourtant comme un jeune homme sans histoire, avec ses incertitudes et ses errements, quelque peu démuni de repères, il est vrai, dans ce processus tâtonnant qui consiste à apprivoiser la vie adulte. Natif de Longueuil de parents tout aussi sans histoire, amateur de métal hurlant doublé d’un aficionado de bandes dessinées, il déménage à Montréal afin d’y poursuivre, tranquille, ses études collégiales.
Rien ne le destine donc à sécher ses cours pour se mettre à rechercher, coûte que coûte, l’espèce de réconfort malsain que lui procurent les appareils de loterie vidéo : « J’avais une sorte de best-of mental de mes séances devant la machine, les journées magiques, les gains, les vertiges, les séquences qui te sortent de ton corps, mais je savais déjà que ce petit répertoire mentait comme un arracheur de dents. C’était plus fort que moi. J’allais me refaire la prochaine fois ». Stéphane joue ainsi ses économies engrangées durant l’été, faisant chaque fois mine d’ignorer que, plus haut monteront les gains, plus dure sera la chute.
Puis les mensonges et les dettes s’accumulent à mesure que se soustraient les amitiés : quelques centaines de dollars prêtés par Marie-Lou, plusieurs mois de loyer impayés à son colocataire et quelque deux mille dollars à Deathgaze, un groupe de métal lui ayant confié la confection de leur jaquette de disque, le forcent à se prendre en mains. Dans le but de se remettre à flot et sur les recommandations d’une connaissance, le joueur pose sa candidature pour le poste de plongeur d’un restaurant branché. Il y découvre un univers parallèle que même ses fanzines de fantasy étaient loin de soupçonner.
Hell’s kitchen
La Trattoria est un établissement d’inspiration italienne où tout brille, des comptoirs jusqu’aux lustres en passant par les dents scintillantes des serveuses. Or, une fois traversé ce décor enveloppant et franchi le passe-plat, on tombe en quelque sorte de l’autre côté du miroir. Dans la chaleur et l’humidité placentaires d’une cuisine survoltée, une sorte de grosse famille dysfonctionnelle se présente au nouveau venu. Bébert, le cuisinier bienveillant au sourire gâté, se dresse comme le capitaine halluciné de cette nef des fous qui souvent tangue et prend l’eau, mais jamais ne coule ; il y a aussi Greg, le busboy aux airs de truand qui finira par payer cher le prix de ses combines louches, Bonnie, la petite punkette de l’Ontario, Bob, Séverine et les autres. Tous feront la connaissance de ce narrateur introverti qui se démène comme un diable chaque soir de travail pour se sortir de son bourbier.
« Ma nouvelle job », confie-t-il, « [c]’est comme de travailler dans un dépotoir pendant que les trucks viennent déverser les vidanges ». Malgré la symphonie assourdissante des cris et des insultes qui fusent, des chaudrons et des casseroles qui s’entrechoquent, le plongeur trouve paradoxalement une espèce de sanctuaire lénifiant entre les quatre murs de La Trattoria. Enterré sous des montagnes de vaisselle sale et de restants de nourriture rapportées avec un luxe de détails, il fait littéralement le vide, ne pense ni à sa dépendance, ni à ses dettes, ni à toute sa vie qui fout le camp un peu plus chaque jour. En compagnie de ses collègues, Bébert en tête, il est aussi rapidement initié à ce petit rituel de fin de soirée qui consiste à sortir après les shifts, afin d’évacuer la tension, de redescendre tranquillement des montées d’adrénaline tout en faisant le plein d’alcool.
Un zoo la nuit

L’une des facettes les plus admirables de l’écriture de ce premier roman réside dans la capacité de l’auteur à recréer les ambiances les plus électrisantes ainsi que leurs effets sur son narrateur. À ce compte, les scènes de jeu, de spectacles de métal, les envolées saisissantes de réalisme sur les rushes d’une cuisine sous haute pression et les descriptions de Montréal offrent plusieurs lignes magistrales qui font appel à tous les sens du lecteur. La ville, plus qu’une toile de fond, est d’ailleurs l’un des personnages principaux du roman. Dans le concert des pots d’échappement, la métropole dévoile une grisaille curieusement belle, avec ses pawnshops ternis, ses salons de massage à trois mains et ses tavernes qui sentent la bière éventée et le tabac – l’histoire se passe au début des années 2000.
Le plongeur n’est pas que le récit de la dérive d’un être dans une mer de solitudes égarées, c’est également la chronique du noctambulisme montréalais, de la faune des bars, branchés comme clandestins, et des afterhours qui battent leur plein quelque part dans un condo louche de l’île tandis que la ville dort, d’un seul œil toujours. Partout, à chaque page ou presque, résonne le chant de l’urbanité trash, celle des petits dealers de Berri, des serveuses fatiguées, des bouncers édentés et des chauffeurs de taxi polyglottes. Puis quand ses enseignes éclairent la nuit d’un hiver interminable et que ses mille lumières hypnotisent les passants, on croirait que Montréal se transforme elle-même en appareil de loterie vidéo.
Refaire surface
Ce mode de vie n’a rien pour éloigner l’étudiant du vice. Les sorties, les soirées bien arrosées passées à proximité du champ d’attraction qu’émet sa némésis, forceraient la plus vaillante des volontés : « J’étais captif d’un bolide scellé hermétiquement qui filait vers le ravin », constate Stéphane, en parfait et impuissant spectateur de sa propre descente aux enfers. Après mille rechutes, autant de promesses rompues et une transaction de drogue pour le compte de Greg qui tourne au vinaigre, le plongeur touche véritablement le fond lors d’une nuit de misère au casino. En quelques heures seulement, il perd cette fois plus de deux mille dollars, la totalité de l’argent destiné à rembourser les membres de Deathgaze.
Toucher le fond donne parfois l’impulsion nécessaire pour s’en sortir. Ce coup-ci, il n’en est rien. N’eût été le bon secours de son cousin Malik, qui le prend littéralement sous son aile, le ramène de force à Trois-Rivières et le garde sous sa haute surveillance durant plusieurs mois, Stéphane n’aurait peut-être pas pu raconter sa singulière plongée dans les abîmes de la dépendance. À bout de souffle, celui-ci refera peu à peu surface, au terme d’une turbulente période d’angoisse : il faut, après tout, survivre au naufrage afin de raconter son histoire. Car ce roman doté d’une rare puissance d’envoûtement repose en entier sur un long retour en arrière, déclenché au moment où un Bébert inchangé apostrophe dans la rue, plus de dix ans après les événements narrés, le narrateur qui semble désormais en paix avec toute cette affaire. C’est là la preuve que décrocher a enfin été le choix le plus payant.
1. Stéphane Larue, Le plongeur, Le Quartanier, Montréal, 2016, 568 p. ; 31,95 $.
EXTRAITS
Dans les neuf cases, les symboles commençaient à s’immobiliser. Les 7 se sont multipliés, j’en comptais deux, trois. Une cerise, qui bonifierait les gains. Un autre 7, puis un cinquième. Une bouffée de chaleur a irradié tout mon corps. Mes conjonctives ont épaissi et mes globes oculaires pulsaient derrière. Le poil sur mon bras s’est dressé.
p. 164
Le grésillement des viandes, de l’ail et des oignons dans l’huile des poêlons, le crachotement du vin de cuisson ou de la crème dans les sauteuses brûlantes, le souffle de la hotte, les ordres en franglais que tous se donnaient formaient un vacarme qui rendaient fou si on y restait prisonnier plus que cinq minutes, contourné ou poussé sans ménagement par les cooks.
p. 246-247
On aurait dit que d’avoir fait de l’ordre dans ma vie, de passer plus de temps seul, tranquille, avait éloigné de moi l’envie de jouer. Je n’étais pas guéri. Mais je savais que ça irait. C’était déjà ça. Je faisais ce qu’il fallait, jour après jour, pour que ça aille. Aujourd’hui je sais que sans l’aide de Malik, je n’y serais jamais arrivé.
p.554











