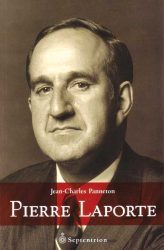De Pierre Laporte, le biographe Jean-Charles Panneton et son préfacier Gilles Lesage sont tentés de dire : la vie de cet homme a été effacée par sa mort. Ils auraient raison. Les carrières de Laporte, celle du journaliste comme celle du politique, ont été voilées par son meurtre.
Il était donc temps de révéler le vivant qu’il fut et de ne plus faire d’une victime un être infréquentable. Cette biographie1 honore un journaliste fringant et un politique inventif, elle ne dissimule pourtant pas le côté primesautier du personnage.
Tôt en marche
Si Pierre Laporte hésita entre divers métiers, le flottement disparaît vite : il sera avocat. Et cet avocat entend s’investir dans tous les plaidoyers qui lui paraîtront requis. Puisqu’il appartient à l’équipe de l’Université de Montréal qui triomphe lors des joutes oratoires en vogue à l’époque, Pierre Laporte en affiche le souvenir dans le Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992 : « Récipiendaire du trophée Villeneuve ». Message net : l’avocat se veut tribun. Tirons une autre conclusion des textes signés Laporte dans Le Quartier latin et de ses activités à la Faculté de droit : l’auteur ne se destine pas à l’anonymat. Chemin faisant, il tâte du journalisme professionnel, d’abord au Canada, puis au Devoir. Nous voici en 1944 et Laporte a 23 ans.
Plusieurs fers au feu
Le Devoir de l’époque menait plusieurs combats. Au Québec et ailleurs. Dans les Prairies comme en Nouvelle-Angleterre, les îlots francophones recevaient les pèlerinages du Devoir ; Laporte y était. Il prêtait le même concours aux Amis du Devoir. Panneton note cette durable ubiquité : « Pierre Laporte donne plusieurs conférences durant les années 1950 lors d’événements organisés par l’Ordre de Jacques-Cartier ; il occupe même la fonction de secrétaire aux médias en 1961. Laporte s’engage dans le Comité de moralité publique ; il occupe aussi les fonctions de secrétaire et président de la section Côme-Cherrier de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, et il est membre de l’exécutif de l’Union des Latins d’Amérique ». Journaliste, oui, mais présent partout. Laporte n’est ni un contemplatif ni un cerveau laser. Panneton en témoigne, Laporte a l’énergie d’une dynamo et les ambitions d’un conquérant.
Laporte passe pourtant à une vitesse supérieure en 1948 quand Le Devoir le nomme correspondant parlementaire à Québec. À peine en poste, il ose sa première enquête : la fonction publique est mal traitée par le pouvoir. De quoi agacer un Duplessis attaché à ses dictées du vendredi. Quand Laporte ajoute à ses comptes rendus ses Lettres de Québec, la collision devient inévitable. D’autant plus que, « dans ses Lettres de Québec, Laporte s’aventure souvent, par ses explications, sur le terrain de l’analyse et de la critique ». Ajoutons que les cumuls courants à l’époque pesaient lourd. Qu’on en juge : « Le correspondant du Devoir rapporte les propos d’André Laurendeau, alors député de Montréal-Laurier et rédacteur en chef adjoint du Devoir, qui donne la réplique à Maurice Duplessis ».
Le virus électoral
Pierre Laporte n’avait pas attendu Laurendeau pour se sentir une vocation politique. Dès 1956, il est candidat indépendant dans Montréal-Laurier. Défait, « Laporte, qui milite activement dans le Comité de moralité publique, décide de se porter candidat de l’Action civique aux côtés de Jean Drapeau ». Il signe néanmoins « deux éditoriaux en lien avec la campagne électorale municipale ».
Saisi du virus politique, Laporte est candidat libéral dans Chambly en 1961. Ce troisième essai est le bon. Aisément réélu en 1962, il devient ministre des Affaires municipales. Deux ans plus tard, il est chargé des Affaires culturelles, avant de devenir leader parlementaire du gouvernement. De retour au pouvoir après l’intermède unioniste de 1966, il retrouve son poste de leader parlementaire et dirige le ministère de l’Immigration et celui du Travail et de la Main-d’œuvre. Sur chaque front, montre Panneton, Laporte est fiable, rassurant, inventif. Lors de la course à la direction du PLQ, Laporte sera pourtant devancé par Bourassa et Wagner. Il encaisse le choc si bien que Panneton ne décèle chez lui aucune bouderie. Tout au plus le verra-t-on, pour un motif obscur, appuyer en 1968 la candidature de Pierre Elliott Trudeau à la direction du PLC.
Audace et débordement
Peut-être Pierre Laporte paraîtrait-il encore plus polyvalent (et dispersé ?) si son biographe s’en était tenu à la chronologie. Ce n’est pas le cas. Ainsi, Panneton isole le séjour de Laporte à L’Action nationale ; le lecteur risque d’oublier que Laporte demeure, malgré ce mandat, journaliste au Devoir et happé par mille chantiers. En 1956, il est courriériste parlementaire du Devoir, directeur de L’Action nationale et candidat indépendant bénéficiant d’un pacte de non-agression avec les libéraux ! C’est beaucoup. Certes, l’époque permet les cumuls (les députés-maires étaient nombreux), mais Laporte, franc-tireur par réflexe et par conviction, cultive la polyvalence jusqu’à nier les frontières. Il concilie malaisément son passé de militant nationaliste et son adhésion fervente au fédéralisme de Trudeau. S’il lui faut un pseudonyme pour participer à une campagne, il recourt à l’astuce. Il n’est pas non plus toujours prudent dans ses fréquentations, se sachant de taille à affronter la critique. Rançon d’une surabondance de ressources.
Grâce à Panneton, Pierre Laporte ne se résume plus à une mort spectaculaire et injuste : il reçoit enfin le crédit que méritent ses enquêtes journalistiques et un bilan politique plus que respectable. Une nouvelle édition corrigerait les lapsus qui déparent l’ensemble. L’île Jésus a tantôt douze municipalités, tantôt quatorze ; « Laporte ne laisse pas laisser passer cette chance » ; « Laporte l’emporte avec 22 641 voix contre 14 368 pour Pierre Marois, soit une majorité de 11 673 voix »…
1. Jean-Charles Panneton, Pierre Laporte, Septentrion, Québec, 2012, 454 p. ; 29,95 $.
EXTRAITS
Laporte se fera également très dur à l’égard de la politique fiscale du gouvernement du Québec. Il écrit plusieurs articles pour dénoncer l’invasion fiscale détestable, ce qui indispose au plus haut point Maurice Duplessis.
p. 85
À partir du 10 mars 1956, c’est sous ce pseudonyme [de Louis Lefebvre] qu’il publie une série d’articles sur la campagne électorale dans les pages du journal Vrai. Jacques Hébert, le directeur du journal, se montre plutôt critique à l’égard du travail journalistique de son ami Laporte.
p. 121
Laporte annonce ainsi qu’il appuie Trudeau : « Par respect pour l’intelligence des Québécois, par respect pour un homme qui affiche franchement ses idées, même si je ne les accepte pas toutes, je voterai Trudeau le 25 juin. Car c’est encore par nos votes que nous pourrons le plus efficacement abattre les vautours qui planent sur le Québec ».
p. 347