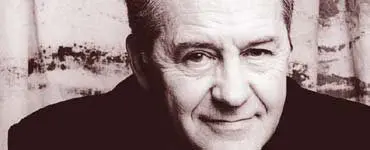Seconde rétrospective poétique de Paul-Marie Lapointe, L’espace de vivre résume une vaste enquête sur l’art, le langage et le territoire mexicain. Entre les mots et les choses, est-il si nécessaire de choisir ?
En 1971, la rétrospective Le réel absolu de Paul-Marie Lapointe mettait en évidence l’ampleur et l’originalité d’une œuvre amorcée en 1948. En plus des désormais classiques Choix de poèmes et Pour les âmes, l’ouvrage offrait à un plus large public Le vierge incendié, premier recueil publié peu après Refus global chez Mithra-Mythe. Une déflagration surréaliste que Claude Gauvreau avait prestement portée aux nues, se faisant en quelque sorte le parrain de cet adolescent venu du Lac-Saint-Jean. Très espacés dans le temps, les recueils subséquents ouvriront un éventail très varié, où l’expérimentation langagière et la révolte à l’état brut se raffineront dans une proposition plus humaniste, à l’écoute des réalités québécoise et mondiale sans sombrer dans la grandiloquence ou l’élitisme.
Avec la somme qu’est L’espace de vivre, Poèmes 1968-20021, seconde rétrospective aux éditions de l’Hexagone, l’éventail tend à devenir galaxie, tant s’est diversifié ce balancement inventif entre les sons, le sens, les êtres et l’espace. De Tableaux de l’amoureuse (1974) à Espèces fragiles (2002) en passant par le gigantesque laboratoire d’écRituREs (1980), Lapointe a cartographié les possibles durant un quart de siècle, défiant la séparation superficielle entre le réel et l’imaginaire, trouvant partout matière à exprimer ses états comme ceux du monde qui l’entourait.
Itinéraires et déroutes
Comptant tout près de 650 pages, l’honorable pavé comprend aussi quelques inédits, dont « Les soleils », poème de 1959 qui figure en début d’ouvrage, « Salut, Roland Giguère », de 1968, ainsi qu’une surprenante « Transfiguration d’un nô par la télévision ». D’importants textes en prose publiés en revue ou dans des ouvrages collectifs sont aussi présents, lesquels explicitent judicieusement la perspective poétique de Paul-Marie Lapointe. Dans « Poésie sociale et morale » de 1960 par exemple, ce dernier refuse la compartimentation de la poésie. Jugeant qu’une littérature authentique transcende les étiquettes, il suggère aussi que cette authenticité fasse foi de son véritable engagement. « Je dirai, dans cet esprit, qu’est sociale toute poésie assumée charnellement et qui, par construction ou destruction, vise à la transformation du monde (et de l’homme), ce qui caractérise, à la fin, la motivation de toute véritable poésie et la distingue de l’amuse-gueule, de la rimaillerie et de la rêvasserie pâmoisante. » La libération des mots va de pair avec celle des humains, sera-t-il dit à quelques reprises, ce que résume cette équation tirée des « Fragments/illustrations » de 1977 : « Transformer le discours = changer la vie ».
Une des pièces de résistance de ce parcours est sans contredit Tableaux de l’amoureuse, suivi de Une, unique, Art égyptien, Voyage et autres poèmes, recueil de 1974 à travers lequel la poésie de Paul-Marie Lapointe empruntait une trajectoire encore plus proche des arts visuels. À partir de tableaux et d’objets divers, le poète entremêle la description et les jeux d’association, ce qui donne une intensité nouvelle à son verbe même s’il délaisse sa tendance à l’improvisation. C’est ce que remarquait Pierre Nepveu dans son essai Les mots à l’écoute, tout en soulignant l’interdépendance des différents recueils de Lapointe, entre autres par cette faculté – tel le Voyant des Illuminations – de décrire sur un ton profondément objectif les réalités les plus imaginaires.
« Le réalisme de l’irréel » et le ludique
« Cette poésie, écrit Pierre Nepveu, n’est obscure que si l’on cherche à y retrouver ‘l’ordre des choses’, le donné extérieur. Dès que l’on a accepté que tous les niveaux de réalité peuvent s’entremêler, le texte devient, dans son propre ordre, extrêmement limpide […]. En somme, on obtient une figuration au second degré, une sorte de réalisme de l’irréel ou de l’impossible2. » Encore aujourd’hui, Paul-Marie Lapointe soutient sans équivoque cette porosité des degrés de réalité : « Je suis, dit-il, contre les attitudes fermées, qui séparent le cerveau et les sens, la poésie et les autres arts3 ».
Le plus grand défi que cet homme ait lancé aux esprits fermés demeure sans doute le diptyque expérimental écRituREs, qui parut aux éditions de l’Obsidienne4 tout comme les tirages limités de Bouche rouge et Tombeau de René Crevel (publiés en 1978 et aussi inclus dans la rétrospective). En deux tomes volumineux, Lapointe rassemblait alors des centaines de pages de « mots croisés » poétiques, cousins éloignés du calligramme et de l’explosion sémantique du Coup de dés mallarméen. De ces jeux radicalement libres, où les mots prennent entièrement le pas sur la représentation du vécu, on a retenu pour L’espace de vivre quelques dizaines d’exemples illustrant leur variété.
Après cette expérience des limites, il fallut pas moins de dix-huit ans avant que Paul-Marie Lapointe ne publie à nouveau. Une synthèse importante est cependant atteinte avec Le sacre, en 1998, alors qu’il ancre son amour des jeux verbaux dans un contexte bien déterminé, en déclinant les lettres et les phonèmes du mot tabarnacos (désignation cocasse des touristes québécois) dans des poèmes rédigés pour la plupart au Mexique. L’expérience presque sportive des mots semble ainsi se réconcilier avec une présence au monde plus incarnée.
D’une rigueur frôlant le délire, les textes du Sacre empruntent la gamme entière des figures de style, faisant du simple tabarnacos un prisme infini grâce au libre jeu de ses sonorités. Couplant des portions du territoire mexicain à des constellations inventées, le poète nomme par exemple ces étoiles imaginaires avec diverses anagrammes du sacre initial (Tocabarans, Acatapec, Narcotabas, Anabastroc), jusqu’à entraîner soit le vertige soit le fou rire. C’est d’ailleurs ce à quoi nous préparait la préface, d’une ironie impeccable : « Bientôt et pour toujours, los Tabarnacos nous désigna tous, Québécois, blancs humains venus du froid. Produit culturel brut, mais inépuisable de sens et de sonorité, le tabarnac est une déflagration de phonèmes, le sacre parfait ».
Par sa virtuosité ludique, Paul-Marie Lapointe s’inscrit autant dans la lignée des Grands Rhétoriqueurs du XVIe siècle que des poètes de l’Oulipo, qui partagèrent le souci d’explorer pleinement le potentiel de leur langue, à coups de palindromes, d’acrostiches, de paronomases ou de coq-à-l’âne. Mais comme en témoignent les textes les plus récents (dont le discours de réception du Prix Gilles-Corbeil et le recueil Espèces fragiles), l’inquiétude devant la marchandisation planétaire ne quitte pas le joueur, toujours rempli d’empathie pour les millions de « petits hommes » et d’enfants qu’on veut uniformiser – opération contraire à celle de la poésie. Convoquant le lecteur à l’exercice de sa propre singularité, ce langage au sens multiple est vraiment L’espace de vivre, ou, du moins, un pressentiment de ce que peut signifier la liberté.
1. Paul-Marie Lapointe, L’espace de vivre, Poèmes 1968-2002, L’Hexagone,Montréal, 2004, 648 p. ; 34,95 $.
2. Pierre Nepveu, Les mots à l’écoute, Poésie et silence chez Fernand Ouellette, Gaston Miron et Paul-Marie Lapointe, Nota bene, 2002, p. 330.
3. Propos recueillis dans le cadre d’un entretien qu’il m’accordait l’an dernier pour le journal Le Devoir.
4. Fondées par Paul-Marie Lapointe et son épouse Gisèle Verreault afin de diffuser leurs projets les plus atypiques, les éphémères éditions de l’Obsidienne firent également paraître des livres de Guido Molinari, Fernand Ouellette et Robert Melançon.
Paul-Marie Lapointe a publié :
Le vierge incendié, Mithra-Mythe, 1948 et Typo, 1998 ; Choix de poèmes : Arbres, L’Hexagone, 1960 ; Pour les âmes, L’Hexagone, 1965, 1966 et Typo, 1993 ; Le réel absolu, poèmes 1948-1965, L’Hexagone, 1971 et Typo, 1998 ; Tableaux de l’amoureuse suivi de Une, unique, Art égyptien, Voyage & autres poèmes, L’Hexagone, 1974 ; Bouche rouge, L’Obsidienne, 1976 ; Arbres, Éditions Erta, 1978 ; Tombeau de René Crevel, L’Obsidienne, 1979 ; écRiturEs, L’Obsidienne, en 2 volumes 1980 ; Le sacre, Libro libre para Tabarnacos libres, Jeux et autres écritures, L’Hexagone, 1998 ; Espèces fragiles, L’Hexagone, 2002 ; L’espace de vivre, poèmes 1968-2002, L’Hexagone, 2004.
EXTRAITS
Il s’agit de retrouver cette voix qui fut, à une certaine époque, celle d’un individu mais devint par la suite la substance même de l’air du temps, la respiration des hommes, l’explication de leur permanence, de leur volonté de naître les uns après les autres, de créer et de procréer.
Il s’agit de recréer le monde, au jour le jour, sans quoi il sombrerait dans le chaos, de recréer le monde, homme par homme, de vaincre la mort par la continuité des vies et d’autant plus qu’elle diffère et prend à la précédente une part de ce qu’elle donne à la suivante.
Ainsi le poème doit-il être.
« Notes pour une poétique contemporaine », L’espace de vivre, p. 609.
que figurent le poudroiement des pastels
l’effritement des schistes et l’érosion de l’or ?
dans cette toile de verre habitée par le givre
où les étoffes calcinées
les gouffres s’ourlent de cendre
« Tableaux de l’amoureuse », L’espace de vivre, p. 18.
mille amoureuses m’extraient de la mort
me tirent de la terre
mille amoureuses toujours la même
l’automne elles s’envolent de moi
puis réapparaissent
avec les feuilles
« Une, unique », L’espace de vivre, p. 51.
Ta barre n’a qu’os
[…]
La clé des tabernacles
à la taberna s’éclata
et le Tabarnacos
au torse d’Abénaki
s’y bâta de l’éternel cabas.
Aux cieux aberrants
s’étalent, calebasses ou reliques
baroques, des catins écartelées.
« Le sacre », L’espace de vivre, p. 259.
Milliers et millions et milliards de fourmis, dans les siècles des siècles… // Et toujours la même agitation appliquée, sans questionnement apparent, en toute soumission. Interminablement. Chez ces fourmis-là, il n’y a pas de gènes pour la révolte, la révolution, la transformation du monde. On fonctionne vite, en silence, avec application, jusqu’à la mort sous un talon quelconque. […] // Mieux vaut donc se taire. Et que ça bouge ! Et que ça saute ! Au travail, fourmi, petite fourmi, infime fourmi ! Tout reste à faire ! Interminablement. Silencieusement. Jusqu’à la fin des temps.
« Espèces fragiles », L’espace de vivre, p. 537-538.