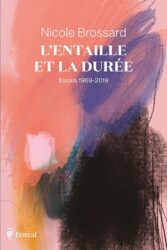Pourquoi ne pas l’avouer ? Je suis intimidée. Certes devant l’œuvre littéraire, mais tout autant devant l’engagement profond et soutenu de Nicole Brossard à l’endroit de la parole femme.
Dans L’entaille et la durée1, le fil rouge de sa pensée traverse un demi-siècle, de 1969 à 2019, selon une quarantaine d’essais tirés d’un corpus initial de quelque 300 titres. À ce jour, la seule anthologie de la pensée de Brossard publiée l’a été en anglais, en 2005. Le doigté et l’intelligence du travail de Karim Larose et Chloé Savoie-Bernard, qui ont colligé les textes, comblent avec bonheur cette absence.
Au commencement du verbe femme
Dès ce commencement, Nicole Brossard met à nu une vérité crue et cruelle. Ce verbe femme s’inscrit hors de l’histoire, sa parole subordonnée à l’histoire patriarcale. Pragmatique, elle écrit que la femme qui a beaucoup lu glissera naturellement dans le jeu prescrit. « Toute son information se trouvant issue ou liée à une filiation d’œuvres inscrites dans un monde de pensée masculine, elle analyse, décode, joue, devient conséquente avec l’univers littéraire qu’elle a acquis. »
Devant la révélation de l’interdit posé sur le féminin et l’effervescence du mouvement des femmes, elle signe en 19752 un texte fondateur où l’entaille est reconnue, cette fracture de l’ordre et de la norme littéraires suivis pendant dix ans. « Tout était à revivre, à repenser, à explorer. »
La fulgurance de la rencontre avec « la matière inflammable » de ses lectures féministes n’a d’égale que la ferveur qui depuis l’anime, dynamise son travail, et attise son feu poétique. Elle n’aura alors de cesse de décrypter le sens et les conséquences d’écrire je suis une femme. Sous ses yeux, le E muet mutant se débat pour enfin émerger du magma masculin et de son assignation des femmes au silence, se déploie ensuite sur un terrain vaste, là où « [l]es mots sont huileux, sur la vague qui meut, meurt et ment passionnément avec tous les alibis de la passion ». Quand survient l’étape cruciale de l’éclat du sens, le choix de celle qui se donne/s’abandonne à l’écriture peut s’achever dans une camisole de force ou dans une œuvre. « […] c’est ici que nous laissons nos défroques de femmes fragmentées pour devenir intégrales. »
Le sexe du texte
À ce moment-là de notre jeune histoire, les femmes ont soufflé dans les pages des gens du texte, souffle qui a forcé ceux-ci à se relire à temps en déplaçant le propos/la pertinence du propos, soutient l’essayiste. Déjà en 1978, elle appelait à faire basculer le masculin du neutre ; en d’autres termes, à évider du neutre ce masculin que l’on saisit toujours d’emblée. Quelle tâche elle nous a assignée ! Quarante-cinq plus tard, nous n’y sommes pas encore parvenues, et ce n’est pas faute d’avoir trimé fort. Notre langue est bourrée de mines antipersonnel.
Depuis ce temps révolutionnaire, les avancées des femmes sur les scènes sociale, politique, scientifique ou artistique sont, à maints égards, remarquables. Aussi remarquables que la flambée des exactions agitant la sphère privée, c’est-à-dire le corps sexué. Le retour du bâton dans l’intime, le privé, ce corps sexué est foudroyant. La naissance de multiples groupes masculinistes, les Incels notamment, en porte témoignage, tout comme l’explosion des féminicides.
Nicole Brossard savait-elle, en gravant cette phrase-icône, « Le privé est politique3 », qu’elle se ferait encore plus visionnaire au siècle suivant, alors que le privé n’aura jamais été aussi politique. Le corps féminin du travail avance, se taille un territoire inimaginable il y a quelques décennies à peine. Mais ce qu’il gagne de haute lutte en espace, voire en crédibilité, le corps sexué semble en être encore et toujours dépouillé. Privé. Voilà pourquoi le mouvement #MoiAussi en serait un, à maints égards, de désobéissance civile, lequel depuis octobre 2017 n’a cessé d’ébranler les colonnes du temple masculiniste. Il y a 40 ans, la féministe radicale Nicole Brossard l’avait présagé. « Nous souhaitons que chaque femme dise le scandale de sa vie, fasse un scandale public et qu’elle se détourne d’un pouvoir qui lui vole intimement et socialement le droit d’exister souverainement pour elle-même et ses propres désirs. »
Les textes du passé de la poète/essayiste/romancière résonnent dans le flot de nos dérives du présent, celles indénombrables du refus du patriarcat d’obtempérer. Fallait-il être naïves, ou idéalistes, ou enthousiastes, ou les trois à la fois pour croire que les hommes renonceraient à leurs privilèges et consentiraient à partager le pouvoir avec l’autre moitié de l’humanité !
Une langue cul par-dessus tête
Un constat primal de Brossard : les femmes sont illettrées, c’est-à-dire lettrées par il. Aussi n’est-il pas surprenant qu’elles parlent avec un accent cette langue étrangère masculine. On imagine, dans son laboratoire d’écriture, la poète essayiste penchée sur ses fioles d’encre, ses éprouvettes et pipettes de papier, qui questionne sans relâche, examine, déconstruit, analyse, cherche les particules élémentaires, évalue la solidité de la théorie à la mode, mesure jusqu’au vertige l’égarement des femmes dans ce monde qui leur est si hostile, prend acte du désir et du plaisir du texte qui s’écrit, pour in fine élaborer la formule et en semer partout dans ses écrits. À regret de n’en citer qu’une parmi tant d’autres : « si le patriarcat est parvenu à ne pas faire exister ce qui existe, il nous sera sans doute possible de faire exister ce qui existe ».
Le délit syntaxique ou lexical plausible et l’écart sémantique, qu’elle affectionne, s’inscrivent quelquefois dans de subtils changements de niveaux de langue, fleuretant avec des expressions populaires. « la prose frenche plus longtemps que la poésie. la prose finit ses phrases. LA PROSE A DES MANIÈRES. » Ou s’amusant de son arrivée sur cette planète : « Un accouchement difficile où je finis par me présenter irrévérencieusement en ce monde, c’est-à-dire par le cul ». De passion à raison, « l’art élabore ses arguments d’ardeur et de beauté », tout en échappant aux ruses du sexe patriarcal.
Le politique, toujours
Visible ou dissimulé dans les sèmes, ces unités minimales de sens, le politique se fait cartésien, amoureux, rêveur, souvent courroucé. Duras aurait dit « des colères politiques fortes comme la foi en Dieu ». Nicole Brossard fustige les je du corpus textuel que le capitalisme a réduit à l’état de nain. Peu avant le premier référendum sur l’indépendance du Québec, elle constate jusqu’à quel point un parti politique peut flatter « les femmes dans le sens de l’utérus » et ainsi « redorer le blason de leur maternité » pour les utiliser à leurs fins, comme le furent les Yvettes.
En 1985, en reconnaissant que le féminisme québécois est « droit », « d’aplomb », elle pose une question toujours d’actualité. « […] le féminisme nous mène-t-il là où nous devons absolument aller, c’est-à-dire dans un avenir où le phallocentrisme, la misogynie et le sexisme n’auront plus cours systématiquement ? » De la dualité de la pensée féministe, oscillant entre l’inclusion et l’exclusion – ce qui n’est pas sans conséquences sur la cohérence de nos propos, précise-t-elle –, Nicole Brossard explique : « En somme, c’est par la nature même de ses prétentions humanistes que la pensée féministe se voit en quelque sorte forcée d’accorder aux hommes non seulement une immunité ontologique, mais aussi la considération à laquelle a droit toute personne humaine ».
Son projet politique n’est jamais très loin du projet amoureux et y conjugue son verbe lesbien. Lesbien, mot presque enterré par la voix contemporaine des 2ELGBTQI+4, tandis que le saphisme a sombré dans l’oubli. Toujours est-il que les amours entre femmes portent un enjeu au-delà de la préférence sexuelle. Nicole Brossard intime ses semblables d’être aux aguets. « Une lesbienne qui ne réinvente pas le monde est une lesbienne en voie de disparition. »
La clarté politique de son propos jouxte, voire se fusionne à l’illisibilité poétique des mots. Pourtant, son art de si bien parler du sens et du son de la poésie saurait réveiller la plus tenace indifférence à son endroit.
Et cet à/venir ?
De ses textes plus récents sourd une inquiétude nouvelle devant le désenchantement ontologique des années 2000 et l’ultra-technicité de son univers, « ruinant à tout jamais ce bel humanisme et toute séquence de tendresse pouvant nous le rappeler ».
Nicole Brossard est une écrivaine du présent. Le défilement de sa pensée dans la durée de l’entaille le confirme. En son cœur gît une leçon de rigueur intellectuelle devant même l’insolite et la magie de l’écriture. « Écrire, ce n’est jamais comprendre et toujours chercher à comprendre. »
La lecture de ses essais renforce le désir d’extirper le noyau dur de la misogynie et de garder foi en cette pensée qu’un supplément de féminin, comme on dit un supplément d’âme, dans notre civilisation profitera tant aux hommes qu’aux femmes. Elle re/donne de la hauteur à nos luttes, et de l’honneur à nos vies.
Conseils à qui côtoie pour la première fois la prose poétique de Nicole Brossard. Lire d’abord sa courte autobiographie, présentée au mitan du livre, qui nous révèle une femme vivante et vibrante, attachante, où la fête euphorise le je et enflamme la matière culturelle. Lire ensuite un texte après l’autre, en ordre chronologique ou pas, en s’octroyant des espaces de réflexion pour féconder notre esprit par les idées qui y foisonnent.
1. Nicole Brossard, L’entaille et la durée. Essais 1969-2019, Boréal, Montréal, 2023, 383 p.
2. Pour mémoire, mentionnons que dans le bouillonnement des années 1970, comme de nombreuses écrivaines, Nicole Brossard fréquentait la Librairie des femmes d’ici, à Montréal, deuxième librairie féministe francophone au monde, après celle de Paris ouverte en 1974, et premier lieu public de rencontre des femmes dans la métropole.
3. Expression qui a marqué la deuxième vague du féminisme (1968-1989) et dont, curieusement, aucune femme ne veut se voir attribuer la maternité, ni Carol Hanisch, ni Kerry Burch, ni Shulamit Firestone.
4. Sigle officiel du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres du Canada.
EXTRAITS
De tout temps, la censure s’est exercée contre les textes où le corps a été osé comme planche de jeu, de jouissance, de connaissance ou de salut. Contre ces textes l’index s’est dressé.
p. 45
La vie privée, c’est la vie du corps qui mange, qui dort, qui coïte, qui défèque, qui sue, qui touche, qui souffle, qui jouit. C’est l’histoire du corps retranché derrière les murs de la maison familiale, de santé, ou de réforme.
p. 49
La poésie est une intuition parfaite en sa naïveté qui dans la langue se transforme en évidence. La poésie est indiscutable.
p. 125
[C]ar aimer et élire le féminin comme un premier sujet d’intérêt, à travers l’image et la réalité d’une ou de quelques-unes que nous désirons sexuellement, est une transgression qui ouvre au cœur même de l’imaginaire patriarcal une brèche vitale.
p. 160
Nous [les femmes] savons que le pouvoir porte en lui les germes calculateurs de sa reproduction et de son autre dimension qu’est l’abus de pouvoir.
p. 189