Je n’ai pas pu lire ton deuxième roman. J’ai bien essayé dans une chambre d’hôtel de Sudbury pendant le Salon du livre, mais ça n’a pas marché. Je voulais le lire dans le bain comme je le fais dans toutes les chambres d’hôtel que je visite – toujours dans le bain, je te jure, une vraie farce – et… Et je n’ai pas pu lire ton deuxième roman. Je savais ce qu’il disait, je savais beaucoup de phrases que je voulais garder intactes dans leur rythme et avec les coupures qu’on avait faites pour la lecture publique. Celle dans laquelle j’ai joué, celle commandée en urgence et pleine de sens devant la mort ; la tienne, imminente.
Je ne le lirai sans doute jamais. L’esprit et les doubles sens m’échapperont comme les chansons cachées que j’ignorais ado, à la fin des CD, trop pressée de changer de toune. Je le garde flou en moi, ce qu’il raconte en gros, deux ou trois punchlines : « La poésie, c’est faire enter à tout bout d’champ. » Je ne l’oublierai jamais, celle-là.
Je ne regarde pas de vidéos, ni de photos vraiment, et cette chanson de Fanny Bloom composée pour toi me tombe parfois dessus sans que je le fasse exprès et tout s’arrête quand ça arrive.
J’ai mes petites affaires, mes rituels comme tout le monde, j’imagine. J’ai mon idée sur ton passage comme tout le monde aussi, j’imagine. J’ai l’impression qu’écrire me fait concrète, que le message se rend, que je sors de ma tête et du souvenir triste de ta parenté chantant la plus laide des chansons pour te rendre hommage. (C’était vraiment une horrible chanson.)
Je suis toujours mariée et je ne veux pas que ça change. Tu ne seras pas venue à mes noces pour rien. J’ai une maison et un enfant de plus ; une fille. Elle te ferait rire, je pense ; Catherine est la marraine. La vie va bien, les choses vont vite comme pour tout le monde, j’imagine.
Mais ton deuxième roman est là, dans ma bibliothèque, classé avec les autres du Quartanier – oui, je classe par éditeurs et collections, c’est vraiment juste pour flasher – et je ne veux pas qu’il se perde, qu’on l’abîme, je ne le prêterai jamais. C’est de l’égoïsme pur, mais c’est peut-être le seul livre que j’aurai gardé intact. Pas de pages gondolées, aucune trace de doigts, pas de coins repliés parce que je trouve un passage bon. Il est là, entre Arsenault et Nicol – je suis loin d’être à jour dans la « Série QR » –, pratiquement vierge.
Mais j’ai donné Testament à ma belle-mère un Noël, m’en veux-tu ? C’est ce qu’elle avait demandé et ça venait de me coûter 300 piastres de bebelles un jeudi soir de décembre, j’étais crevée raide et trop lâche pour faire un tour par la librairie. Je savais que j’avais un exemplaire en bon état. C’était l’exemplaire que j’avais acheté de toi à un déjeuner au Nord-Ouest pendant L’Off de Trois-Rivières. Il n’était pas signé. Je ne te l’avais pas fait signer.
Il arrive que je regrette de ne pas t’avoir demandé une dédicace et je me rappelle que c’était un déjeuner tardif avant lequel tu avais marché longtemps dehors, seule. Tu en étais encore capable à l’automne. Je dis l’automne sans préciser lequel parce que malade tu n’en as vécu qu’un. Un seul hiver aussi, un été et un printemps et demi. Tu venais de marcher longtemps dehors, seule, et je ne voulais pas t’écœurer. Et puis tu aurais écrit quoi ? Sans doute pas « Bonne lecture », mais quelque chose qui revient au même, un peu jazzé… Et je n’aurais pas pu être déçue parce que je fais tout le temps ça.
À Vickie,
Voici (insérez le titre du livre). J’espère que son histoire pourra se frayer un chemin jusqu’à toi ; merci de prendre ce temps pour mes mots.
Je me targue d’écrire une nouvelle affaire dans chaque exemplaire, ce qui n’est pas faux, mais je reste décevante un peu trop à mon goût.
Je pense que nos ami(e)s auteur(e)s ne lisent pas tous nos livres. Je pense que beaucoup s’arrêtent au premier. Ils ont vu ce dont on était capables, ils se sont comparés, se sont rassurés, ils nous ont fait quelques éloges enthousiastes et… Ça va. Quand tout le monde publie autour de soi, j’imagine qu’on en revient. En tout cas, moi j’en reviens ! Je n’ai pas lu le dernier de Mathieu, ni celui de Daniel Grenier, ni Virginie, ni la poésie de Maude Veilleux.
Je n’ai pas lu ton deuxième roman, mais je ne l’ai pas jamais feuilleté. J’ai vu une blague sur Laverdure… Elle n’était pas dans la version de la lecture publique.
Je porte souvent les boucles d’oreilles que tu m’as offertes après l’événement : des petites roses blanches. Je les ai reçues par la poste, mais j’ai oublié si c’était avant ou après ta mort. J’ai oublié et avant j’aurais trouvé ça terrible d’oublier, mais j’ai une famille et beaucoup de contrats et mille bonnes raisons pour ne plus me rappeler du moment précis où j’ai reçu cet ultime colis de ta part. Je me rappelle juste que j’avais bu. C’est bien assez pour toi, non ?
Mais quand je vais à un truc important, j’apporte ta sacoche rouge qu’on m’a donnée quand il a fallu trier tes affaires. L’autre jour, j’ai gagné le Prix du Salon du livre avec ta sacoche. Je dis que je ne crois pas aux porte-bonheurs, mais j’espère quand même un peu que ça marche.
Et je garde de toi les gestes punk, mille fuck you dans ma tête. Ils arrivent en bloc : chaque fois mille fuck you. Pour du temps et pour vivre : mille fuck you. J’ai laissé faire la job stable, les assurances, le bureau blanc… Mille fuck you. Mille fuck you pour écrire. Des fuck you de lettres et de bébés à serrer dans mes bras. Mille fuck you.
Erika Soucy est l’auteure de trois recueils de poésie, dont Priscilla en hologramme nouvellement paru (septembre 2017), et du roman Les murailles (Prix de création littéraire 2017 de la Bibliothèque de Québec/SILQ).
Écrivaine à la langue déliée et savoureuse, souvent crue, elle est aussi comédienne et fondatrice de l’Off-Festival de poésie de Trois-Rivières. Née en 1987 à Portneuf-sur-Mer sur la Haute-Côte-Nord, Côte-Nord dont l’imaginaire actualisé, revu façon Soucy traverse nombre de pages de ses livres, elle habite maintenant près de Québec.
(À jour octobre 2017)
EXTRAITS
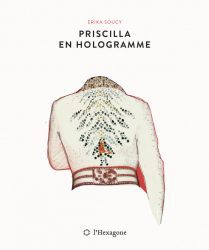 le chien se sauve à ta place
le chien se sauve à ta place
finit par rentrer
tu hurles toujours à ce moment-là
gaspillage de grands vents
Priscilla en hologramme (poésie), l’Hexagone, 2017, p. 21.
j’invente une langue je ne sais plus
comment te réveiller
je peux prendre ta place un peu
s’il vous plaît dis oui
être allongée un an
sans connaissance
Priscilla en hologramme, p. 30.
 [J’]ai trop de questions encore pour l’adulte que je deviens. Faut que j’aille comprendre qui il est. Faut que j’aille voir si c’est de sa faute. Si je peux encore croire qu’on était dans le même bateau, moi pis les amis d’école, orphelins toute la gang des chantiers de l’Hydro. Conçus fly in, élevés fly out. Je me suis promis de faire mieux que lui ; je commence par la base.
[J’]ai trop de questions encore pour l’adulte que je deviens. Faut que j’aille comprendre qui il est. Faut que j’aille voir si c’est de sa faute. Si je peux encore croire qu’on était dans le même bateau, moi pis les amis d’école, orphelins toute la gang des chantiers de l’Hydro. Conçus fly in, élevés fly out. Je me suis promis de faire mieux que lui ; je commence par la base.
Les murailles (roman), VLB, 2016, p. 10.
Tu m’excuseras, mon cœur, mais j’ai pas pris de photo. Je voulais pas. Tu devras te contenter de lire mes poèmes. De toute mon enfance, j’en ai jamais vu, des photos de chantier. […] J’ai pas eu le choix d’en construire dans ma tête, d’imaginer le décor dans lequel il s’en allait. Je voyais la baie James blanche, comme l’hiver à l’année. Les arbres gelés bord en bord, de la glace bleue partout… Pas de route. Il y avait pas de chantier, au chantier où il allait.
Les murailles, p. 147.
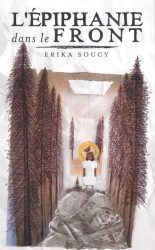 tu visites les sorcières
tu visites les sorcières
du périmètre
tu es aussi de ceux
qui passent juste au dégel
rien de pire
rien
qui traumatise
le gun la bière la colle les enfants
je ne sais pas j’imagine
une douleur à la mode
L’épiphanie dans le front, Trois-Pistoles, 2012, p.18.
 je viens du sable, moi
je viens du sable, moi
à un mille des groseilles
du pays des enfants
à face de caoutchouc
vivre était chantier
où les bêtes et les femmes
aimaient perdre leurs noms
oublier leur histoire
j’allais plaire au silence
Cochonner le plancher quand la terre est rouge (poésie),Trois-Pistoles, 2010, p. 11.










