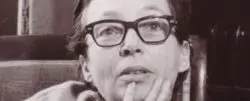L’auteure de L’amant a savamment entretenu son mythe personnel, tant dans son œuvre que dans sa façon de vivre. Si bien qu’il est parfois impossible de savoir où commence la « vérité » et où finit la fiction. Mais est-il besoin de trancher, et n’est-ce pas, au départ, un faux débat ? Quoi qu’il en soit, ayant vécu pour l’écriture, écrit sur sa vie et à partir de sa vie, Marguerite Duras fait couler encore beaucoup d’encre.
L’année 2006, qui marquait le dixième anniversaire de sa mort, a vu paraître presque simultanément plusieurs ouvrages inspirés par Marguerite Duras, sa vie, son œuvre. L’Imec, en collaboration avec les éditions P.O.L, nous a même offert un recueil de textes en grande partie autobiographiques, jusqu’ici accessibles aux seuls chercheurs et spécialistes. Contrairement à ce que l’on pourrait d’abord craindre d’une telle publication, Cahiers de la guerre et autres textes1 ne s’adresse pas aux exégètes de l’œuvre. Le recueil ne présente pas non plus le côté « journal d’une résistante » ou « chronique de l’Occupation », témoignages dont l’intérêt serait davantage documentaire que littéraire.
Enfance de l’œuvre
Ouvertement inspirés de la vie et des souvenirs de l’auteure, plusieurs de ces textes, édités et rassemblés d’une façon qui en rend la lecture agréable et aussi linéaire que possible, sont en quelque sorte la forme première de quelques-unes de ses œuvres les plus représentatives : Un barrage contre le Pacifique, L’amant, La douleur. Les amateurs seront heureux de pouvoir pénétrer dans cette œuvre fascinante par une nouvelle porte. Une « Table des correspondances des Cahiers de la guerre avec l’œuvre publiée de Marguerite Duras » permettra même aux plus férus de situer avec précision la place que ces carnets prennent dans les romans, les passages dont ils sont la première version connue. Les récits sont par ailleurs entrecoupés de passages de type essayistique, où l’auteure ébauche une réflexion parallèle au propos qui se dégage des pages strictement narratives.
Même si ces carnets présentent un côté fragmentaire, donc inachevé, l’écriture y est déjà d’une précision qui frise l’impudeur sans jamais être complaisante, sans chercher à idéaliser les êtres ou les événements. Les mots sont choisis pour leur précision, leur sincérité. Déjà, Duras recherche l’effet par la vérité de l’émotion – souvent paradoxale et certainement subjective –, quitte à paraître odieuse, monstrueuse ou méchante. Le passage où une résistante, ayant à l’esprit toutes les souffrances dont elle a été témoin, orchestre la torture d’un présumé collaborateur est particulièrement troublant. À moins que l’on choisisse de rejeter en bloc sa vision des choses, Duras nous oblige à reconnaître que nous pouvons éprouver des sentiments analogues. Ce faisant, elle montre aussi les circonstances qui les rendent inévitables. Cette caractéristique, qui marque toute l’œuvre de Duras, contribue certainement à expliquer pourquoi elle ne laisse pas indifférent. Davantage que d’autres œuvres en effet, elle suscite admiration ou rejet, sans beaucoup de nuances.
Chère Marguerite
Au chapitre des admirateurs inconditionnels, Danielle Laurin a réuni vingt-cinq personnalités – de Laure Adler à Edgar Morin, en passant par Fanny Ardant, Françoise Faucher et Robert Lalonde –, qui ont accepté de s’adresser par lettre posthume à l’auteure disparue, dans une sorte d’hommage très personnalisé : Lettres à Marguerite Duras2.
La forme épistolaire, impliquant la présence du destinataire dans le texte, met en valeur le rôle toujours vivant que joue Marguerite Duras sur la scène littéraire. Le contenu des lettres va dans le même sens, car la majorité des signataires sont des artistes qui expriment ce que Duras (ou son œuvre) a représenté, et représente toujours pour eux : une raison de vivre, un sentiment d’avoir été compris, de ne pas être seul(e). Qu’ils l’aient côtoyée ou non, les auteurs des lettres reconnaissent l’influence que son œuvre ou sa personnalité ont eue sur eux. L’ensemble rappelle donc le véritable impact de ses livres et à quel point elle continue de marquer l’imaginaire de nombreux créateurs.
D’une lettre à l’autre, les mêmes œuvres phares sont souvent citées, les mêmes personnages emblématiques reviennent donc – en particulier Lol V. Stein – et beaucoup de ces textes finissent par ressembler à un pastiche, tant il est vrai qu’on ne fréquente pas sans s’en imprégner cette écriture sèche et précise qui se décline en phrases courtes et lapidaires. L’effet de l’ensemble est un peu paradoxal, car si chacun cherche à être très personnel, notamment par la façon d’interpeller Marguerite Duras (on va du familier « chère Marguerite » au très protocolaire « Madame »), les thèmes abordés tournent autour de la fascination qu’exerce Duras. Cela contribue d’ailleurs à mettre en relief le mimétisme (involontaire ?) souligné plus haut. On ne peut pas à proprement parler d’un défaut, c’est davantage une question de goût et l’on peut très certainement trouver du mérite à cette continuité qui peut aussi paraître répétitive.
L’impossible rencontre
En même temps qu’elle préparait ce collectif, Danielle Laurin travaillait à un témoignage personnel : Duras, l’impossible3. La journaliste y avoue une vieille fascination pour la vie et l’œuvre de cette écrivaine qui, selon le mot de Jacques Lacan, savait sans lui ce qu’il enseignait. C’est-à-dire qu’elle aurait su exprimer plus que quiconque les paradoxes du désir féminin (entre autres), d’où le retentissement de son œuvre pour nombre des signataires des Lettres à Marguerite Duras, et pour Danielle Laurin en particulier. À 19 ans, en plein naufrage amoureux, Danielle Laurin sent qu’elle perd pied ; le hasard met sur sa route Le ravissement de Lol V. Stein de Duras, auteure qu’elle ne connaît pas encore. Elle s’identifie tellement à l’héroïne que c’est pour elle un choc. L’essai-récit s’ouvre sur le témoignage sous forme de pastiche de ce que la lecture du Ravissement a provoqué chez elle.
Si le style admiré est adroitement imité, Laurin a heureusement su garder la mesure et ne pas s’attarder interminablement dans cette voie. S’adressant à la deuxième personne à cette auteure qui la fascine, elle explique ce qu’elle a retenu de l’œuvre (sur laquelle elle a même commencé une thèse de doctorat), raconte les démarches qu’elle a entreprises, en vain, pour la rencontrer, les quelques conversations téléphoniques qu’elle a réussi à obtenir. Après la mort de Duras, Laurin a continué sa quête pour entrer dans la vie privée de celle qui continuait de la fasciner et a pu rencontrer Yann Andréa, le paradoxal dernier homme de sa vie, et Jean Mascolo, son fils.
Le récit de Laurin témoigne également de sa profonde connaissance de l’œuvre et, comme les Cahiers de la guerre, donne envie d’y revenir. Elle fait également des liens avec les moments les plus connus de la vie de l’auteure, littérarisés dans son œuvre. C’est d’ailleurs à cette confusion que s’attaque Jean Vallier dans le premier tome de C’était Marguerite Duras, 1914-19454.
C’était « l’époque » de Marguerite Duras
Le biographe veut départager la vérité de la fiction, par exemple donner une place significative au père, éclipsé dans l’œuvre par l’omniprésence de la mère, ou préciser le lieu exact où la romancière a grandi (pas aussi romantique que celui qui est donné dans la fiction), rectifier des détails sur l’enfance des parents, etc.
Ainsi, les trois premiers chapitres sont entièrement consacrés à l’enfance, aux origines et aux débuts dans l’enseignement d’Henri Donnadieu et de Marie Legrand, parents de la romancière. On remonte d’ailleurs un peu loin dans la généalogie et l’histoire de la France et on énumère d’innombrables parents et alliés, ce qui peut devenir rapidement fastidieux pour un lecteur plus intéressé par la littérature que par l’histoire, petite ou grande. Les brillantes études pour devenir enseignants sont évoquées (ils ont obtenu rapidement des postes et des responsabilités qui indiquent qu’on les considérait comme de bons candidats).
Jean Vallier essaie manifestement de donner une image des parents plus réaliste que celle qui apparaît dans la fiction. La suite de l’essai va dans le même sens : les années d’adolescence et de formation, la guerre, l’engagement dans la Résistance, les débuts comme écrivain, chaque moment de la vie de Duras est longuement contextualisé. Les photos que Vallier a pu consulter (dont certaines, très belles, sont reproduites dans l’essai) sont décrites avec minutie et insistent sur le caractère « normal » de cette famille que l’œuvre présente de façon pour le moins dysfonctionnelle.
La biographie contient également une masse d’informations très détaillées sur l’époque dans laquelle a vécu l’auteure de L’amant,dont des témoignages d’autres ressortissants des colonies. D’où, il me semble, une erreur sur le titre : C’était Marguerite Duras prétend dire la vérité sur une femme qui a déjà passablement utilisé sa propre histoire en littérature et sur la vie de laquelle on a beaucoup écrit. On aurait mieux fait d’attirer l’attention sur la véritable originalité du livre : nous parler des événements qui ont laissé des traces dans l’œuvre et du contexte dans lequel Duras a vécu, sans prétendre atteindre à la Vérité sur les personnes de l’entourage de l’auteure.
Tout ce qui dans la fiction est inspiré de la réalité est passé au peigne fin, confirmé ou démenti. Le travail de recherche est impressionnant, la somme de documents consultés témoigne d’un minutieux travail de vérification des sources, des dates, des identités (heureusement qu’on a eu l’idée de regrouper les notes en fin de chapitre, les pages en auraient été encombrées).
On dirait que Jean Vallier veut régler des comptes avec d’autres biographes, Laure Adler en particulier, qui aurait trop tôt tenu comme argent comptant ce que les romans peuvent contenir d’autobiographique. Bref, on ne sait plus toujours si c’est Marguerite Duras qui est prise en défaut pour avoir un peu trop fabulé avec son passé ou si c’est avec Laure Adler que Vallier veut en découdre. Quoi qu’il en soit, il me semble qu’à trop prétendre détenir la vérité on risque d’enfoncer une porte ouverte : en littérature, le vrai ne résidant pas dans les faits racontés mais dans le propos de l’œuvre, un livre qui se donne comme un roman doit-il d’autres comptes à la réalité que celui d’être construit de façon cohérente ?
Forcément subversive
Cette vérité du littéraire n’est pas toujours facile à cerner ni même à accepter. C’est pourquoi on voudrait pouvoir dire avec certitude ceci est vrai et cela est faux, on voudrait croire à l’objectivité là où la littérature nous enseigne justement qu’il n’y a de vérité que subjective.
Bien sûr, dans l’espace public, politique et social, pour le bien commun, il faut chercher à définir une frontière : dire ceci est acceptable et cela ne l’est pas. Marguerite Duras n’avait cure de cela quand elle a écrit Sublime, forcément sublime Christine V.5,un essai qui ne pouvait que soulever les passions. Repris aujourd’hui avec une introduction où Catherine Mavrikakis précise bien que le texte de Duras a une visée littéraire, gageons néanmoins qu’il fera encore aujourd’hui un certain effet.
Rappelons le drame qui a inspiré Duras. En octobre 1984, un enfant de quatre ans est retrouvé sans vie, pieds et poings liés, dans une rivière. Après quelques mois d’enquête, la mère – Christine V. – est accusée de cette mort qui ne peut évidemment pas être accidentelle. Affirmant son innocence jusqu’à faire une grève de la faim, Christine V. sera relâchée et l’enquête se soldera par un non-lieu. Marguerite Duras a doublement choqué : alors qu’on vient tout juste d’arrêter la prévenue et que son procès est à peine commencé, l’argumentation de l’essai prend le parti de la culpabilité de cette mère : elle a tué son enfant. Mais Duras va beaucoup plus loin dans la subversion quand elle écrit que c’est une affaire qui ne regarde pas la justice.
Que comprendre de cette position scandaleuse ? La véritable question serait comment comprendre cette affirmation. Le seul moyen, il me semble, de s’approprier l’intention d’une telle prise de position (et c’est là le propos de l’introduction de Mavrikakis), c’est de la replacer dans l’espace dont elle se réclame : la littérature en tant qu’elle est exploration des abysses de la nature humaine. Ce n’est donc pas, à mon sens, la défense d’une mère en particulier que Marguerite Duras voulait prendre – en cela avouons qu’elle aurait été bien maladroite –, elle voulait plutôt dire le côté aliénant de la maternité, la part d’irrationnel que cette expérience soulève et la perte de soi à laquelle elle peut conduire. Ce point de vue est d’autant plus difficile à supporter qu’il est largement nié dans le discours social. À une époque, par ailleurs en mal d’enfants, où on écoute sans sourciller des mères dire de leur fils qu’il est l’homme de leur vie, on peut s’attendre à ce que la réédition de Sublime, forcément sublime suscite pour le moins l’étonnement. Duras y entre dans le point de vue d’une femme qui subit la maternité jusqu’à s’y perdre et elle suit la logique de ce point de vue jusqu’au bout, sans pour autant prétendre qu’il est socialement acceptable.
La difficulté est que la distance n’est pas évidente ici, entre le point de départ dans le réel – un geste de violence inacceptable sur le plan social – et le propos que la littérature veut illustrer : essayer de comprendre de l’intérieur comment une telle chose se produit. Bien sûr, si les personnages étaient totalement fictifs, on pourrait se dire que « ce n’est qu’un roman » et la question ne se poserait pas (ou du moins pas de la même façon). On s’exprimerait pour ou contre la manière de présenter le propos sans se sentir scandalisé par l’image concrète d’un enfant assassiné. Il y a pourtant de vrais enfants qui sont assassinés et de véritables mères qui arrivent à des gestes aussi « inhumains ». Pourtant, justement, aussi monstrueuse soit-elle, il s’agit encore d’humanité dans les motifs qui conduisent à l’horreur. Forcément subversive, Marguerite Duras, puisqu’elle entre directement dans le réel pour y puiser la part de littéraire. Comme elle l’a fait dans toute son œuvre à partir de sa propre histoire.
Dans un registre semblable, mais en prenant soin de laisser des traces plus évidentes de sa propre subjectivité, donc en balisant davantage la lecture, Emmanuel Carrère avait, dans L’adversaire6, créé une œuvre à partir de meurtres tout aussi monstrueux (après leur avoir menti pendant plus de 15 ans, un homme tue ses parents, sa femme et ses enfants). Clairement balisée dans la forme même que Carrère a donnée à son essai, sa démarche n’a pourtant pas soulevé le même parfum de scandale. Pourtant, il me semble que les deux entreprises relèvent de la même ambition : amener le lecteur un peu plus près de ce qu’il est tenté de rejeter en bloc, le confronter à ses propres monstres.
Et Marguerite Duras semblait capable, plus que quiconque, de regarder les siens en face et de les nommer. C’est sans doute pourquoi nombre de créateurs se montrent particulièrement sensibles à son œuvre, elle révèle le sens même de l’expression artistique.
1. Marguerite Duras, Cahiers de la guerre et autres textes, P.O.L/Imec, 2006, 446 p. ; 39,95 $.
2. Sous la dir. de Danielle Laurin, Lettres à Marguerite Duras, Varia, 2006, 176 p. ; 19,95 $.
3. Danielle Laurin, Duras, l’impossible, Varia, 2006, 96 p. ; 19,95 $.
4. Jean Vallier, C’était Marguerite Duras, T. 1, 1914-1945, Fayard, 2006, 701 p. ; 44,95 $.
5. Marguerite Duras, Sublime, forcément sublime Christine V., précédé de Duras aruspice de Catherine Mavrikakis, Héliotrope, 2006, 64 p. ; 12,95 $
6. Porté à l’écran par Nicole Garcia, avec Daniel Auteuil dans le rôle de Jean-Claude Romand.