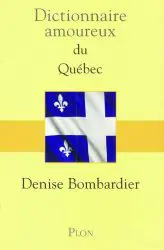Les débats de société l’interpellent, les questions reliées à la langue et à la culture au premier chef. Depuis des décennies, Denise Bombardier est présente sur les scènes médiatiques québécoise et française à plusieurs titres.
Romancière et essayiste, animatrice, chroniqueuse et aussi blogueuse, la docteure en sociologie diplômée de la Sorbonne est réputée pour sa vivacité d’esprit, appréciée par les uns pour sa clairvoyance, son franc-parler et son sens de l’humour, abhorrée par les autres pour son ton, qu’ils jugent provocateur. Ton qui pourrait s’expliquer par le fait qu’elle dit douter, qu’elle ne croit pas détenir toute la vérité et qu’elle doit se convaincre elle-même lorsqu’elle parle. Nous l’avons rencontrée à Québec, dans les locaux de Nuit blanche, à l’occasion de la parution de son dernier ouvrage, un dix-neuvième, le Dictionnaire amoureux du Québec1, publié par la maison d’édition française Plon, qui compte une importante collection de « dictionnaires amoureux », signés par des auteurs prestigieux : Dictionnaire amoureux de la Chine, Dictionnaire amoureux de l’Égypte, Dictionnaire amoureux de la langue française, etc. La seule contrainte imposée aux auteurs est que leur vécu et leur vision personnelle et impressionniste doivent occuper la plus grande place.
Celle qui a parlé de ses amours dans des romans d’autofiction et qui sait manifester haut et fort son indignation tant sur les plateaux de télé que dans ses écrits est tout à fait à l’aise de présenter SA vision du Québec, quitte à susciter la controverse. Ses choix d’entrées, pour chaque lettre de l’alphabet, de « Accent » à « Zouave », auraient pu être autres, reconnaît-elle, mais observant à distance son pays et fouillant ses souvenirs, des personnages, des lieux et des traits de ses compatriotes se sont imposés à elle.
Soit ! Mais qu’est-ce qui a pesé dans vos choix, tout de même ? lui demande-t-on. Par exemple, pourquoi Louise Beaudoin, plutôt que Liza Frulla, toutes deux vos amies, toutes deux ayant occupé la fonction de ministre ? Pourquoi l’une et pas l’autre ?
C’est qu’à ses yeux, Louise Beaudoin est incontournable pour le rôle qu’elle a joué dans la francophonie et pour la défense de la langue française, mais surtout dans les rapports du Québec avec la France à une certaine époque. Elle est connue partout, d’ajouter l’écrivaine. Quant à Liza, elle a été une bonne ministre de la Culture, mais elle n’a pas eu un rôle déterminant dans les relations internationales du Québec.
Les seuls autres politiciens qui figurent au Dictionnaire sont morts, soit Robert Bourassa, cité dans l’entrée consacrée à la baie James, Thérèse Casgrain, René Lévesque et Pierre Elliott Trudeau. Dans l’ensemble, il semble que l’appartenance au jet set revête ici une certaine importance. Cela s’avère pour bon nombre d’artistes, reconnus à l’étranger, notamment les Félix Leclerc, Luc Plamondon, Céline Dion, Robert Charlebois, Xavier Dolan, Denys Arcand, Gabrielle Roy, Michel Tremblay, Gilbert Rozon. Des exceptions, comme Yvon Deschamps, qui n’a pas eu de carrière internationale, mais dont elle dit qu’« aucune personnalité politique au Québec n’a mieux réussi à définir l’inconscient collectif ». Comme ici et là dans le Dictionnaire, se mêlent des anecdotes et confidences, telle celle où l’écrivaine révèle que le célèbre parolier Luc Plamondon s’est inspiré d’une période de sa vie amoureuse pour écrire « Vivre avec celui qu’on aime ».
Outre le succès de nos artistes à l’échelle internationale, Denise Bombardier souligne les grandes réalisations en ingénierie, manifestations de l’audace et de la démesure québécoises que sont les barrages de la baie James et le mur de Fermont, l’entreprise familiale de Joseph-Armand Bombardier (entreprise à laquelle souvent on la croit associée) et de son successeur Laurent Beaudoin. Et encore, motifs de fierté nationale d’une autre époque, les hommes forts, Louis Cyr, Victor Delamarre et Jos Montferrant, figurent également dans le Dictionnaire, rappel de l’importance que revêtaient aux yeux d’un peuple dominé les victoires de ses héros auxquels viendront s’ajouter plus tard les vedettes du hockey.
Du passé plus lointain, elle célèbre la mémoire des découvreurs et bâtisseurs du pays, les Jacques Cartier, Samuel de Champlain et Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, pour leur courage immense, leur esprit d’entreprise et leur envergure. En entrevue, alors que sévit la polémique au sujet de la dénomination du pont Champlain, Denise Bombardier se félicite d’avoir consacré plusieurs pages à celui qu’elle qualifie de visionnaire, et se dit réconfortée comme elle ne l’a pas été depuis longtemps par la réaction de la population, qui a vivement protesté contre le changement de nom proposé par l’autorité fédérale : « Tous les gens ont dit non. Ça, c’est nous ! Une vraie victoire collective ! »
Quittant les sentiers de la grande histoire, elle révise la réputation des personnages d’humble condition qu’étaient les frères enseignants qui, affirme-t-elle, « malgré les dérives d’un trop grand nombre, ont accompli une œuvre d’éducation et de scolarisation dans des milieux très modestes où l’éducation n’était pas une priorité ». Elle rappelle alors « l’action spectaculaire » de l’un d’entre eux, le frère Jean-Paul Desbiens, qui dénonce dans Les insolences du frère Untel ce qu’il est le premier à appeler le joual. De même au sujet des religieuses auxquelles elle rend justice pour avoir joué un rôle essentiel dans l’éducation des filles. Certaines, au cours des dernières décennies, sont demeurées actives malgré le grand âge auprès des plus démunis, femmes maltraitées, sidatiques, vieillards abandonnés, adolescents en errance. Elle remarque qu’«[e]lles ont souvent réussi à évoluer avec plus de souplesse, d’ouverture d’esprit et de lucidité que nombre de Québécois qui, eux, ont reproduit dans la société décléricalisée et déchristianisée tous les travers, les tics et l’idéologie bornée du Québec de la catholicité étouffante. Le ‘Hors de l’Église, point de salut’ est repris par beaucoup de sectaires de toutes croyances ». On reconnaît là la polémiste allergique à tous les intégrismes. C’est la Denise Bombardier qui n’hésite pas à aller à contre-courant, lorsque la vérité est en jeu.
Traits identitaires ?
Cette position illustre le reproche qu’elle fait aux Québécois et qui colore bon nombre d’entrées de son Dictionnaire pourtant qualifié d’amoureux. « Nous, on aime ou on n’aime pas, c’est pour cela […] que les zones de nuances sont très difficiles à faire […], mais les gens sont mal à l’aise avec les nuances, or c’est dans les nuances qu’on peut cerner au plus près la vérité. » Voilà ce qui expliquerait selon Denise Bombardier pourquoi les intellectuels québécois interviennent si peu dans les débats publics, « trop embarqués » qu’ils sont dans cette dichotomie. Sous l’influence de l’Église, nous aurions baigné si longtemps dans cette obsession de la dichotomie que notre façon de penser, de croire et d’aimer en serait encore marquée. Le sentiment de culpabilité qu’éprouveraient même les nouvelles générations, toujours obligées de s’excuser, proviendrait de la culpabilité première induite par la notion de péché.
Les mots « décléricalisation », « mutation », « rupture », « perte d’identité » reviennent en entrevue, tel un leitmotiv. Alors qu’elle étudiait la sociologie, une rencontre l’a marquée. Le grand sociologue américain Elihu Katz, coauteur avec Paul Lazarsfeld d’un classique en sociologie des communications, lui avait expliqué, après qu’elle lui eut fait état des transformations effectuées en à peine quinze ans au Québec, que notre identité, c’était la langue et la foi et que, la situation étant devenue ce qu’elle était, nous avions perdu la moitié de notre identité : « You lost half your identity then ». Est-ce que cela a été remplacé par d’autres valeurs ? se demande-t-elle. Elle n’en est pas sûre. « Le Québec actuel, écrit-elle, est indéchiffrable si l’on croit que cette force constructrice de l’identité québécoise (destructrice, affirment les zélotes anticléricaux) peut être mise au rancart de l’Histoire. L’on ne déchristianise ni ne décléricalise un peuple en quelques décennies sans perturbation profonde. » En fait, il faut bien comprendre que Denise Bombardier ne se porte pas à la défense du catholicisme comme tel, mais de la tradition, des rites. Évoquant le baptême de son fils et son propre mariage religieux avec l’Anglais, ne déclare-t-elle pas : « On est des catholiques sociologiques, voilà » ? N’empêche, la question demeure : comment grandir, coupés de nos racines ?
Rupture
Elle déplore que les Québécois du XXIe siècle « peinent à reconnaître l’apport des ancêtres à la survivance collective dont ils s’éloignent, croyant en être affranchis ». Or comment évoluer, avancer avec assurance sans s’appuyer sur les gains du passé ? Elle voit les manifestations de cette rupture en éducation, avec le taux le plus élevé au Canada d’analphabètes fonctionnels, 49 %, conséquence d’une démocratisation qui se serait faite en nivelant par le bas ; un appauvrissement de la culture générale, délestée des référents de la culture judéo-chrétienne qui a forgé la vision du monde des générations précédentes, référents pourtant si essentiels à la compréhension des productions culturelles en général et de la littérature en particulier. « On est comme la température, nous, on est excessifs », dira Denise Bombardier, en notant que le taux de natalité au Québec est passé du plus élevé au plus bas en Occident. Comme le mariage, institution affaiblie au Québec plus que partout ailleurs. Pourquoi devrait-on s’en alarmer ? Elle rétorque que décider de vivre avec une personne n’appartient pas qu’au domaine privé, que nous vivons en société et que le mariage est une institution sociale, un engagement de plus.
Et la famille est une autre valeur qui s’effrite, dit-elle en constatant la solitude des aînés. La comparaison avec la France, comme c’est souvent le cas pour d’autres sujets, lui sert de barème ; cette France où les familles partent en vacances avec les papis et les mamies, alors qu’elle entend dire ici : « Ma famille, c’est mes amis ».
Fin d’un rêve ?
« Maintenant, qu’est-ce qu’on fait, s’interroge-t-elle, comment on recrée des repères qui sont autres en ne brisant pas ce que l’on a été ? C’est le grand défi des sociétés. […] on n’est pas équipés pour intégrer les gens qui viennent d’ailleurs, qui viennent de cultures qui sont très opposées à la nôtre. [Comment y arriver] sans vraiment disparaître par rapport à toutes les valeurs qui sont nôtres et pour lesquelles on a lutté ? On ne va pas retourner en arrière. » Face à l’échec de deux référendums, aggravé par la dénatalité, la mondialisation, les frontières qui éclatent, l’économie que ne contrôlent plus les pays souverains, elle reconnaît qu’il y a de quoi désespérer par rapport au rêve d’émancipation absolue qu’avait engendré chez nous la Révolution tranquille. Auparavant, elle aura souligné l’individualisme ambiant et la dépolitisation des jeunes. Enfin, pour Denise Bombardier, le grand rêve de l’indépendance, ce n’est plus qu’un rêve, car ce n’est plus réalisable.
Vision désespérante du pays que celle présentée dans le Dictionnaire amoureux du Québec ? Denise Bombardier se dit en désaccord avec ce jugement. Elle parle plutôt de « vision en distance », différente de celle de certains de ses compatriotes qui seraient portés à croire que le Québec est le centre du monde, à croire que les transgressions sont signes de libération. Elle assure avoir une vision plus distanciée « pour départager ce qui nous construit et ce qui nous déconstruit » ; voilà ce qu’elle affirme essayer de faire.
Sa présentation par ordre alphabétique impose au Dictionnaire amoureux du Québec un caractère nécessairement éclectique. On y retrouve entre autres Chiniquy, le prédicateur-vedette de la tempérance au XIXe siècle, devenu objet de scandale, et dont le nom dans la bouche de la grand-mère de Denise Bombardier évoque tout type peu recommandable : « un vrai Chiniquy » ; les Québécoises, « à la fois démesurées, excessives, affirmées et omniprésentes » ; les Inuits et les Indiens, dont l’auteure identifie les nations en les situant sur le territoire ; le drapeau, son histoire, notre ambivalence à son égard ; les vrais bagels auxquels ont accès les Montréalais ; la poutine ; notre télévision, au sujet de laquelle Denise Bombardier dira, ironique, « Je me regarde, donc je suis » ; le tutoiement, etc. Il y est aussi question de ses petites et grandes passions, comme la pêche, qui lui fait dire « que quiconque n’a jamais pêché ne peut être un Québécois à part entière ». On peut observer, dans l’ensemble du Dictionnaire, que la fée Démesure n’a pas non plus épargné son auteure. Aussi suscitera-t-il de vives réactions chez bon nombre de lecteurs. Il est surtout probable que le lecteur québécois y trouvera des sujets de réflexion et de discussion, car ces textes de Denise Bombardier ouvrent bien des pistes, proposent un portrait de groupe qui pourrait différer de l’image que l’on s’est construite.
1. Denise Bombardier, Dictionnaire amoureux du Québec, Plon, Paris, 2014, 400 p. ; 34,95 $.