Caroline Vu est une écrivaine d’origine vietnamienne qui a vécu aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et à Montréal, où elle a fait ses études et où elle pratique maintenant la médecine. Elle a publié deux romans en anglais au milieu de la décennie 2010. Ceux-ci ont été traduits aux éditions de la Pleine lune par Ivan Steenhout.Un été à Provincetown1, deuxième roman de l’auteure, paraissait en français en 2016, tandis que Palawan2, son premier titre, paraissait en traduction en 2017.
Caroline Vu, elle-même née pendant la guerre du Vietnam et exilée dès l’enfance, propose des récits qui se déploient dans les cicatrices de la guerre, qui explorent la diaspora vietnamienne et ses silences, et tentent de dresser un portrait de cette déchirure sans lyrisme ou émotivité excessive. En parcourant l’univers de cette écrivaine, on s’étonne d’abord de la narration distanciée qui semble offrir un portrait banal et assez froid de la guerre, souvent telle qu’elle a été vue par les enfants. Mais cette écriture blanche charrie son lot d’émotions parce que dans ses intrigues comme dans la forme de ses romans, Caroline Vu témoigne du poids des traditions, de la peur de trahir les origines et même de douleurs si insupportables qu’elles se vivent finalement dans une résilience faite de silence.
Les gens de Palawan
Le premier roman de Caroline Vu, Palawan, raconte l’histoire de Kim, jeune Vietnamienne qui, à la fin des années 1970, abandonne sa famille à contrecœur pour embarquer seule sur un bateau qui la mène loin du régime communiste. Prise en charge par une voisine, tatie Hung, l’adolescente se retrouve aux Philippines, au camp de Palawan. Elle y tue le temps entre le « Jeu de l’Attente », où elle compte les jours avant d’atteindre l’Amérique, la découverte de la sexualité avec Minh, petit truand du camp de réfugiés, et les services de traduction qu’elle rend au Dr Jacques au dispensaire. C’est un coup du destin qui lui permettra finalement de s’embarquer pour Derby, au Connecticut, où elle entamera une nouvelle vie.
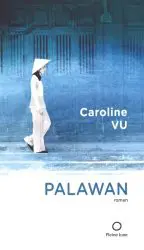 Palawan est le roman du quotidien des grands drames : Kim vit une épopée, mais de son point de vue, c’est la vie tout simplement. Rien ne lui semble particulièrement digne de mention. Tous ceux qu’elle rencontre après son exil ont du Vietnam une idée tellement exotique qu’elle ne sait comment répondre à leurs attentes. Le travail de la forme accentue cette impression. Certaines des déchirures vécues par la jeune fille sont si grandes qu’elle ne peut y faire complètement face : son père a-t-il quitté le Vietnam en lâche comme elle croit l’avoir vu à la télévision ? Que s’est-il passé pendant cette traversée dont elle ne se souvient pas ? Doit-elle avoir honte des jeux sexuels avec Minh qui lui procurent un certain plaisir, mais aussi de jolies babioles ?
Palawan est le roman du quotidien des grands drames : Kim vit une épopée, mais de son point de vue, c’est la vie tout simplement. Rien ne lui semble particulièrement digne de mention. Tous ceux qu’elle rencontre après son exil ont du Vietnam une idée tellement exotique qu’elle ne sait comment répondre à leurs attentes. Le travail de la forme accentue cette impression. Certaines des déchirures vécues par la jeune fille sont si grandes qu’elle ne peut y faire complètement face : son père a-t-il quitté le Vietnam en lâche comme elle croit l’avoir vu à la télévision ? Que s’est-il passé pendant cette traversée dont elle ne se souvient pas ? Doit-elle avoir honte des jeux sexuels avec Minh qui lui procurent un certain plaisir, mais aussi de jolies babioles ?
À son arrivée à Derby, Kim est accueillie par une communauté différente de ce qu’elle a connu. Elle y découvre l’abondance capitaliste, un certain racisme, mais aussi la tendresse parentale. Mary, en parfaite mère d’accueil, prend l’adolescente sous son aile et manifeste un enthousiasme et une empathie que Kim n’a jamais connus. Convaincue qu’elle se trouve dans cette famille en raison d’une erreur d’identité, elle apprend à mentir sur son passé et à ne jamais mentionner les membres de sa famille laissés derrière. Ses souvenirs deviennent alors un collage provenant à la fois de sa mémoire, de l’image véhiculée par les médias américains et de ce qu’elle perçoit comme étant les attentes de ces interlocuteurs qui ne connaissent rien du Vietnam : « [Mary] découpait toutes les histoires de boat peoplequ’elle trouvait. Les Time, Life, National Geographic,Reader’s Digestdisparaissaient de la salle d’attente de son médecin pour atterrir sur mes genoux. […] Je lus consciencieusement ces articles, mais ne m’y reconnus pas. Les émotions y semblaient soit exagérées, soit mal rendues ». On comprend sans peine que ce jugement quant au ton des histoires rapportées ait pu être celui de Caroline Vu tant les choix stylistiques effectués dans ses deux romans témoignent de l’exil dans une retenue peu commune.
C’est finalement en quittant les États-Unis pour aller poursuivre des études universitaires à Montréal que Kim reprendra contact avec son histoire réelle et laissera poindre le désir de renouer avec son passé. Il s’agit peut-être d’ailleurs du seul bémol que nous pourrions faire à la trame de ce récit bien ficelé : on ne comprend pas à la lecture pourquoi Kim décide de venir étudier au Canada plutôt que de rester avec sa famille adoptive aux États-Unis. Cette escale supplémentaire, bien qu’elle témoigne d’une quête de repères, ne s’explique pas très bien dans la trame narrative. Caroline Vu montre ainsi une ville qu’elle connaît bien et ce détour lui permet de faire certains clins d’œil aux lecteurs québécois, y compris en matière de nids de poule, mais nous aurions aimé mieux comprendre les motivations du personnage.
Daniel est mort
Le second roman de Caroline Vu, Un été à Provincetown, nous plonge quant à lui dans les méandres d’une histoire familiale vietnamienne. La narratrice, Mai, déroule lentement les histoires tarabiscotées de sa famille en prenant comme événement pivot la mort prématurée de son cousin Daniel. L’incipit donne le ton : « Daniel est mort prématurément il y a vingt-huit ans. On pourrait penser qu’avec le temps, on lui pardonnerait. Mais non, pareille chance n’existe pas. L’orgueil et la mémoire ont la vie longue dans sa famille. Je le sais parce que sa famille est aussi la mienne ». Le jeune homme, né d’une mère française et d’un père vietnamien, est extraverti, bisexuel et rebelle. Il dérange l’ordre familial conservateur non seulement par le sida qui le vaincra en 1986, mais aussi parce qu’il porte tous les secrets familiaux sans manifester beaucoup d’intérêt pour la loi du silence que la matriarche du clan tente de maintenir. Bien qu’il fût adulé par sa grand-mère, celle-ci persistera d’ailleurs à dire qu’il est mort à la suite d’une crise d’hémorroïdes, ce qui montre à quel point elle tient les fils de la bienséance familiale.
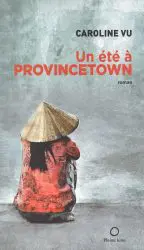 Qu’en est-il de ces secrets ? Dès le début du récit, Daniel révèle à son cousin Tim que son père n’est pas celui qu’il croyait. La curiosité du lecteur sera alors piquée. Mais très rapidement, l’identité du géniteur de Tim se révèle n’être qu’un des nombreux scandales cachés dans cette famille. Le clan est populeux et on s’y perd parfois entre les oncles, les cousins, les beaux-frères. Mais cela a finalement peu d’importance puisque l’objectif est de dresser un portrait d’ensemble, de montrer combien ce « nous » est fait de trous et de mailles. Cette famille « avait déjà cadenassé depuis des années la porte de la tendresse » et l’histoire que raconte Mai nous explique en partie comment la peur et le ressentiment peuvent être les forces du lien familial.
Qu’en est-il de ces secrets ? Dès le début du récit, Daniel révèle à son cousin Tim que son père n’est pas celui qu’il croyait. La curiosité du lecteur sera alors piquée. Mais très rapidement, l’identité du géniteur de Tim se révèle n’être qu’un des nombreux scandales cachés dans cette famille. Le clan est populeux et on s’y perd parfois entre les oncles, les cousins, les beaux-frères. Mais cela a finalement peu d’importance puisque l’objectif est de dresser un portrait d’ensemble, de montrer combien ce « nous » est fait de trous et de mailles. Cette famille « avait déjà cadenassé depuis des années la porte de la tendresse » et l’histoire que raconte Mai nous explique en partie comment la peur et le ressentiment peuvent être les forces du lien familial.
Le dispositif narratif est original en ce qu’il offre un double point de vue. Si l’histoire est racontée par Mai, enfant issue d’une union illégitime, c’est toujours par le prisme de la vie et de la personnalité de Daniel que les différents personnages se découvrent. Comme si Mai avait elle aussi besoin du mouton noir, ne serait-ce qu’en souvenir, pour déballer son sac. Mensonges, mariages arrangés, traîtrises, enfants illégitimes, pédophilie, les tiroirs de la famille débordent de petites fins du monde qui ont été noyées par les aléas de la grande Histoire qui déplacent les individus un peu partout sur la planète.
Les exils de Caroline Vu
Plusieurs thèmes se retrouvent dans les deux romans (le personnage de la grand-mère qui mène son clan, la maternité qui se vit sans grande chaleur, les adoptions camouflées, les secrets de famille, etc.). Comme l’affirme la narratrice d’Un été à Provincetown : « Les liens familiaux, comme les racines culturelles, ont de profondes assises ». Ce sont ces assises qui sont au cœur de la recherche romanesque de Caroline Vu.
On reconnaît aussi, dans les deux livres, l’importance accordée aux paroles rapportées. Dans Palawan, le rôle des médias est mis en lumière. Kim n’arrive jamais à accéder par elle-même à ses souvenirs : on lui raconte les événements du Têt 68 comme on les a vus à la télé et le Dr Jacques a une idée fantasmée du Vietnam qui lui a été inspirée par quelques reportages ethnographiques. Comme nous l’avons souligné plus tôt, Kim en vient à dépendre des médias occidentaux pour tenter de retrouver la mémoire de sa traversée. Chez Mai, les paroles rapportées sont davantage celles de la famille, mais elles jouent un rôle semblable à celui des médias chez Kim : elles font du Vietnam une fiction.
Malgré leurs similarités, les deux premiers romans de l’écrivaine se distinguent pourtant. Un été à Provincetown est un roman du clan. Malgré les aléas de l’histoire politique, malgré les exils aux quatre coins du globe, un fil continue de tenir ensemble la famille de Mai et de Daniel. Dans Panawan, au contraire, le noyau familial a implosé et les contacts sont rompus. Les deux portraits de l’exil vietnamien que nous présente Caroline Vu sont forcément très différents : la tribu et l’individu, la lourdeur du groupe et le poids de l’isolement.
Mais si les deux livres creusent en général le même sillon, c’est aussi parce que l’écrivaine constate que les silences familiaux ont des équivalents dans l’histoire internationale. Mai justifie ainsi sa prise de parole : « Cette histoire d’un pays dont tout le monde parlait naguère, mais qu’on oublie aujourd’hui, mérite d’être racontée ». Caroline Vu en fait son affaire.
1. Caroline Vu, Un été à Provincetown, trad. de l’anglais par Ivan Steenhout, Pleine lune, Lachine, 2016, 188 p. ; 21,95 $.
2. Caroline Vu, Palawan, trad. de l’anglais par Ivan Steenhout, Pleine lune, Lachine, 2017, 358 p. ; 27,95 $.
EXTRAITS
Le jour de la mort de mon cousin Daniel, mon cœur se mit à battre de façon désordonnée. Mais je m’obligeai à ne pas m’arrêter. Arythmie ou pas, j’avais des choses à faire. Avant de mourir, Daniel m’avait demandé de retrouver sa mère française, Catherine, en France.
Un été à Provincetown, p. 93.
Des rumeurs de morts en mer nous gardaient les pieds bien plantés sur la terre ferme. Mais nous entendions aussi parler de départs couronnés de succès et de nouvelles vies vécues par-delà les regrets. Dans de tels moments, nous aspirions à fuir aussi. C’est le problème avec les rumeurs. Elles effraient mais font également rêver.
Panawan, p. 42-43.










