S’il a échangé des lettres avec la crème des écrivains et artistes de son temps (pensons à Lou Andreas-Salomé, Balthus, Gide, Hofmannsthal, Catherine Pozzi, Rodin, sans oublier sa « correspondance à trois » avec Tsvetaïeva et Pasternak), c’est surtout dans le courrier adressé à des destinataires plus obscurs que Rilke s’est imposé comme un épistolier de génie.
Ses lettres abordent constamment la question d’un art de vivre. Pour lui, la pratique épistolaire représentait moins « de l’écriture » que « de la respiration par la plume1 ».
Lettres à Franz Xaver Kappus
 Avec les Lettres à Louise Colet de Gustave Flaubert, les Lettres à un jeune poète2 constituent l’un des exemples les plus célèbres de correspondance que l’on a pris l’habitude de lire comme un monologue alors que la perspective dialogique n’est pas dépourvue d’intérêt, loin de là. Certes, le jeune poète en question – Franz Xaver Kappus (1883-1966) – n’a ni la finesse ni la profondeur de son aîné. Élève officier de l’armée austro-hongroise (il sera plus tard journaliste et romancier, mais renoncera à écrire des vers), Kappus adresse au grand poète pragois des lettres qui sont si souvent empesées de formules d’admiration et d’une quête d’approbation qu’une comparaison serait à leur désavantage. Elles apportent pourtant un précieux contrechamp aux propos rilkéens. Il est assez surprenant, d’ailleurs, que les éditeurs aient fait le choix, depuis 1929, de les occulter (un aspect qu’élucide l’universitaire Erich Unglaub dans son éclairante postface).
Avec les Lettres à Louise Colet de Gustave Flaubert, les Lettres à un jeune poète2 constituent l’un des exemples les plus célèbres de correspondance que l’on a pris l’habitude de lire comme un monologue alors que la perspective dialogique n’est pas dépourvue d’intérêt, loin de là. Certes, le jeune poète en question – Franz Xaver Kappus (1883-1966) – n’a ni la finesse ni la profondeur de son aîné. Élève officier de l’armée austro-hongroise (il sera plus tard journaliste et romancier, mais renoncera à écrire des vers), Kappus adresse au grand poète pragois des lettres qui sont si souvent empesées de formules d’admiration et d’une quête d’approbation qu’une comparaison serait à leur désavantage. Elles apportent pourtant un précieux contrechamp aux propos rilkéens. Il est assez surprenant, d’ailleurs, que les éditeurs aient fait le choix, depuis 1929, de les occulter (un aspect qu’élucide l’universitaire Erich Unglaub dans son éclairante postface).
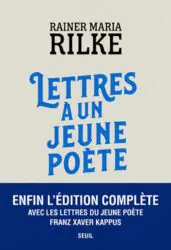 Cette édition complète vient ainsi jeter une nouvelle lumière sur les célèbres Lettres à un jeune poète, œuvre considérée comme un vade-mecum et un socle spirituel par de nombreux inconditionnels, notamment aux États-Unis. Composée de vingt-trois lettres (douze de Kappus, onze de Rilke – certaines non retrouvées), cette correspondance s’étend de la fin de l’automne 1902 au début janvier 1909. C’est l’époque où Rilke publia certains de ses plus grands textes, dont l’essai Auguste Rodin (1903), Chant d’amour et de mort du cornette Christoph Rilke (1904) et Le livre des heures (1905). Refusant de se prononcer sur la valeur des vers que lui envoie Kappus, Rilke émet plutôt des considérations d’ordre psychologique et existentiel à propos de la solitude, du silence, de la beauté, de l’amour, de l’acte créateur, parmi d’autres sujets analogues. On découvre ici que Rilke répondait avec sincérité et humilité à des questions soulevées par son destinataire, lequel, comme l’ensemble de sa génération, était dévoré par le doute, l’ironie et le scepticisme.
Cette édition complète vient ainsi jeter une nouvelle lumière sur les célèbres Lettres à un jeune poète, œuvre considérée comme un vade-mecum et un socle spirituel par de nombreux inconditionnels, notamment aux États-Unis. Composée de vingt-trois lettres (douze de Kappus, onze de Rilke – certaines non retrouvées), cette correspondance s’étend de la fin de l’automne 1902 au début janvier 1909. C’est l’époque où Rilke publia certains de ses plus grands textes, dont l’essai Auguste Rodin (1903), Chant d’amour et de mort du cornette Christoph Rilke (1904) et Le livre des heures (1905). Refusant de se prononcer sur la valeur des vers que lui envoie Kappus, Rilke émet plutôt des considérations d’ordre psychologique et existentiel à propos de la solitude, du silence, de la beauté, de l’amour, de l’acte créateur, parmi d’autres sujets analogues. On découvre ici que Rilke répondait avec sincérité et humilité à des questions soulevées par son destinataire, lequel, comme l’ensemble de sa génération, était dévoré par le doute, l’ironie et le scepticisme.
Lettres à Anita Forrer
Un lien spirituel similaire se forgerait onze ans plus tard dans un autre échange épistolaire, d’abord révélé par les Éditions Insel en 1982 puis rendu accessible en français pour la première fois en 2021. Les Lettres à une jeune poétesse3 rassemblent soixante-dix lettres échangées entre l’hiver 1920 et l’été 1926 par le poète et Anita Forrer (1901-1996), une jeune admiratrice qui deviendrait, quelques années plus tard, l’amie et l’exécutrice testamentaire de l’écrivaine, photographe et aventurière suisse Annemarie Schwarzenbach. Elle-même originaire de Suisse alémanique (elle était la fille d’un avocat et homme politique en vue à Saint-Gall), Forrer n’avait que dix-huit ans, c’est-à-dire le même âge que Ruth, la fille de Rilke et de Clara Westhoff-Rilke, lorsqu’elle écrivit au poète pour lui exprimer « l’émotion profonde » qu’elle ressentait à la lecture de ses œuvres : « Vous avez une langue qui résonne et qui vit en notre for intérieur. Et ce que vous dites continue de travailler en nous ».
 Même s’il avait déjà fait paraître l’essentiel de son œuvre poétique et narrative à cette époque, Rilke n’avait pas encore publié ses Élégies de Duino et ses Sonnets à Orphée (qui datent tous deux de 1922). Le poète semble désormais plus à l’aise avec son statut de guide. Il réagit volontiers aux commentaires d’Anita à propos de ses œuvres, en particulier les Histoires du bon Dieu (1900) et Les cahiers de Malte Laurids Brigge (1910), qui ont laissé une forte impression sur la jeune fille. Quand sa correspondante lui envoie quelques poèmes, Rilke lui suggère d’opter pour la prose, plus apte selon lui à l’expression précise et nette des sentiments. Encore une fois, la littérature est synonyme d’attention tournée vers la vie. Ainsi quand Rilke fait cadeau à Anita d’un exemplaire des Fleurs du mal pour ses vingt ans, il précise que cet ouvrage « somptueux et terrible » est « un livre pour la vie, pour toute vie, devrait-on dire, et qui dépasse largement, très largement la contenance de votre cœur d’aujourd’hui ». Une intimité faite de confiance et de bienveillance s’instaure entre les deux épistoliers, qui ne se rencontreront cependant que deux fois ; une intimité qui incite Anita à s’ouvrir, à mots couverts, sur l’amour que lui inspire une autre femme… Si, au fil des ans, les lettres du poète se font plus rares4, elles laisseront une marque indélébile dans le cœur de la jeune femme. Grâce à Rilke, la future graphologue aura appris à « empoigner la vie » et à « ne plus se laisser jeter à terre ».
Même s’il avait déjà fait paraître l’essentiel de son œuvre poétique et narrative à cette époque, Rilke n’avait pas encore publié ses Élégies de Duino et ses Sonnets à Orphée (qui datent tous deux de 1922). Le poète semble désormais plus à l’aise avec son statut de guide. Il réagit volontiers aux commentaires d’Anita à propos de ses œuvres, en particulier les Histoires du bon Dieu (1900) et Les cahiers de Malte Laurids Brigge (1910), qui ont laissé une forte impression sur la jeune fille. Quand sa correspondante lui envoie quelques poèmes, Rilke lui suggère d’opter pour la prose, plus apte selon lui à l’expression précise et nette des sentiments. Encore une fois, la littérature est synonyme d’attention tournée vers la vie. Ainsi quand Rilke fait cadeau à Anita d’un exemplaire des Fleurs du mal pour ses vingt ans, il précise que cet ouvrage « somptueux et terrible » est « un livre pour la vie, pour toute vie, devrait-on dire, et qui dépasse largement, très largement la contenance de votre cœur d’aujourd’hui ». Une intimité faite de confiance et de bienveillance s’instaure entre les deux épistoliers, qui ne se rencontreront cependant que deux fois ; une intimité qui incite Anita à s’ouvrir, à mots couverts, sur l’amour que lui inspire une autre femme… Si, au fil des ans, les lettres du poète se font plus rares4, elles laisseront une marque indélébile dans le cœur de la jeune femme. Grâce à Rilke, la future graphologue aura appris à « empoigner la vie » et à « ne plus se laisser jeter à terre ».
1. Lettre à Baladine Klossowska du 16 décembre 1920.
2. Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète, traduit de l’allemand par Sacha Zilberfarb, Seuil, Paris, 2020, 145 p. ; 36,95 $.
3. Rainer Maria Rilke, Lettres à une jeune poétesse. Correspondance avec Anita Forrer 1920-1926, édition et traduction de Jeanne Wagner et Alexandre Pateau, Bouquins, Paris, 2021, 244 p. ; 29,95 $.
4. Rappelons que Rilke, atteint de leucémie, meurt à la fin de l’année 1926.
Dès que je me serai tout entier rassemblé, je plongerai les yeux dans mon âme et me demanderai : dois-je écrire ? Mais alors me viendront ces pensées qui se pourchassent comme des hirondelles, et qui me font si peur. Je connais trop ces heures silencieuses qui viennent sans qu’on les appelle et aspirent au soleil qui brille si loin d’elles. Au sortir de telles nuits, rompu de fatigue et sans espoir, je reste là, avec mes pensées forcées dans leurs derniers retranchements : qui suis-je ? d’où vient tout cela ? où cela va-t-il ? alors des mots prennent vie, presque contre mon gré, comme des délivrances. (Franz Xaver Kappus à Rainer Maria Rilke, 24 février 1903)
Lettres à un jeune poète, p. 16-17.
Car rien d’autre n’importe que ceci : la solitude, la grande solitude intérieure. Entrer en soi, ne rencontrer personne pendant des heures – voilà à quoi il faut parvenir. Être seul, comme on était seul enfant, quand les adultes allaient et venaient, absorbés dans des choses qui paraissaient grandes et importantes, parce que les grands avaient l’air si affairé et qu’on ne comprenait rien à ce qu’ils faisaient.
(Rainer Maria Rilke à Franz Xaver Kappus, 23 décembre 1903)
Lettres à un jeune poète, p. 55.
Vous feriez mieux de vous exercer à noter vos sentiments en prose. Je ne saurais vous mettre suffisamment en garde contre la tentation de la rime, qui viole et aliène imperceptiblement ce qu’on pensait lui confier, et qui, en vérité, se perd en cours de route quand on tente une transformation poétique sans la maîtriser pleinement. Il n’est pas sans danger pour notre propre véracité de se réfugier dans une forme qui nous dénature, nous gâte et nous rabaisse un peu, là où l’on voudrait reconnaître notre image la plus chère. En prose […], vous êtes capable d’esquisser précisément et nettement vos sentiments.
(À Anita Forrer, 16 janvier 1920)
Lettres à une jeune poétesse, p. 30.
Oh Rainer, j’ai tellement honte ! Je viens tout juste de me rendre compte de ce que ça signifie, que vous m’écriviez. Je ne peux pas l’exprimer par des mots, Rainer. Cela m’étouffe tellement, c’est trop grand. Ça me rend si heureuse que je voudrais traverser toutes les pièces à perdre haleine et aller me faire tremper sous la pluie. Et ensuite ce sentiment est si clair et si limpide, Rainer, que j’aimerais rester allongée, les yeux fermés, à réfléchir et rêver. […] La vie est parfois si extraordinaire, comme ça, à vouloir être vécue […].
(À Rainer Maria Rilke, 27 mai 1921)
Lettres à une jeune poétesse, p. 138-139.











