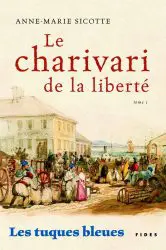Ils sont nombreux les ouvrages consacrés aux effervescences de la décennie 1830 ; Anne-Marie Sicotte1 en renouvelle pourtant la description. À tel point que Saint-Denis et Saint-Charles, au lieu de constituer les sommets de la protestation, en deviennent les corollaires tristement prévisibles. L’histoire, entre ses mains, fait l’impasse sur les dates et les noms illustres pour redevenir la marche du peuple vers son destin.
Dès les premières pages du récit, la langue affirme ses droits ; elle est en prise directe avec l’époque : savoureuse, inventive, honnête. Elle exprime la dignité, non le misérabilisme du joual. Le fils qui revient à la maison familiale se débagage ; disparue de nos usages, l’expression est néanmoins intelligible et évocatrice. Si quelqu’un raconte une tragédie avec une trop pénétrante force d’évocation, l’auditrice l’invite à s’encalmer, car elle a le pesant. À propos de la sexualité, les termes étonneront plus que les faits eux-mêmes : oui, les lupanars existaient, mais ils s’appelaient maisons déréglées. Des ébraillées s’y chargeaient de l’accueil des clients avec le savoir-faire des courtisanes de tous les temps…
Cette langue, fidèle aux sentiments et aux mœurs de l’époque, en ressuscite à merveille l’atmosphère. Lecteurs et lectrices partageront plus aisément les joies et les malaises du siècle dont ils proviennent. La table est mise.
Anne-Marie Sicotte peint une société québécoise aux prises avec deux forces parfois dissociées, mais plus souvent en parfaite connivence : la Couronne britannique et les appétits carnassiers de la minorité anglaise du Québec. Respectueux du régime établi lors de la Conquête, les francophones québécois osent même espérer que Londres ramènera à l’ordre les marchands anglais trop gourmands : ils enverront donc périodiquement des émissaires plaider leur cause auprès du pouvoir royal. Efforts répétés, mais promis à la stérilité puisque les marchands anglais profitent de la même écoute et qu’ils peuvent, en attendant, interpréter à leur gré les silences de Londres. Dans le quotidien des choses, que Londres soit ou non au courant des abus de la minorité anglaise de la colonie, les francophones ne peuvent obtenir justice ni auprès de la magistrature, ni auprès des gestionnaires, ni auprès des divers gardiens de l’ordre. Au jour le jour, les brimades s’accumulent, les dénis de justice stérilisent les droits, les humiliations blessent plus cruellement.
Ainsi reconstituée dans le maillage des jours et des existences, la montée de la colère populaire s’explique par autre chose que ce qu’affirme une certaine lecture de l’histoire ; elle découle d’abord non de la rhétorique de quelques tribuns, mais de l’écrasement d’un peuple brimé par ses vainqueurs. Ce n’est pas, comme le disait la chanson, « la faute à Papineau », mais le sursaut d’une population contrainte de choisir entre l’agenouillement et l’imprudence armée.
Alliés de tous poils
Comme la nature humaine demeure la même d’un siècle à l’autre, il fallait s’attendre à ce que la puissante minorité anglaise gagne à sa cause et à ses privilèges certains éléments de la majorité francophone. Dès qu’une occupation se met en place au lendemain d’une victoire militaire, les collabos surgissent. Certains, comme les Sulpiciens, pactisent sans nuance ni vergogne avec les représentants locaux de la Couronne ; d’autres, fiers-à-bras ou carriéristes, modulent leur soutien selon les occasions électorales ou marchandes.
Des Sulpiciens, les personnages préférés de l’auteure pensent le plus grand mal. « Cet ordre religieux, encombré de Français imbus de principes aristocratiques, préfère lécher les bottes de l’Exécutif de la province, comme l’a prouvé le projet odieux de brader leurs immenses seigneuries au gouvernement britannique. » Chose certaine, leur porte-parole Quiblier met tout en œuvre pour que cesse l’enseignement d’où pouvaient venir l’instruction minimale et, par osmose, la prise de conscience.
Plus encore qu’à ces alliés inconditionnels de la domination britannique, Anne-Marie Sicotte fait large place aux petits et gros acteurs incertains, changeants, négociables. L’époque se prêtait d’ailleurs aux tergiversations. On pouvait bouillir de rage sans la manifester. On pouvait hésiter entre le conseil émis par le haut clergé et l’imprudent rejet du compromis. Comment trouver un emploi si on s’oppose ouvertement au pouvoir ? Le récit, émaillé de calculs qui vont du respectable au maquignonnage, fait comprendre à quel point devenait poreuse la ligne de démarcation entre ceux auxquels on pouvait se fier et les relations douteuses. Climat de méfiance, épisodes de déception cruelle, volte-face toujours à craindre. Le peuple, abruti de rumeurs visqueuses, risquait de perdre confiance en ses chefs. Cette pénétrante description de la décennie 1830 aide à expliquer le flou suicidaire de la rébellion armée : la méfiance brouillait les communications humaines, à tel point qu’aucune stratégie ne pouvait ni n’osait se formuler à haute voix.
Nos temps modernes, qui en savent (un peu) plus long sur les techniques de provocation qu’affectionnent la loi et l’ordre, s’étonneront sans doute que les pouvoirs de l’époque aient su eux aussi comment provoquer les incidents. De mille manières, on incitait les patriotes à prendre les armes, dans l’espoir de justifier ainsi l’entrée en scène des canons de Colborne. Autres temps, mêmes mœurs. Le constater peut infléchir le jugement que nous portons aujourd’hui sur les années 1837-1838 : au lieu de conclure à l’irréalisme des patriotes, peut-être peut-on penser, plus fraternellement, qu’ils n’avaient pas plus de latitude que les modernes partisans du « indignez-vous ».
Infiniment plus plausible et plus décapante que celle de trop de manuels, l’histoire selon Anne-Marie Sicotte donne la parole au peuple plus qu’aux dates et aux célébrités.
1. Anne-Marie Sicotte, Le charivari de la liberté, T. 1, Les tuques bleues, Fides, Montréal, 2014, 735 p. ; 29,95 $.
EXTRAITS
Une lutte féroce a lieu dans les comtés où les favoris du régime peuvent compter sur bon nombre de « serfs », ces hommes qui doivent leur gagne-pain, leur commerce ou leurs propriétés foncières à l’appui qu’ils donnent aux ennemis du pays.
p. 202
À Saint-Denis, les écoles ont été fermées, hormis celle du bourg consacrée aux garçons et que le curé finance par ses dîmes, et celle que tiennent les Dames de la Congrégation pour les filles. Dans les paroisses environnantes, la même situation prévaut.
p. 432
Dépouillé de son masque de réformiste, Gosford est indigne de la noblesse de sa charge. Il n’a pas destitué Samuel Gore de son poste de juge, ni William Bowman Felton de son poste de commissaire des terres de la Couronne. Il a plutôt remisé le dossier sur une lointaine tablette !
p. 408