L’écriture peut-elle sublimer le quotidien ? Gagne-t-elle à modeler une matière aussi peu noble que le routinier défilement d’événements relevant plutôt, en réalité, du non-événement ? Et si, au fond, elle pouvait justement servir à dévoiler ce qui, à force d’habitude, échappe à notre intérêt, et par là même à la possibilité d’y jeter un nouveau regard ? Nul besoin de coups de feu pour servir une histoire, pas plus que de péripéties rocambolesques ; à lire Lula Carballo et Simon Brousseau aux éditions du Cheval d’août, il suffirait d’ouvrir l’œil, puis d’aiguiser ses crayons. Place à la fascinante aventure de l’ordinaire.
Petites vies, petites misères
Dans un hameau anonyme au tracé imprécis, inspiré de la campagne uruguayenne où a grandi Lula Carballo, des femmes vivent ou survivent, mais inscrivent toutes, obstinées, leur vacillante destinée dans le creux des jours qui passent et se ressemblent. Au milieu d’elles évolue la narratrice-enfant de Créatures du hasard1, dont la voix, d’inspiration ducharmienne, tisse la toile complexe des rapports qu’entretiennent les habitantes du village, recense leurs rituels coups durs et leurs timides réjouissances.
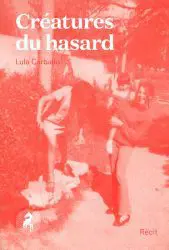 Le milieu présenté n’a rien de l’annexe du paradis. Si certains ont associé l’œuvre de Carballo au réalisme magique, il faut admettre que la magie tient plus ici du mauvais œil que de la fée des étoiles. Le ton a la dureté cynique d’une narration factuelle, dépouillée d’émotions face à une réalité qui en appellerait facilement de bien pathétiques. La légèreté de la jeunesse prévaut donc devant les cabanes encombrées, soulevées par la vermine, empestant l’odeur âcre des vidanges brûlées en plein cœur de la rue. Elle prime encore devant Lune, le lapin mort de la narratrice pouilleuse, et son bâtard de chien avec lequel elle joue quand elle ne pulvérise pas des escargots ou ne croque pas quelques cafards dans le jardin.
Le milieu présenté n’a rien de l’annexe du paradis. Si certains ont associé l’œuvre de Carballo au réalisme magique, il faut admettre que la magie tient plus ici du mauvais œil que de la fée des étoiles. Le ton a la dureté cynique d’une narration factuelle, dépouillée d’émotions face à une réalité qui en appellerait facilement de bien pathétiques. La légèreté de la jeunesse prévaut donc devant les cabanes encombrées, soulevées par la vermine, empestant l’odeur âcre des vidanges brûlées en plein cœur de la rue. Elle prime encore devant Lune, le lapin mort de la narratrice pouilleuse, et son bâtard de chien avec lequel elle joue quand elle ne pulvérise pas des escargots ou ne croque pas quelques cafards dans le jardin.
L’auteure préfère son réalisme sombre et d’une impudence ravageuse. Les multiples créatures féminines présentées goûteront, leur tour venu, à la même médecine. Parmi ce gynécée où l’homme brille par son absence ou son mutisme, la mère de la narratrice joue, tare familiale, ses maigres revenus dans les machines à sous, avec cet espoir secret d’échapper à son sort de représentante Avon monoparentale ; elle gratte, afin de découvrir un jour le bonheur caché sous la case d’un billet de loterie. En attendant, le bonheur, c’est nul si découvert : la chance se laisse attendre, le Diazépam fait le reste.
Léo, l’arrière-grand-mère guérisseuse, mise quant à elle à la Quiñelaou au Conga, alors que sa fille Régina lui vole régulièrement sa pension pour alimenter sa passion de la roulette. Toutes s’en remettent aux impénétrables lois du hasard pour accéder à un avenir meilleur, mais aucune ne semble échapper à cette fatalité qui veut que plus on s’évertue à trouver la prospérité de cette façon, plus on s’enfonce dans l’infortune. Affichant ce mélange incongru de sagesse et de candeur, la narratrice montre en revanche que les douceurs de la vie sont accessibles à qui veut s’y disposer, que sous sa couche banale et superficielle, le quotidien dissimule bel et bien de modestes mais non moins appréciables voluptés.
La boîte à souvenirs
Les récits de Lula Carballo sont livrés sans chronologie précise. Ils forment un bric-à-brac d’instantanés tirés aléatoirement de la mémoire d’une jeune fille. La forme répond donc elle aussi au titre : les portraits de ces créatures surgissent, comme pigés au hasard d’une boîte de souvenirs, parmi les papiers de bonbons Candel, les radiocassettes de Marilina Ross, les tickets de Quiñela perdants ou les vieux billets de bus reproduits dans les pages de l’ouvrage. D’autres fragments d’existence bruts et imparfaits ressemblent davantage aux artéfacts familiaux que récupère la narratrice du fatras d’ordures entourant sa maison. Le beau, en résumé, y côtoie le laid.
Entre la présentation de ces femmes qui s’activent dans les tranchées du quotidien se faufilent quelques morceaux de félicité arrachés à la misère ambiante. Encore une fois, rien d’extravagant, que le souvenir de plaisirs humbles : déshabiller un bonbon Candel, parfois dérobé chez l’épicier du coin, pour le laisser fondre sur sa langue ; engloutir un feuilleté à la crème et aux fraises en revenant d’une rencontre Avon ; dévorer l’ananas blotti au centre d’un aspic tremblotant. La mémoire de l’enfance est d’abord gustative, suggèrent ces quelques moments de grâce.
Elle n’est pas non plus que cela. Les joies de la jeunesse sont aussi celles des mises en scène qui consistent à devenir quelqu’un d’autre durant un bref moment. Lorsque sa mère s’absente, il suffit d’une serviette épinglée derrière sa nuque pour que la narratrice devienne une actrice célèbre, adulée par ses amoureux et le monde entier. Drapée d’un bout de satin rouge, elle se transforme soudain en Freddie Mercury, le temps d’une performance endiablée sur l’air de « We Will Rock You ». Des prestations lumineuses sur fond gris, quelques souvenirs sucrés pour adoucir les journées amères, que Lula Carballo prend soin d’enrober, à la façon d’un précieux Candel, dans la langue simplissime de l’enfance.
Les petits riens de Simon Brousseau
 « Comment sait-on si une histoire se termine bien ? » Cette question, posée en quatrième de couverture du dernier livre de Simon Brousseau, met d’ores et déjà la table pour le petit festin de récits ingénieux auquel nous convie cette seconde publication de l’auteur après Synapses, paru en 2016 aux mêmes éditions du Cheval d’août. L’interrogation comporte au surplus quelque chose de retors : pour se terminer bien, une histoire ne doit-elle pas, avant tout, mettre en scène une perturbation minimale, donner à voir une amélioration conséquente pour conduire ultimement vers une fin dite « heureuse » ?
« Comment sait-on si une histoire se termine bien ? » Cette question, posée en quatrième de couverture du dernier livre de Simon Brousseau, met d’ores et déjà la table pour le petit festin de récits ingénieux auquel nous convie cette seconde publication de l’auteur après Synapses, paru en 2016 aux mêmes éditions du Cheval d’août. L’interrogation comporte au surplus quelque chose de retors : pour se terminer bien, une histoire ne doit-elle pas, avant tout, mettre en scène une perturbation minimale, donner à voir une amélioration conséquente pour conduire ultimement vers une fin dite « heureuse » ?
Or, Les fins heureuses2 rassemble 21 nouvelles pour la plupart sans chute – à moins d’admettre une portée fort élargie à ce terme –, autant d’épisodes tranchés dans le vif de la vie de tous les jours, s’éclairant entre eux par un subtil jeu d’échos, de retours et de clins d’œil. Que ce soit dans le choix de ses sujets ou dans le traitement qu’il leur accorde, Brousseau opère par une espèce de poétique de la banalisation et de la banalité qui exclut toute impression d’inusité ou d’extraordinaire.
Un cas particulièrement savoureux traduisant ce mode opératoireest offert avec « Tout ce qui brille ». Dans ce récit qui est aussi l’un des mieux menés du recueil, Simon, le narrateur, étudie en philosophie et doit composer avec les contraintes financières que cela implique. Le propriétaire de son logement, Robert, pour l’aider avec un loyer qu’il peine depuis des mois à réunir, lui soumet la proposition indécente suivante : Simon n’aura dorénavant qu’à lui uriner dessus, à raison d’une fois par mois, en échange de quoi les frais de l’appartement seront automatiquement réglés. Voici maintenant la scène de clôture durant laquelle le philosophe en herbe rend sa décision à l’homme : « — Simon ? Tu peux entrer, la porte n’est pas barrée. — Robert… je voulais juste te dire que je ne viendrai pas. Je vais au cinéma. — D’accord. Je comprends… Tu vas voir quel film ? — Mademoiselle, le dernier film de Park Chan-wook, un réalisateur sud-coréen. — OK. Amuse-toi bien. Écoute… je vais m’absenter pour quelques jours encore. Veux-tu continuer à arroser mes plantes ? »
« Arroser » les plantes plutôt que le vieillard, on en conviendra, écarte le moindre dilemme moral. Même lorsque Brousseau traite de sujets au fort potentiel insolite, il les neutralise de la sorte en adoptant le ton du dialogue sur la pluie et le beau temps.
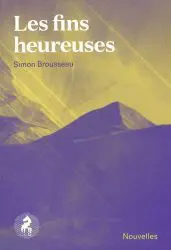 À l’occasion de deux brèves incursions du côté de la fiction d’anticipation, l’écrivain préfère par exemple concentrer son regard sur la tranquille inertie de ce qui échappe au délitement du monde en cours. Dans le très beau « Journal de la fin », le narrateur sait que la destruction de la planète est imminente. Le pompage des immenses nappes d’hydrocarbures a partout laissé des poches vides qui ont désaligné l’axe de la Terre et l’ont sortie de son orbite. Plutôt que de réaliser ses rêves, le personnage se contente pourtant de moments de tendresse paisibles en compagnie de son amoureuse et de son chien. Cuisiner une sauce à spaghetti, se blottir devant la chaleur crépitante d’un feu de foyer, projeter de faire un enfant : les bonheurs, quand l’échéance plane, restent toujours modestes, tandis que la menace d’une disparition redonne soudain leur pleine importance à ces petits riens familiers dont Brousseau nous dit finalement qu’ils sont le sel de la vie.
À l’occasion de deux brèves incursions du côté de la fiction d’anticipation, l’écrivain préfère par exemple concentrer son regard sur la tranquille inertie de ce qui échappe au délitement du monde en cours. Dans le très beau « Journal de la fin », le narrateur sait que la destruction de la planète est imminente. Le pompage des immenses nappes d’hydrocarbures a partout laissé des poches vides qui ont désaligné l’axe de la Terre et l’ont sortie de son orbite. Plutôt que de réaliser ses rêves, le personnage se contente pourtant de moments de tendresse paisibles en compagnie de son amoureuse et de son chien. Cuisiner une sauce à spaghetti, se blottir devant la chaleur crépitante d’un feu de foyer, projeter de faire un enfant : les bonheurs, quand l’échéance plane, restent toujours modestes, tandis que la menace d’une disparition redonne soudain leur pleine importance à ces petits riens familiers dont Brousseau nous dit finalement qu’ils sont le sel de la vie.
L’humanité de travers
Attentif aux petits riens, l’écrivain se montre aussi à l’affût des travers de la nature humaine dont il témoigne avec beaucoup de justesse. Ses dispositions aiguisées de moraliste moderne, il les met notamment en pratique dans les quatre séries de « E-confessions », qui empruntent à l’apparente légèreté de la chronique des cœurs brisés. Grâce à ce confessionnal virtuel, tout un chacun peut se délester de culpabilités souvent risibles. Chaque fois, ces confidences anonymes touchent pourtant la cible. Nombreux d’ailleurs se reconnaîtront quelque honteuse et inavouable imperfection à la lecture de certaines de ces perles, d’autant plus que la gamme des vices évoqués est variée : « Je me masturbe en pensant à mes employées » ; « J’ai besoin de me droguer pour avoir du plaisir »; « Mon dieu que je suis avare. Hostie que je le suis » ; « Mon beau-frère est bon dans tout et je le déteste ».
Un humour teinté d’une douce paranoïa traverse plusieurs nouvelles. La suite des quatre « Lettres à un nageur » cultive en plus le malaise créé par un narrateur qui interprète chaque événement dérogeant à sa routine de nage comme le signe d’un affront de la part d’un autre baigneur. Si la première lettre invite ce dernier à reconsidérer sa présence dans le couloir rapide, la seconde l’accuse d’avoir volé une serviette de plage à l’image du Canadien de Montréal, alors que la troisième verse carrément dans les menaces. Brousseau sait brasser beaucoup d’eau autour d’une situation à première vue anodine.
En de plus rares occasions, il peut également se montrer grave. « La physique des boules de billard » aborde la grève étudiante en adoptant la perspective des manifestants. La tension entre les gardiens de l’ordre et la foule monte d’un cran quand l’arsenal des mesures coercitives est peu à peu déployé : après le poivre de cayenne et les injures suivent une pluie de matraques, puis le sifflement des balles de caoutchouc. En guise de représailles, une boule de billard décrira une trajectoire un peu trop précise et changera l’allure de la soirée.
Pour les tristes mortels que nous sommes, les petits riens jalonnent l’existence humaine bien plus que les événements hauts en couleur. C’est pourquoi rendre dignes d’intérêt le commun et le familier relève en soi d’un pari risqué. La forme, le style, quelque chose comme des filtres sont nécessaires à l’ajout d’une autre dimension, esthétique celle-là, à cette expérience de la monotonie. Cela, Lula Carballo et Simon Brousseau l’ont bien compris.
1.Lula Carballo, Créatures du hasard, Le Cheval d’août, Montréal, 2018, 160 p. ; 19,95 $.
2. Simon Brousseau, Les fins heureuses, Le Cheval d’août, Montréal, 2018, 206 p. ; 24,95 $.
EXTRAITS
Je passe mes jours égarée au milieu des décombres que ma famille accumule sur le terrain voisin. Penchée vers le sol, je renifle l’odeur de cendre du rituel des sorcières qui m’entourent. Je cherche des trésors, un rat surgit d’un sac éventré. […] Les femmes de ma vie ne sortent pas les poubelles, elles les brûlent. Je suis une petite bête aux cheveux emmêlés, aux ongles sales, aux dents cariées et au ventre vide.
Lula Carballo, Créatures du hasard, p. 11.
Sa vie est rangée dans une boîte que nous vidons sur la table : Régina m’embrasse. Régina enlace son amant en riant aux éclats. Ma mère déchire les photos. Régina fait la fête avec des amis, chancelante. Ma mère déchire la photo. Régina danse. Je garde celle-là.
Lula Carballo, Créatures du hasard, p. 143.
Ces histoires, banales, se ressemblent toutes et m’attendrissent à chaque fois. Dire de ces couples qu’ils sont semblables ne signifie pas qu’ils sont sans intérêt, et qu’il n’y ait rien à raconter à leur sujet est leur plus belle qualité. Leur joie est silencieuse et refuse qu’on parle d’elle.
Simon Brousseau, Les fins heureuses, p. 51.
Lorsqu’un de mes proches connaît du succès, je suis incapable de me réjouir avec lui. […] Je méprise mon hypocrisie et la façon dont j’élève exagérément le ton pour dire hey, je suis tellement contente pour toi, ma chérie, alors que mon cœur trempe dans le vinaigre de l’envie. Mon cœur est un œuf dur oublié dans un pot Mason sur le comptoir d’une taverne où s’ennuie un ivrogne qui observe en silence, dans le miroir de sa bouteille, son visage de plus en plus flou.
Simon Brousseau,Les fins heureuses, p. 132.










