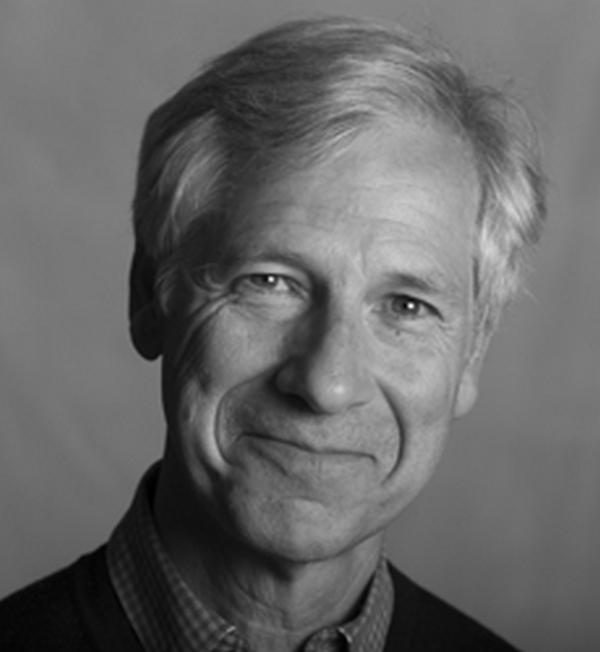Écrivain discret, Yvon Rivard a patiemment construit au fil des ans une œuvre romanesque aussi forte que singulière, ce dont témoigne l’accueil chaleureux qui lui a jusqu’ici été réservé : Prix du Gouverneur général du Canada, en 1986, pour Les silences du corbeau, Prix Gabrielle-Roy, en 1994, Grand Prix du livre de Montréal pour son roman Le milieu du jour, en 1996, et à nouveau en 2005 pour son plus récent roman, Le siècle de Jeanne.
Yvon Rivard manie les mots, les phrases avec une adresse, une aisance certaine. Tout en ayant l’air de n’effleurer que la surface des choses, il nous plonge au cœur de ce qui compose le drame de nos existences : qui sommes-nous ? d’où venons-nous ? où allons-nous ? La densité et la richesse de l’œuvre reposent en partie sur cette constante interrogation qui a toutefois le grand mérite de ne jamais se faire au détriment du déroulement romanesque. Forme et fond sont non seulement indissociables, mais sont en parfaite symbiose avec le projet poursuivi par l’auteur. Le siècle de Jeanne, le cinquième roman d’Yvon Rivard, vient clore la trilogie amorcée avec Les silences du corbeau. Nous y retrouvons les mêmes personnages qui composaient le noyau des romans précédents : Alexandre, écrivain, qui a maintenant atteint la cinquantaine, Françoise et Clara, les femmes qu’il n’a cessé d’aimer sans pour autant les atteindre, Alice, sa fille devenue à son tour adulte et mère d’une petite fille qui occupe dans le dernier volet une place centrale. Les personnages demeurent aux prises avec ce qu’il est convenu d’appeler les grandes questions existentielles, sous des angles différents, sans jamais perdre leur dimension profondément humaine. Il y a chez Yvon Rivard un parti pris manifeste pour l’intégrité du personnage, son indépendance, son incarnation en chair tout autant qu’en pensées. Et cela sans restreindre la complexité qui le caractérise.
Lors d’un entretien avec l’auteur, au moment de la parution du second volet de la trilogie, Le milieu du jour, les mots de Peter Handke placés en exergue du roman avaient lancé notre discussion : « La question pour tout narrateur devrait toujours être : comment sauver mon héros ». La lecture du Milieu du jour m’avait laissé songeur sur ce point et j’avais retourné la question au romancier, d’autant que le narrateur du second roman, qui n’est jamais nommé, ne pouvait qu’être associé au narrateur du premier roman, au personnage d’Alexandre, parti comme tant d’autres rechercher sa propre vérité dans un ashram de Pondichéry en compagnie de marginaux, égarés comme lui dans un siècle qui avait connu tant de bouleversements sur les plans individuel et social. « Ce n’est pas évident, avait alors répondu Yvon Rivard, mais je sais qu’il l’a sauvé parce qu’il va y avoir un autre livre, beaucoup plus court celui-là, qui, sans reprendre toute la problématique amoureuse, va permettre au personnage d’atteindre un certain apaisement. » S’il n’a pas vu juste quant à la longueur du roman qui suivrait, Le siècle de Jeanne ne voit pas moins Alexandre connaître l’apaisement au terme d’un long retour sur sa propre vie, retour qui donne ici à l’enfance une place prépondérante.
Le salut de l’enfance
« Je le lui avais promis, je l’ai fait. » Ainsi débute le dernier volet de la trilogie. La promesse s’adresse à Jeanne, la petite-fille d’Alexandre, envers qui il s’est engagé, une fois de retour à Paris, à se rendre à un endroit précis des quais de la Seine d’où l’on aperçoit Notre-Dame afin d’y jeter un caillou en pensant à elle. Alexandre se surprend, en réalisant sa promesse, à réitérer aussitôt le vœu de revenir un jour au même endroit, avec Jeanne cette fois, vœu qu’il regrette aussitôt parce qu’il le distrait du bonheur d’être là, de vivre pleinement le moment présent. Jeanne, par sa naïveté, son innocence, agit en quelque sorte comme catalyseur et redonne à l’instant présent toute la force d’ancrage qui a toujours fait défaut à Alexandre, et sans laquelle aucun apaisement n’est possible. « Jeanne existe, et désormais mon cœur est une chambre dans laquelle je ne suis plus jamais seul. Jeanne existe, et il n’y a plus de grandes questions que je ne puisse contenir, ma pensée est désormais un cœur dans lequel le temps s’arrête et commence mille fois par jour. Jeanne existe et lorsqu’elle décrète que c’est l’heure du spectacle, tous les champs autour de la balançoire convergent vers sa petite robe rouge, comme la procession des siècles vers ce seul et unique instant. »
Personnage central du roman, Jeanne est celle par qui la réconciliation avec le passé d’Alexandre (comme celui qui le lie à Françoise, à Alice, à ses parents) devient possible en ce qu’elle permet de dénouer l’impasse dans laquelle les différents échecs amoureux d’Alexandre l’ont plongé, mais également celle par qui l’avenir (le siècle qui s’amorce) peut enfin prendre forme et laisser entrevoir l’apaisement tant recherché. Jeanne, c’est bien sûr l’enfance, à la fois celle que l’on a trop tôt perdue ou refusée, et qui permet à Alexandre de rétablir une correspondance avec ce qu’il n’a cessé de chercher, tout au long de ses années d’errance entre Pondichéry, Paris, Montréal et Cape Cod, ce que Virginia Woolf appelait « l’extrême réalité ». Cette dernière n’est le plus souvent accessible que par le jeu, ou l’imaginaire, qui est le mode privilégié de l’adulte pour renouer avec l’enfant enfoui, oublié en chacun. Alexandre mettra beaucoup de temps à accepter ce constat, et c’est grâce à Jeanne, aux jeux qu’il partage avec elle qu’il y parvient enfin. « Mon erreur de père, avouera Alexandre, ce n’est pas tant de ne pas avoir imposé de limites à Alice que d’avoir interrompu trop souvent et brutalement ses jeux, son enfance, par mes propres jeux d’adulte qui ne savait plus jouer : chut, papa écrit, papa aime, papa souffre. »
Faisant écho à la trilogie, à la thématique déployée dans chaque volet, le roman se divise en trois parties. La première se déroule à Paris où Alexandre a déjà vécu avec Françoise et Alice. À nouveau seul, comme il l’était dans Les silences du corbeau, Alexandre repense à sa vie passée en espérant la venue de Clara, cette autre femme qu’il n’a cessé d’aimer et qui donnait une texture différente à sa vie, à son écriture. Jamais elle ne lui a pardonné l’enfant qu’il lui a refusé. Leur rencontre, vingt ans plus tôt, marquait pour Alexandre la fin d’une étape avec Françoise, mais également le refus d’amorcer autre chose avec Clara. « Longtemps j’ai associé la rencontre de Clara avec la fin de ma vie imaginaire, qui n’était pas tant l’invention d’une autre vie que le désir de ne pas mourir. Clara était celle, me disais-je, qui m’avait cloué au réel, celle par qui le scandale du temps arrivait, celle qui allait me faire passer de la poésie du matin à la prose de l’après-midi. »
Mais c’est maintenant à Jeanne qu’il écrit chaque jour, redécouvrant par les yeux de l’enfant le tracé d’une ville et le parcours d’une vie. Alexandre prend soudain la mesure du drame qui a marqué la vie des femmes qui ont jusque-là le plus compté pour lui. « Je ne peux m’empêcher de penser que l’histoire de ma fille (Alice) et des deux femmes que j’ai aimées (Françoise, Clara), c’est l’histoire des petites filles que leurs pères n’ont pas sauvées. » La faute des pères, poursuit Alexandre, c’est d’avoir laissé leurs petites filles se débrouiller seules avec cette chose immense qu’est la vie, d’avoir trop tôt renoncé à leur enfance, à l’innocence qui permet de construire en toute confiance des projets de vie. Au moment même où les autres femmes de sa vie, Françoise, Clara, Alice, voient leur vie leur échapper (la première est gravement malade, la seconde tente de se suicider à la suite d’un échec amoureux, et le mari de la troisième se noie sous ses yeux), Alexandre découvre en Jeanne la seule voie possible de bonheur : « Il n’y a que les enfants heureux qui peuvent se détacher sans peine de l’enfance ».
La fixité des choses
L’ombre de Virginia Woolf continue d’envelopper le dernier volet de la trilogie et de donner au projet romanesque d’Yvon Rivard une remarquable unité. Au moment de la parution du second volet, Le milieu du jour, la question avait été abordée. Le roman qui suivrait, avait-il alors souligné, chercherait à fusionner l’épuration de la forme romanesque et l’apaisement du personnage qui y évoluait depuis Les silences du corbeau, à capter la fixité des choses comme s’y efforçait Virginia Woolf. L’auteur avait même inscrit son projet dans le second volet de la trilogie : « Si je pouvais écrire un autre livre, confiait le narrateur du Milieu du jour, c’est cela que je montrerais, quelqu’un qui peu à peu oublie sa propre histoire en regardant le ciel, la mer, un caillou, un visage ». Et c’est précisément à cela qu’aspire Alexandre dans la troisième partie du roman qui clôt la trilogie : construire une œuvre dont la gravité, à l’image de celle qui traverse l’œuvre de Virginia Woolf, fait corps avec la sérénité. « L’art, le génie de Virginia, c’est d’avoir appris à mourir, d’avoir déjoué la mort le plus longtemps possible, en mourant dix fois, cent fois par jour, à chaque regard qui arrêtait la vie juste avant qu’elle ne s’écoule hors d’elle dans le désordre du temps, comme quelqu’un qui n’attendrait pas d’être au seuil de la mort pour voir défiler au ralenti les quelques images qui composent désormais sa vie, comme elle le dit dans Les vagues, ‘l’extrême fixité des choses qui passent’. »
Au moment où Françoise, Clara et Alice luttent chacune à leur façon pour leur propre survie, Alexandre s’éloigne à nouveau d’elles, quitte Montréal pour trouver refuge à Miscou où la mer et les vagues lui rappellent son dessein premier, son désir de se fondre dans chaque instant, de parfaire sa vie en trouvant enfin réponse aux questions qui le hantent. « Que faire ? Où aller ? Il me semble que j’ai passé ma vie à me poser ces questions et à chercher la réponse en moi-même, comme si j’étais porteur d’une vérité avec laquelle ma vie devait s’accorder. D’où la peur constante de me tromper (de lieu, de livre, de femme), peur de vivre sans le savoir la vie de quelqu’un d’autre et de mourir à côté de moi-même, de cet être que j’aurais ignoré et dont je croiserais le regard, évidemment, quelques secondes avant de mourir. »
Il n’y a pas que l’ombre de Virginia Woolf qui traverse ces pages. Henry David Thoreau, Goethe, Hölderlin, Lewis Carroll, Peter Handke, Saint-Denys Garneau, Julio Cortázar, pour ne nommer que ceux-là, accompagnent Alexandre dans sa quête. Les romans d’Yvon Rivard ne s’épuisent pas en une seule lecture, et le plaisir que l’on prend à fréquenter une telle œuvre s’accroît à chacune d’elles en ce qu’elle nous révèle chaque fois, tel un diamant, des dimensions qui nous avaient jusque-là échappé.
Yvon Rivard a entre autres publié :
Les silences du corbeau, Boréal, 1986 ; Le milieu du jour, Boréal, 1995 ; Le siècle de Jeanne, Boréal, 2005 ; Personne n’est une île, « Papiers collés », Boréal, 2006.
EXTRAITS
Moi qui ne connais que la ferveur et la nostalgie des aubes et des crépuscules, qui ne recherche que la complicité des jardins et des forêts, qui ne demande à l’amour qu’un peu d’ombre mêlée à beaucoup de mots, n’est-il pas temps que je traverse ce désert qu’est le milieu du jour ?
Les silences du corbeau, p. 66.
Nous ne sommes pas prêts, il nous reste tant de choses à apprendre, tant de choses à oublier. Comment parler ou se taire sans être seul. Comment vivre sans aussitôt souhaiter ou craindre la mort. Comment aimer sans meurtrir. Non, nous ne serons jamais prêts. Et pourtant, il faudra bien recommencer à vivre, à mourir pendant des mois, des années, des siècles jusqu’à l’improbable fin des temps.
Les silences du corbeau, p. 243.
C’était déjà assez difficile, s’oublier en écrivant, comme quelqu’un qui marche en regardant le ciel, la mer, un caillou, un visage. Cela m’était déjà arrivé quelques fois. Si je pouvais écrire un autre livre, c’était cela que je montrerais, quelqu’un qui peu à peu oublie sa propre histoire en regardant le ciel, la mer, un caillou, un visage.
Le milieu du jour, p. 118.
Et je me demande comment et pourquoi tant de connaissances et de bonheurs ont pu donner tant de désespoir.
Le siècle de Jeanne, p. 254.
Quand je voulais quitter Françoise pour Clara, c’est que je voulais passer d’une forme de pensée et d’être à une autre, et même si cette séparation a été laborieuse et que Clara m’a quittée [sic], je continue de croire que j’obéissais alors à un mouvement de vie qui cherchait à m’enraciner un peu plus sur cette terre, comme maintenant, près de Jeanne en qui le monde recommence et qui me redonne mon enfance pour que je puisse arrondir chaque instant qui me sépare de la mort, en faire des gouttes de temps pur dans lequel le passé, le présent et l’avenir pourraient se confondre et la mort se dissoudre.
Le siècle de Jeanne, p. 255.