Le Nord, pays de renaissance, terre promise et dernière frontière de l’être en quête de lui-même. Ils sont nombreux les auteurs à avoir entrepris de dompter ce territoire par l’écriture. Il faut maintenant ajouter à cette liste le nom de Mathieu Villeneuve, dont le Borealium tremens1 présente le cahier d’un retour au pays natal pour le moins singulier.
Après un séjour prolongé sur des routes l’ayant conduit jusqu’au Yukon, David Gagnon revient chez lui. Une rencontre avec le notaire d’Alma l’a auparavant informé de ce qu’Auguste Seurin, son grand-oncle, l’a désigné par testament comme seul héritier d’à peu près tout ce qu’il possédait. Réjouissances ? Plus ou moins, car de ce domaine défriché à la force du poignet et ceinturé de tourbières incultes ne restent plus maintenant qu’une terre envahie par les peupliers et une maison à moitié brûlée. Mais la perspective de se « soigner » par la terre, de se « reconnecter » avec la nature est plus forte : Gagnon se dirige donc vers le village (fictif) de Saint-Christophe-de-la-Traverse pour y jouer au vaillant colon. Là, logé dans l’arrière-pays saguenéen, il se heurtera à la malédiction des Seurin. John Scott, le notaire, l’avait pourtant averti : « […] vous vous mettez en danger […], en allant fouiner dans les décombres de la maison de vos ancêtres ».
La maison brûlée : l’héritage piégé de David Gagnon
Symbole d’une identité problématique et d’une transmission rompue, la maison brûlée représente un projet d’envergure pour le nouveau venu. À la rénovation matérielle du lieu s’ajoute en effet une volonté de restauration mémorielle : qui était cet Auguste Seurin ? Quel genre de vie pouvait-il mener, installé, contre tout le bon sens digne de ce nom, sur ce sol ingrat ? Pour ne pas oublier, David Gagnon entreprend de faire revivre cet héritage délabré, mais aussi, ambition étroitement liée, d’écrire un roman de la terre campé à Saint-Christophe-de-la-Traverse, afin de perpétuer le souvenir de ce lieu par la littérature.
En ce qui concerne les travaux manuels, l’héritier sera épaulé par son frère Alexis, son ancienne flamme Lianah de Mirecap – lire : Maria Chapdelaine – et Tony, un voisin dévoué qui complète ce triangle amoureux emprunté à l’univers de Louis Hémon. Pendant ce temps, Gagnon peut profiter de sa retraite sylvestre pour élaguer son arbre généalogique et se consacrer à la lecture des carnets de notes laissés par son grand-oncle. Ces derniers le conduiront vers Marie Bouchard, une Métisse conçue dans des conditions dramatiques, qui lui livrera le secret de son indianité et celui de la mystérieuse prophétie de China8ich2 : de branches en ramilles, sa généalogie lui réservera d’étonnantes révélations.
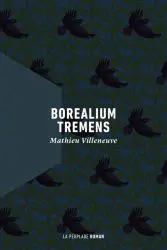 Or, terroir, racines et mémoire sont aussi les éléments d’un rêve qui tourne vite au cauchemar. Gagnon congédie bientôt tous ses invités sans autre raison que celle de vouloir la paix ; il s’aliène ses voisins et la plupart des gens de sa municipalité envers qui il nourrit une méfiance mêlée de haine, des résidents bourrus qui affichent cet air d’une autre époque où l’on réglait ses comptes à grandes volées de chevrotine. Plusieurs figurants de ce « Far Nord » offrent d’ailleurs une sorte de calque saguenéen au hillbilly des Appalaches, ce pouilleux consanguin pataugeant dans le moonshine quelque part à l’ombre du monde moderne.
Or, terroir, racines et mémoire sont aussi les éléments d’un rêve qui tourne vite au cauchemar. Gagnon congédie bientôt tous ses invités sans autre raison que celle de vouloir la paix ; il s’aliène ses voisins et la plupart des gens de sa municipalité envers qui il nourrit une méfiance mêlée de haine, des résidents bourrus qui affichent cet air d’une autre époque où l’on réglait ses comptes à grandes volées de chevrotine. Plusieurs figurants de ce « Far Nord » offrent d’ailleurs une sorte de calque saguenéen au hillbilly des Appalaches, ce pouilleux consanguin pataugeant dans le moonshine quelque part à l’ombre du monde moderne.
David Gagnon n’y échappe pas. Il sombre peu à peu dans l’alcool, une autre de ces tares à mettre au compte du legs familial. Le projet de rénovation avorte, l’entreprise littéraire piétine. La folie du Nord gagne Gagnon, toujours plongé tête première dans le tord-boyaux du patriarche. Jusqu’à ce que le délire, le vrai, l’emporte et que la malédiction fasse son œuvre.
La folie du Nord
Le Nord de Villeneuve est un lieu déserté, qui semble lui-même victime d’une malédiction. Voué à l’oubli, il est trop fruste pour être habité et porte partout témoignage de l’échec de l’homme venu pour s’y établir. Cet ancien village situé au bout d’un rang 12 pareil à bien d’autres n’est qu’un exemple parmi de nombreux du tranquille effacement de la présence humaine qui opère en ces lieux, comme si les lieux, eux aussi, d’une certaine façon, perdaient tout simplement la mémoire : « Les routes de bitume ont disparu, remplacées par le gravier. Toutes les maisons d’époque ont été démolies. Si on regarde bien entre les arbres, on peut apercevoir des carcasses de tracteurs, des tas de planches qui ressemblent vaguement à des granges, une colonie de puits bouchés, des pieux de clôture en bois moisi et, parfois, sous des renflements de mousse, les dépotoirs domestiques de trois générations ». Magnifiquement décrit, le territoire est toujours recouvert d’une fine pellicule de grisaille. À chaque page, les paysages parlent de l’absence et de l’abandon à travers les traces dérisoires que les habitants ont laissées derrière eux ; à chaque page, un décor angoissant de film d’horreur se superpose à la triste réalité de l’exode rural.
En fait, c’est là le sort de toute une région qui se meurt, Saint-Christophe y compris : « Dans plusieurs fenêtres crasseuses, des affiches À vendre ou À louer, où on avait griffonné des numéros de téléphone presque effacés, attendaient d’être décrochées par des acheteurs qui ne viendraient jamais. Les descendants des pionniers de la Traverse, établis à Chicoutimi ou à Alma, crachaient sur leur héritage ». Pourquoi cracher sur cet héritage, sinon parce que la folie du Nord, le borealium tremens, est plus forte que la plus coriace des volontés humaines ?
Loin de faire l’apologie naïve du retour à la terre, Mathieu Villeneuve opte plutôt pour un portrait de la misère ordinaire, fait des habitants de ce coin de pays une bande de dégénérés que le travail journalier et acharné, consistant à transformer quelques arpents de forêt en jardin verdoyant, conduit soit au seuil de la folie, soit dans les bras réconfortants de la bouteille. Voilà pourquoi ce qui se pensait à l’origine comme un roman du terroir verse soudain dans l’anti-terroir ou, comme le dit si bien l’un des personnages, dans le roman de la « bouette ». Autour de la maison brûlée, les plans de patates pourrissent debout, puis l’écrivain meurt bientôt de faim, retiré dans la solitude de sa thébaïde maudite, avec pour seule compagnie les fantômes ancestraux qui se font de plus en plus envahissants.
Comme l’esprit de Gagnon, le récit part ensuite en vrille et nous plonge dans une succession de tableaux fantastiques et de visions de fin du monde. On comprend alors que, comme son ancêtre Seurin, celui-ci est gagné par la paranoïa et les crises psychotiques que ses soûlographies répétées n’ont fait qu’amplifier. Il imaginera à sa suite des épidémies de maladies détruisant les récoltes, des orignaux bouffés sur pattes par les tiques, des feux de forêt incontrôlables et d’autres élucubrations dont rend compte « Le second déluge », partie la plus déstabilisante avec la série d’« Épilogues ».
Ces épilogues fonctionnent en réalité comme autant de fins à la carte. Qu’est-il advenu de David Gagnon ? On ne l’apprendra jamais avec certitude, puisque chacune des cinq ouvertures laisse planer le doute. Est-il bien celui que la postérité retiendra sous l’étiquette du Fou de la Péribonka ? Est-il parti, héros obscur, en écrivaillon de région, dans l’anonymat le plus complet, rejoindre l’ancêtre Seurin pour un dernier verre au ciel ? Peut-être encore est-il mort léché par les flammes de ce feu qui a consumé la seconde moitié de son héritage ? Nul ne sait : à défaut de savoir cultiver la terre, Gagnon sait cultiver le mystère…
Œuvre immersive, prophétique et crépusculaire écrite dans une langue vibrante, Borealium tremens propose bien quelques idées pour les laisser, tels quelques-uns des champs de l’héritier, en friche. Roman de l’anti-terroir dans lequel le travail agricole est pour ainsi dire absent, l’œuvre porte après tout sur un projet de rénovation qui n’a pas lieu et sur une écriture dont nous ne suivrons jamais ou presque le développement. Cela dit, Villeneuve est un habile prosateur et sa folie bien vite nous obsède. Il nous conduit lentement vers son climax, installe progressivement son atmosphère qui gagne toujours plus en étrangeté. Comme une lente escalade de l’ivresse, le récit s’opacifie puis s’accélère, jusqu’au delirium final où la réalité n’est plus qu’un fil fragile malmené par le délire éthylique.
1. Mathieu Villeneuve, Borealium tremens, La Peuplade, Chicoutimi, 2017, 347 p. ; 26,95 $.
2. Un personnage de ce nom est mentionné dans les Relations des jésuites (année 1643) : « Un jeune homme de la nation d’Iroquet, nommé China8ich […].
EXTRAITS
Je suis reparti sur cette route tordue, crevassée, vers mes origines. Mes projets se détaillaient par eux-mêmes, comme s’ils avaient toujours existé. J’imaginais ma terre cultivée et la maison ancestrale rénovée. Un revêtement de bardeaux de cèdres, peints à la chaux. Des volets rouges. Je pouvais presque sentir le foin fraîchement fauché, avec ses relents sucrés.
p. 21
Des mots oubliés me revenaient pour nommer les plantes qui surgissaient du sol. Des trilles. Des clintonies boréales. Des épilobes. C’était l’esprit de la forêt, l’esprit du Nord, beaucoup plus vaste que la simple somme de mes souvenirs, qui revenait à la vie. Rude, intemporel, immortel.
p. 134
Le poids de toute l’Amérique profonde, sa démesure, sa solitude, voûte les épaules, creuse les joues, durcit les regards. La neige et les canicules donnent soif toute l’année. Le Nord, ici, est la frontière du monde.
p. 165











